|
| |
|
|
 |
|
Neuroéthique : lâhumain nâest pas réductible à son cerveau |
|
|
| |
|
| |

Neuroéthique : l’humain n’est pas réductible à son cerveau
SCIENCE 03.07.2018
Les neurosciences correspondent à l’étude du fonctionnement du système nerveux, depuis les aspects les plus fondamentaux, biologiques et chimiques, jusqu’aux plus fonctionnels : la personnalité, les comportements, les pensées. Les avancées en neurosciences permettent désormais de corréler ces deux aspects, avec des conséquences importantes pour l’individu et la société. Les questions de neuroéthique qui en découlent ont fait l’objet de discussions dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Catherine Vidal, neurobiologiste et membre du Comité d’éthique de l’Inserm, et Hervé Chneiweiss, neurobiologiste et président du Comité d’éthique de l’Inserm, nous en parlent.
Quelles sont les avancées récentes qui bouleversent les neurosciences ?
Catherine Vidal : Les progrès des neurosciences ont en grande partie été portés par le développement des techniques d’exploration du cerveau qui permettent de « voir » à la fois l’anatomie et le fonctionnement du cerveau. Elles ont révolutionné la pratique clinique et permis une acquisition exponentielle de connaissances. L’IRM fonctionnelle (IRMf) permet notamment d’observer le cerveau en train de fonctionner lors de tâches diverses (motrices, sensorielles, cognitives, etc.) ou même d’états psychologiques (peur, angoisse, plaisir, satisfaction, etc.).
A côté des méthodes d’exploration, des techniques de modification du fonctionnement cérébral se sont développées. Certaines sont assez anciennes, telle l’utilisation de médicaments qui agissent sur le cerveau (psychostimulants, anxiolytiques, etc.). D’autres sont plus récentes, comme les stimulations électriques et magnétiques transcrâniennes, la stimulation cérébrale profonde
stimulation cérébrale profonde
Consiste à délivrer un courant électrique de faible intensité dans certaines structures spécifiques du cerveau, grâce à des électrodes directement implantées.
, ou encore les thérapies cellulaires notamment développées pour lutter contre des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson.
Quelles questions ou problèmes éthiques soulèvent ces avancées ?
Hervé Chneiweiss : Le champ de la neuroéthique est très vaste. Il englobe par exemple la médecine prédictive appliquées aux maladies neurodégénératives. Nos connaissances progressent si rapidement qu’elles permettent désormais de prédire l’apparition de maladies comme celle d’Alzheimer plusieurs années avant l’apparition des symptômes. Cela peut permettre d’instaurer des mesures préventives pour retarder le processus neurodégénératif. Mais, en l’absence de traitement efficace, cette médecine prédictive place le patient dans une situation très anxiogène et peut-être même discriminante. La question se pose de savoir s’il faut utiliser cette médecine prédictive à ce stade, dans l’intérêt des personnes concernées.

C.V. : Nous assistons également à une « invasion » des neurosciences dans de très nombreux domaines autres que médicaux : la justice, le marketing, l’éducation, les ressources humaines, la politique. Cet essor est étroitement lié à l’émergence des techniques comme l'IRM, que certains utilisent déjà pour décrire la pensée, les émotions, les motivations, avec au-delà la perspective de maîtriser les processus de prise de décision qui guident nos choix et nos actions. Ils vont parfois jusqu'à attribuer aux neurosciences le pouvoir de décrire l’être humain dans son individualité, sa subjectivité, ses actions, sa vie privée et sociale. Or dans la réalité, les connaissances actuelles ne permettent pas de caractériser un individu ou son comportement par la simple observation de son cerveau, loin de là. Une personne humaine n'est pas réductible à son cerveau.
H. C. : Sans oublier tout ce qui touche à la neuro-amélioration. Différents procédés permettent aujourd’hui de contrôler ou de modifier l’activité cérébrale, pour améliorer le comportement et les performances cognitives en dehors de tout contexte médical. Or non seulement le bénéfice-risque de ces techniques n’est absolument pas évalué en population générale, mais le risque de dérive est grand !
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l’utilisation des neurosciences en dehors du cadre médical ?
C. V. : Depuis 2011, la loi française inclut la possibilité de recourir à l’imagerie cérébrale dans le cadre d’expertises judiciaires. Et ce, alors que beaucoup d’experts s’y étaient opposés à l’époque. Dans les faits, les juges ne l’utilisent pas en France. En revanche, des images obtenues par IRM ont été utilisées comme « preuves » pénales dans plus de 600 affaires aux Etats-Unis. En Inde, un procès au cours duquel un électroencéphalogramme avait été utilisé comme détecteur de mensonge a fait grand bruit : une femme soupçonnée d’avoir empoisonné son fiancé avait été condamnée à la prison à vie car son cerveau ne réagissait pas au mot « arsenic », comme s’il lui était familier. La sentence a finalement été abandonnée face au scandale international suscité par cette affaire.
H. C. : Aucune étude n’est en mesure de valider l’utilisation de l’électroencéphalogramme ou de l’IRM pour prédire ou révéler un comportement et ils ne peuvent donc en aucun cas servir de preuve. Néanmoins, le nombre des publications sur la neuro-justice explose, principalement aux États-Unis : de 70 articles publiés entre 1990 et 2000, on est passé à plus de 2 000 entre 2000 et 2015.
C. V. : Il y a aussi la neuro-politique, une « nouvelle discipline » qui tente de corréler les opinions et le fonctionnement cérébral. Une étude a suggéré que le cortex cingulaire antérieur, qui joue un rôle dans la détection des contradictions, est plus volumineux chez les gens de gauche alors que la région de l’amygdale, impliquée dans la peur, est plus développée chez les gens de droite. Ainsi la peur des situations conflictuelles et des risques expliquerait les différences d'opinions politiques ! Dans le domaine du marketing, l’utilisation de l'imagerie cérébrale peut être utilisée pour savoir quelle étiquette stimule davantage l’attention de l’acheteur potentiel, le but étant bien sûr d'influencer sa décision d'achat ! Et dans le champ de l’éducation, les neurosciences influencent déjà certains programmes pédagogiques.
Aux Etats-Unis, des sociétés privées propose des examens d’imagerie cérébrale dans ces différents contextes non médicaux. En France, ces pratiques ne sont pas possibles : les appareils d’IRM sont réservés aux établissements de soins et de recherche biomédicale.
Ces applications ont elles un fondement scientifique validé ?

C. V. : Aux Etats-Unis, certains scientifiques recherchent les bases neuronales des comportements de type antisocial, agressif et criminel, pour mettre au point de nouveaux traitements et des programmes de prévention de la délinquance. Des études par IRM ont pu montrer une légère réduction de l’épaisseur du cortex cérébral dans les régions préfrontale et temporale de criminels. Mais l'interprétation de ces images est problématique : jusqu'à présent, rien ne permet d'établir une relation de causalité entre une réduction d'épaisseur du cortex et un comportement déviant. L'origine des variations d'épaisseur du cortex ne peut être déterminée. Le cerveau est plastique et l’IRM donne seulement un cliché de l’état du cerveau d’une personne à un moment donné. Elle n’apporte pas d’information sur son passé et n’a pas non plus de valeur prédictive. Enfin, le fonctionnement du cerveau est extrêmement complexe, avec de nombreuses régions impliquées dans une même fonction. La zone du crime n'existe pas.
Les dérives dans l'interprétation de l'imagerie cérébrale ne sont pas rares. D'autant plus que pour un public non averti, les images colorées du cerveau sont fascinantes et peuvent apparaître comme une preuve scientifique « objective ».
Vous avez également parlé de neuro-amélioration : où en est la science et jusqu’où pourrait-elle aller ?
H. C. : La modification du fonctionnement cérébral n’est pas une idée nouvelle. Les antidépresseurs par exemple, peuvent en quelques sortes transformer la personnalité de l’individu. C’est aussi le cas du méthylphénidate donné à des millions d’enfants pour qu’ils soient plus calmes ou encore du modafinil pris comme stimulant par autant d’adultes. Mais dans le domaine psycho-cognitif, la ligne de démarcation entre le normal et le pathologique est impossible à tracer… la question se pose alors de savoir qui traiter : une grande timidité ou une hyperactivité doivent-ils être considérés comme un handicap à prendre en charge ?

C.V. : Et pour certains, dans une société marquée par le culte de la performance, l’objectif n’est plus seulement de palier un déficit mais d’aller au-delà. Des études ont montré que, dans certains cas, la stimulation électrique transcrânienne peut améliorer les performances cognitives et l’état émotionnel de personnes en bonne santé. Le neurofeedback permet quant à lui de contrôler sa propre activité cérébrale, pour augmenter certaines fonctions comme les capacités visuo-spatiales ou la mémoire.
Des sociétés privées, en Asie notamment, proposent déjà des casques de stimulation par courant continu qu’il est possible d’acheter pour des sommes modiques sur internet. On laisse croire au grand public que la stimulation transcrânienne aidera par exemple à préparer ses concours, alors même que l’innocuité de l’administration de courant continu n’a pas été évaluée à moyen et long terme. Il n’est pas exclu que la pratique « sauvage » de la neurostimulation interfère avec certains circuits neuronaux, altère la plasticité cérébrale.
plasticité cérébrale
Mécanismes au cours desquels le cerveau est capable de se modifier en réorganisant les connexions et les réseaux neuronaux, dans la phase embryonnaire du développement ou lors d’apprentissage.
et entraine des crises d’épilepsie. En France, la commercialisation de ces casques n’est pas autorisée.
A terme, le risque est d’assister à l’émergence d’une catégorie d’individus augmentés. Cette vision transhumaniste entrainerait inévitablement une fracture sociale entre ceux qui auront recours à ces techniques et ceux qui ne pourront pas y avoir accès. Sans compter que la personnalité de l’individu, son autonomie et son libre arbitre pourraient être altérées par ces neurotechnologies.
H. C. : Certains systèmes de stimulation cérébrale fonctionnent déjà de façon autonome et pourraient bientôt être proposés aux patients parkinsoniens pour contrôler leurs tremblements : une intelligence artificielle déclenche les stimulations quand elle l’estime nécessaire, alors que jusque-là le patient contrôlait lui-même son appareil. Avec ce système, le patient deviendrait donc un « homme augmenté ».
Qu’en est-il de la protection des données personnelles ?
H.C. : C’est un autre problème important. Des sociétés privées commencent à collecter les données cérébrales à tour de bras pour différentes recherches, sans consentement clair ou sans la protection des données nécessaires. Et qui sait ce qu’elles pourraient en faire un jour ? Je lisais récemment un article sur l’équipement de salariés de douze entreprises d’Etat chinoises, dépendantes de l’armée, par des casques permettant de surveiller leur activité cérébrale. Le motif officiel est de prévenir les baisses de vigilances et les accidents. Mais ces dispositifs permettent de collecter d’autres données... Il y a là un vrai problème éthique. L’activité cérébrale n’est pas neutre, elle correspond à des données personnelles.
Considérez-vous la situation actuelle comme préoccupante ?
C.V. : Nous ne sommes pas dans l’urgence, mais il faut aborder de front ces sujets qui posent des questions de société. La France est encore préservée des dérives qui gagnent d’autres pays, avec un accès à l’IRM réservé aux professionnels de santé ou encore l’interdiction de la stimulation cérébrale en dehors d’un protocole de soins. La loi de bioéthique de 2011 inclut en outre une mission de veille sur les recherches et les applications des techniques d’imagerie cérébrale, destinée à défendre une éthique dans ce domaine.
Aujourd’hui en France, pour évaluer la responsabilité pénale d’un accusé, le juge nomme des psychiatres et des psychologues qui appuient leurs expertises avant tout sur des entretiens et non sur l'IRM. Mais pour combien de temps encore ? Le risque est de voir le modèle américain gagner du terrain pour l’évaluation de la responsabilité et de la dangerosité d’un prévenu. Or les Français ne sont pas assez informés sur les dérives possibles de l'utilisation de l'IRM. En témoigne la faible participation aux discussions sur la neuroéthique dans le cadre des états généraux de bioéthique qui viennent de s’achever. Il est de notre responsabilité de chercheurs d'anticiper ces questions et de sensibiliser le grand public.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
SÃMANTIQUE |
|
|
| |
|
| |

SÉMANTIQUE, subst. fém. et adj. I. − Subst. fém.
A. − LINGUISTIQUE
1. Étude d'une langue ou des langues considérées du point de vue de la signification; théorie tentant de rendre compte des structures et des phénomènes de la signification dans une langue ou dans le langage. Sémantique analytique, générative, logique, structurale; sémantique descriptive, interprétative; sémantique comparée, diachronique, historique, synchronique; sémantique lexicale, narrative; sémantique paradigmatique, syntagmatique; sémantique de l'énoncé, de la phrase; rapports entre syntaxe et sémantique. Opposée tantôt au couple phonétique-phonologie, tantôt à la syntaxe (plus particulièrement en logique), la sémantique est une des composantes de la théorie du langage (ou de la grammaire) (Greimas-Courtés1979).V. sémasiologie ex. de Rey:
1. Nous définirons (...) le mot comme l'unité sémantique minima de la parole. (...) La science du mot s'appelle lexicologie. Elle comportera deux subdivisions, selon qu'on s'intéresse au nom ou au sens. L'aspect formel des mots est examiné par la morphologie (...). Les significations lexicales constituent le domaine de la sémantique [it. ds le texte]. S. Ullmann, Précis de sém. fr., Berne, éd. A. Francke, 1952, p. 33.
− P. ext., rare. Étude (et théorie) d'un système de signification quel qu'il soit. Synon. sémiotique.Sémantique linguistique, musicale, cinématographique. Le sous-sol de l'âme, − ce que le meilleur philologue Beethovenien (je pourrais dire: le maître de sémantique Beethovenienne) Heinrich Schenker, a nommé l'« Urlinie », le « Lichtbild des Seelenkernes » (Rolland,Beethoven, t. 1, 1937, p. 23).
2. En partic. [Dans le cadre de la sémiotique classique de Ch.-W. Morris, et p. oppos. aux deux autres composantes de celle-ci, la syntaxe et la pragmatique] Étude générale de la signification des signes conçue comme une relation entre les signes et leurs référents. (Ds Rey Sémiot. 1979).
B. − LOG. [Dans un lang. formalisé, p. oppos. à la syntaxe qui expose l'alphabet utilisé, les règles de construction des expressions bien formées, ainsi que les règles de déduction opérant à partir des axiomes] Ensemble des aspects du système logique relatifs aux notions de satisfaction et de vérité. Les logiciens du cercle de Vienne, et principalement Carnap, en sont venus à considérer la logique d'abord comme une syntaxe générale et ensuite comme complétée par une sémantique (la tendance récente (...) qui atténue singulièrement la rigueur du système, consistant à la compléter encore par une pragmatique) (Traité sociol.,1968, p. 233).Il est bien difficile de fixer le sens d'un mot qui désigne, non pas un objet immuable comme une racine cubique, mais une discipline en plein développement. La frontière même de la sémantique et de la syntaxe est incertaine (VaxLog.1982, p. 139, s.v. syntaxe).
Rem. La sémantique peut traiter aussi des structures qui satisfont aux formules et prend alors le nom de théorie des modèles.
II. − Adjectif
A. − [Corresp. à supra I A 1] LING.
1. Qui est relatif à la sémantique, qui a rapport à la signification d'un mot ou d'une structure linguistique. Changement, évolution sémantique; contenu, trait sémantique; analyse, description sémantique; théorie sémantique. Le sens du signe dans le discours est une représentation dans laquelle se combinent la valeur sémantique en langue, telle qu'elle est définie par la convention, et la valeur de situation qui dérive de l'énoncé (Langage,1968, p. 454):
2. ... il est deux lois sémantiques (...). L'une a trait à l'usure des sens. Elle porte que le mot s'épuise avant l'idée et laisse aisément altérer, s'il ne la perd, − plus l'idée est de soi vive et frappante − sa vertu expressive. (...) La seconde (...) porte que le sens commun, en matière de langage, dispose d'un instinct qui ne le trompe guère; qu'il perçoit exactement (...) les plus menues variations d'un sens; qu'il peut enseigner l'écrivain lui-même, et qu'aux Halles on n'apprend pas seulement à parler, mais à entendre. Paulhan,Fleurs Tarbes,1941, p. 77.
♦ Champ sémantique. Ensemble des mots, des notions se rapportant à un même domaine conceptuel ou psychologique. La méthode d'analyse des champs sémantiques élaborée par l'Allemand J. Trier permet de montrer que l'articulation d'une même région notionnelle peut varier selon les langues ou les états successifs d'une même langue (Ducrot-Tod.1972, p. 176).
− [Dans une gramm. générative]
♦ Composant ou composante sémantique. Composant interprétatif traduisant les suites de morphèmes engendrés par la syntaxe en un métalangage permettant de donner une représentation de la signification des phrases. La composante sémantique d'une grammaire (...) a pour fonction d'interpréter les structures syntaxiques en termes de sens − autrement dit, d'attribuer une signification (ou plusieurs, dans le cas des phrases ambiguës) aux structures engendrées par la syntaxe (et le lexique) (N. Ruwet, Introd. à la gramm. générative,1967, p. 332).
♦ [P. oppos. à asémantique] Phrase sémantique. Phrase qui a un sens, qui est acceptable du point de vue du sens. Une phrase qui n'est pas sémantique est dite asémantique (ReySémiot.1979).
− Empl. subst. masc. [Chez Benveniste, p. oppos. au sémiotique] Mode de signifiance d'un signe engendré par le discours. V. sémiotique II B 2 ex. de Benveniste.
2. [Corresp. à supra I A 2] Qui est relatif, appartient à la signification, à la relation entre les signes et leurs référents. [Morris] distingue (...) entre les dimensions sémantique, syntaxique et pragmatique d'un signe: est sémantique la relation entre les signes et les designata ou les denotata; syntaxique, la relation des signes entre eux; pragmatique, la relation entre les signes et leurs utilisateurs (Ducrot-Tod.1972, p. 117).
B. − LOG. Système sémantique. Synon. de sémantique (supra I B). (Dict. xxes.).
REM. 1.
Séma(nt)-,(Séma-, Sémant-) élém. formanttiré du gr. σ η μ α ν τ- base de certaines formes du verbe σ η μ α ι ́ ν ε ι ν « signifier », entrant dans la constr. de qq. mots, dans le domaine de la ling., et indiquant l'idée de sens, de signification.V. sémantème, sémantique, sémanticien, sémasiologie, sémasiologique (dér. s.v. sémasiologie).
2.
Sémantiquement, adv.Du point de vue de la sémantique, de la signification. De toutes les analyses que j'ai reçues d'« et les fruits passeront la promesse des fleurs », la sienne est de beaucoup la mieux poussée, grammaticalement et sémantiquement (Bremond,Poés. pure,1926, p. 100).
Prononc. et Orth.: [semɑ ̃tik]. Att. ds Ac. 1935. Étymol. et Hist. 1. 1561 (Collange, Polygraphie, 14 r ods Delb. Notes mss: Lesquelles [vingt quatre lettres de l'alphabet] j'ay par bon ordre proposees a autant de dictions et paraphrasmes symentiques qui pourront servir pour toute simple description de tous et de tant de secrets que l'operateur voudra), attest. isolée; 2. 1875 art. milit. « art de mouvoir les troupes à l'aide de signaux » (Lar. 19e) − 1895, Guérin Suppl.; 2. a) 1879 (M. Bréal, Lettre à Angelo de Gubernatis, cité ds Hist. épistémol. lang., t. 3, fasc. 2, p. 128, note 8: Je prépare aussi un livre sur les lois intellectuelles du langage, auquel je travaille depuis des années: ç'est ce qu'on peut appeler la sémantique); b) 1897 adj. rapport sémantique (Thomas (A.) Essais, p. 172). Formé sur le gr. σ η μ α ι ́ ν ω « signifier » (cf. gr. σ η μ α ν τ ι κ ο ́ ς « qui signifie »; cf. chez Aristote φ ω ν η ́ « son, voix » σ η μ α ν τ ι κ η ́); à rapprocher de 2 le sens part. de σ η μ α ι ́ ν ω « faire un signal » d'où « donner un ordre, diriger une armée » et σ η μ α ́ ν τ ω ρ « qui donne le signal ou les ordres, qui commande ». En angl. l'adj. semantic est att. en ling. dès 1894 (v. NED Suppl.2), au sens gén. en 1665 semantick Philosophy (v. NED), et le subst. semantics dès 1893 (v. NED Suppl.2). Fréq. abs. littér.: 27.
DÉR.
Sémantisme, subst. masc.Contenu sémantique; ensemble des valeurs sémantiques dont un mot ou une expression sont investis. (Dict. xxes.). − [semɑ ̃tism̭]. − 1reattest. 1913 (Esnault ds R. Philol. fr. t. 27, p. 187); de sémantique par substitution du suff. -isme à la finale; le mot a été en concurrence avec sématisme (v. Esnault, L'Imagination pop., Métaph. occid., p. 6; cf. angl. sematism 1866 ds NED Suppl.2, s.v. seme) qu'il a supplanté.
BBG. − Baldinger (K.). Vers une sémantique mod. Paris, 1984, 261 p. − Baylon (Ch.), Fabre (P.). La Sémantique. Paris, 1974, 110 p. − Carnoy (A.). La Sc. du mot: traité de sémantique. Louvain, 1927, 428 p. − Charron (G.). La Distinction entre sémantique et axiologie. Mél. Martinet (A.) Paris, 1979, pp. 261-270. − Chomsky (N.). Questions de sémantique. Paris, 1975, 230 p. − Dubois-Charlier (F.), Galmiche (M.). La Sémantique générative. Paris, 1972, 130 p. − Ducháček (O.). Précis de sémantique fr. Brno, 1967, 263 p. − Greimas (A.J.). Sémantique struct. Paris, 1966, 263 p. − Guiraud (P.). La Sémantique. Paris, 1969, 128 p. − Hervey (S.). Axiologie et sémantique en ling. fonctionnelle. Lang. Ling. 1982, t. 8, n o2, pp. 57-70. − Ledent (R.). Comprendre la sémantique. Verviers-Paris, 1974, 224 p. − Le Ny (J.-F.). La Sémantique psychol. Paris, 1979, 257 p. -Lerat (P.). Sémantique descr. Paris, 1983, 128 p. − Lyons (J.). Élém. de sém. Paris, 1978, 296 p. − Martin (R.). Inférence, antonymie et paraphrase. Paris, 1976, 174 p.; Pour une log. du sens. Paris, 1983, 268 p. − Martinet (A.). Sémantique et axiologie. R. roum. ling. 1975, t. 20, pp. 539-542. − Mounin (G.). Clefs pour la sémantique. Paris, 1972, 269 p. − Pottier (B.). Ling. gén. Paris, 1974, 339 p. Vers une sém. mod. Trav. Ling. Litt. Strasbourg. 1964, t. 2, n o1, pp. 107-137. − Probl. de sémantique. Par A. Dugas et collab. Paris, 1973, 254 p. − Quem. DDL t. 24. − Rey (A.). La Sémantique. Lang. fr. 1969, n o4, pp. 3-28; Théor. du signe et du sens... Paris, 1976, 408 p. − Schogt (H. G.). Sémantique synchr. Toronto, 1976, 136 p. − Tutescu (M.). Précis de sémantique fr. Paris, 1975, 214 p. − Ullmann (S.). Esquisse d'une terminol. de la sémantique. In: Congrès Internat. des Linguistes. 6. 1948. Paris, 1949, pp. 368-375; Le mot sémantique. Fr. mod. 1951, t. 19, pp. 201-202; Précis de sémantique fr. Bern, 1965, 3eéd., 352 p. − Wunderli (P.). Sémantique und Sémiologie. Vox rom. 1971, t. 30, n o1, pp. 14-31.
DOCUMENT cnrtl .fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Mémoire freudienne, mémoire de l'oubli |
|
|
| |
|
| |
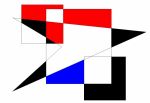
Mémoire freudienne, mémoire de l'oubli
Alain Vanier dans mensuel 344
daté juillet-août 2001 -
Freud pose l'existence d'une mémoire propre à l'inconscient. C'est une mémoire de l'oubli en ce sens que les événements - décisifs - qu'elle enregistre sont complètement oubliés par le sujet, qui les refoule jusqu'à ce que la cure psychanalytique les fasse resurgir. Cette forme de mémoire est la seule à ne pas subir le dommage du temps qui passe.
Retrouver, faire surgir de la mémoire, grâce au traitement, un souvenir d'enfance oublié serait la visée de la psychanalyse et la clé de son efficacité. Cette conception du travail analytique est aujourd'hui encore la plus répandue, elle en constitue la vulgate la plus commune. Il s'agit, pourtant, de ce que Freud et Breuer* nommèrent la méthode cathartique, qui précéda la psychanalyse, en fut le préalable sans doute nécessaire, mais ne se confond pas avec elle1. Le débat actuel sur les psychothérapies et la place que, pour certains, la psychanalyse devrait y avoir, alors qu'elle se distingue radicalement de celles-là, témoigne de la persistance de cette confusion qui manifeste une résistance toujours active de la culture à la découverte freudienne.
Avant la découverte de la psychanalyse proprement dite, Freud et Breuer arrivent à la conclusion que les hystériques* souffrent de réminiscences. Les symptômes des patientes - il s'agit de femmes dans les exemples cliniques rapportés - prennent sens quand ils sont reliés à un souvenir méconnu, oublié, de nature sexuelle. Quand ce souvenir est ramené à la mémoire, le symptôme disparaît. C'est l'étonnante constatation que fait d'abord Breuer avec sa patiente Anna O., que vérifie ensuite Freud avec les femmes dont il relate le traitement. Contre cette représentation sexuelle inconciliable, le sujet organise une défense dont le refoulement* constituera le prototype. Le malade veut oublier quelque chose et il le maintient volontairement hors de la conscience, dans ce que Freud appelle alors l'« inconscience ». Ce souvenir contre lequel le patient se défend est dû à un traumatisme qui s'organise en deux temps. Dans un premier temps, il s'agit d'une scène de séduction opérée par un adulte sur un enfant dans une période prépubertaire. Celle-ci ne provoque chez celui-ci, à ce moment-là, ni excitation sexuelle ni refoulement. Après la puberté, un autre événement possédant quelques traits pouvant être associés au premier, bien que d'apparence souvent très éloignée, déclenche alors un afflux d'excitations internes dues au souvenir de la scène de séduction et produit le refoulement de celui-ci. Dans le traitement peu à peu mis au point en abandonnant l'hypnose et la suggestion, la méthode de libres associations permet la réémergence de ce souvenir qui pourra alors être normalement abréagi*, et produit la disparition du symptôme. Cette disparition n'empêche pas et souvent même s'accompagne de l'apparition d'un nouveau symptôme d'expression différente.
Ainsi, ce qui est refoulé apparaît dans le symptôme de façon déformée, et son sens est méconnu. On saisit d'emblée qu'il y a là une sorte de paradoxe : ce qui est décisif pour le symptôme, pour la pathologie, est ce qui semble le plus radicalement oublié. Ce qui s'est inscrit de la façon la plus forte dans la mémoire, ce qui a été le mieux mémorisé au point de ne pas subir l'usure normale du temps, à la différence des souvenirs que le sujet a sans difficulté à sa disposition, comme la mémoire des apprentissages, est ce qui apparaît comme oublié. Quant au souvenir qui fait retour dans cette première méthode, dite cathartique, sa valeur de vérité, tout comme sa véracité son exactitude ne sont pas distinguables l'une de l'autre, ni mises en cause, alors que la psychanalyse, elle, les séparera.
Complexe d'OEdipe. Vers la fin du mois de septembre 1897, Freud abandonne ce premier état de la théorie2. Il donne à cela plusieurs raisons, dont celle qui conduirait, dans chacun des cas, à accuser le père de perversion. En effet, chaque fois, cette scène de séduction semble avoir été opérée par le père. Or, Freud, comme il l'écrit à Wilhelm Fliess, oto-rhino-laryngologiste berlinois, a acquis « la conviction qu'il n'existe dans l'inconscient aucun "indice de réalité", de telle sorte qu'il est impossible de distinguer l'une de l'autre la vérité et la fiction investie d'affect ». Moins d'un mois plus tard, Freud découvre en lui, dans ce qu'il appelle son auto-analyse, des « sentiments d'amour envers [sa] mère et de jalousie envers [son] père » , sentiments qu'il pense communs à tous les jeunes enfants. On comprend alors « l'effet saisissant d' OEdipe Roi » , car « la légende grecque a saisi une compulsion que tous reconnaissent parce que tous l'ont ressentie » . La découverte du complexe d'OEdipe conduit à situer les scènes de séduction subies par les hystériques comme fantasmatiques, fictions mettant en scène un désir inconscient, viré au compte d'un autre, le père en l'occurrence. Ces fantasmes, qui se présentent alors comme souvenirs, « se produisent par une combinaison inconsciente de choses vécues et de choses entendues » . Au moment où elles ont été perçues, ces choses n'ont pas été comprises, le sens n'en viendra que plus tard, et elles ne seront utilisées qu'après coup.
Ainsi l'appareil psychique proposé par Freud est d'emblée un appareil de mémoire, permettant d'expliquer des phénomènes de mémoire, situés comme symptomatiques. Or, cette mémoire est spécifique, elle oblige à penser plusieurs mémoires. Plus tard, Jacques Lacan proposera de distinguer une mémoire comme propriété définissable de la substance vivante, ou mémoire vitale, de la mémoire freudienne qu'il nomme mémoration puisque c'est par la remémoration qu'elle peut être accessible. Celle-ci n'est « pas du registre qu'on suppose à la mémoire, en tant qu'elle serait la propriété du vivant 3 » , elle est de l'ordre de l'histoire, qui suppose le groupement d'un certain nombre d'événements symboliques définis, avec l'après-coup - notion déjà présente dans la théorie traumatique - comme nécessaire à sa constitution. Lacan la distingue aussi de la réminiscence imaginaire, comme « écho du sentiment ou de l'empreinte instinctuelle » . La mémoire freudienne est une mémoire symbolique, enracinée dans le signifiant. Quel est alors le statut des souvenirs qui apparaissent au cours d'une cure analytique, ces souvenirs qui, rendus à la conscience, prennent la place du symptôme qui les masquait et produisent la guérison ? Levée du symptôme, rendre conscient ce qui est inconscient est, pour Freud, une tâche de la cure.
Hypocrisie sociale. Avec la rectification de 1897, on saisit bien que la valeur de vérité du symptôme comme du souvenir refoulé se trouve disjointe de l'exactitude figurative de l'événement retrouvé. Or, ce moment fondateur de la psychanalyse a été, voici quelques années, contesté. La lecture de la partie inédite de la correspondance de Freud avec Fliess conduisit Jeffrey M. Masson, des Archives Freud, à faire l'hypothèse que le renoncement à la théorie de la séduction était un escamotage. Selon lui, Freud aurait reculé devant l'énormité de sa découverte, la séduction réelle par les pères, pour diverses raisons, dont l'accueil fait à ses hypothèses par les instances académiques mais aussi le désir de protéger le père. Freud se serait soumis à l'hypocrisie sociale et intellectuelle en vigueur, la théorie du fantasme n'étant que le manteau dont il aurait habillé, pour les voiler, les abus sexuels, dont les patientes de Freud auraient été l'objet. Ce débat eut un grand retentissement aux Etats-Unis. Une série d'articles parut dans le New York Times en 1981, puis un livre en 19834. Masson fut licencié des Archives Freud, mais le débat persista. Il prit une dimension supplémentaire en trouvant un écho dans la vague de procès et d'accusations qu'entamèrent, aux Etats-Unis, un certain nombre de personnes contre leurs parents, leur père en particulier, les accusant d'abus sexuels et aboutissant à des condamnations, fondées le plus souvent sur cette certitude qu'un souvenir, s'il était inscrit dans la mémoire du sujet, avait nécessairement un fondement réel voir l'article d'Olivier Blond dans ce numéro. La question se formule alors ainsi : les souvenirs que les sujets retrouvent, ces scènes de séduction précoces, voire le retour ou le dévoilement de ces souvenirs à travers des méthodes psychothérapiques, témoignent-ils d'une inscription intégrale, non déformée, sorte d'engramme d'une scène vue et vécue, dont le re-souvenir garantit l'exactitude ? Mais alors pourquoi l'oubli, et à quel ordre de nécessité correspond-il ? Ou faut-il, en donnant sa place à la notion de défense, concevoir autrement, comme une construction, les souvenirs auxquels la méthode analytique donne accès ? Entre ces deux hypothèses, c'est tout l'enjeu de la psychanalyse, sa validité aussi bien que sa viabilité qui est en jeu.
Signes + et -. Le souvenir de telle scène infantile n'est-il pas suspect de déformations, si l'on admet que son oubli n'est pas fortuit et peut constituer l'une d'elles ? La psychanalyse suppose, nous l'avons déjà indiqué, une mémoire spécifique. Cette mémoire est organisée selon une série de frayages*, d'enregistrements qui restent hors de la conscience.
Freud affirmera que la conscience et cette forme de mémoire s'excluent. Il convient donc de distinguer deux types de mémoire : celle dont on parle habituellement, que l'on peut avoir acquis lors de certaines expériences demeurées conscientes et qui va s'user avec le temps, et celle, particulière, qui constitue la mémoire freudienne où ce qui est retrouvé n'a pas subi le dommage du temps qui passe, est resté aussi vif et actuel que lors de sa première inscription. Cette dernière mémoire pourrait être nommée mémoire de l'oubli puisque ce qui est inscrit demeure inaccessible à la conscience, apparaît comme un oubli dans la vie du sujet, demeure inconscient, mais ne cesse de revenir dans les formations de l'inconscient, le rêve, les souvenirs-écrans, les symptômes, les agirs du sujet dans la répétition. Cette mémoire s'inscrit sur le mode de traces, et ce qui lui donne cohérence et articulation est le langage. Ainsi, dans la figurabilité de ces souvenirs, ce sont des constructions langagières qui apparaissent.
Ce souvenir est un souvenir construit par un travail psychique, selon des mécanismes que Freud décrit. Dans tel rêve où s'articule le regret de Freud de n'avoir pas obtenu la gloire attendue pour son travail sur la fleur de coca, cet élément botanique, apparemment absent du rêve, figure comme herbier à partir duquel des associations conduisent au titre d'un livre aperçu la veille, L'Espèce Cyclamen , qui est la fleur préférée de sa femme, dans le nom du professeur Gärtner jardinier en allemand, et sa femme dont il a trouvé la mine « florissante » croisés également la veille par Freud, etc. Ces fils, avec d'autres, se recoupent autour de ce regret, de cet échec dont sa femme serait la cause5. Cette organisation langagière conduira Lacan à concevoir ce mécanisme d'oubli et de remémoration analytique comme apparenté à la mémoire d'une machine dans laquelle les inscriptions tournent en rond jusqu'à se recomposer et réapparaître dans les symptômes ou dans les formations de l'inconscient à partir d'un travail de cryptage. Ces constructions sont organisées en un système, celui que Saussure voyait comme fondamental pour la langue : la pure différence, un signifiant ne valant que dans sa différence avec un autre. Celle-ci peut se figurer par une série de signes + et - .
La mémoire freudienne peut alors se concevoir comme une succession de petits signes, strictement différenciés, que l'on peut noter + et -, qui tournent6. A la différence, par exemple, de ce qui apparaît dans les hypothèses touchant à l'apprentissage d'actes consciemment mé- morisés, comme dans l'édu- cation, cette mémoire, qui efface de notre souvenir ce qui ne nous plaît pas, n'empêche pas que le sujet répète inlassablement des expériences pourtant douloureuses, conformément à la structure de ses désirs inconscients, qui eux, selon Freud, sont indestructibles et persistent indéfiniment. Ainsi peuvent se comprendre des séries d'échecs amoureux répétés selon des modalités proches émaillant la vie d'un même sujet, les névroses de destinée, etc. Ce qui s'inscrit, le frayage, n'est pas un mode de réaction appris par le sujet, une habitude, quelque chose qu'il va répéter pour trouver une solution à une difficulté, à un problème rencontré dans son environnement, cette répétition se satisfait de quelque chose qui lui est inhérent et qui la fera nommer par Freud compulsion de répétition.
Dans cette perspective, ce qui se figure dans le souvenir est une recomposition de ces traces déposées, sans index temporel, à des époques différentes. Freud propose un terme pour caractériser ces souvenirs d'enfance, le souvenir-écran. Ce souvenir construit fait écran à l'histoire, il en constitue une interruption, tout en restant relié à elle, et contient un fragment de vérité car il est dans sa constitution comparable au symptôme ou à toute autre formation de l'inconscient. Sa construction obéit aux modes de déformation de ce qui passe à la conscience, il est à la fois une rupture dans l'histoire, car il apparaît comme indépassable, et, en même temps contient, de façon cryptée, les éléments de son au-delà.
L'Homme aux loups. A la différence du souvenir traumatique qui s'atteint dans la méthode cathartique, Freud découvrira avec la méthode analytique une limite à la remémoration. Il met cela en évidence à propos du cas de l'Homme aux loups7. Dans ce texte, Freud a le projet en fait de discuter Jung et de montrer qu'il y a dès l'enfance des motifs libidinaux présents et non une aspiration culturelle, qui, précocement, n'est qu'une dérivation de la curiosité sexuelle. Ce texte est en quelque sorte une mise au jour de la théorie du trauma. Il s'agit ainsi d'examiner les rapports entre le fantasme et la réalité. Dans la cure de ce patient russe, un chiffre, une lettre joue un rôle particulier. C'est le chiffre V. A cette heure-là du jour, de façon récurrente, l'Homme aux loups présenta des symptômes physiologiques quand il était enfant, mais aussi quand il aura atteint l'âge adulte. Freud suit à la trace ce chiffre dans les évocations du patient. Il le repère dans la récurrence de ces troubles et leurs dates, mais il le relève aussi dans le fait que lorsque l'Homme aux loups dessine un rêve, le rêve central de son analyse, ce rêve des loups, qui lui donnera son nom, il en annonce un nombre différent du nombre qu'il dessine qui est V. Freud retrouve aussi ce chiffre, cette lettre dans la forme d'un papillon, l'ouverture des jambes d'une femme, un lapsus où le sujet, au lieu de dire Wespe la guêpe, dit Espe le tremble. Ce qui tombe là, c'est le W, c'est-à-dire deux fois le V. Espe, c'est aussi S.P., qui sont les initiales de ce patient. Cette lettre n'a pas à être imaginarisée, elle circule dans toute la vie du patient et dans son traitement, et prend des sens et des significations différents. Elle témoigne de cette inscription littérale, d'une trace dans l'inconscient, inscription sans sens en tant que tel.
Histoire culturelle. Mais la scène traumatique n'a pas été retrouvée par le patient au cours du traitement. Freud en fait l'hypothèse, la construit sous la forme d'une scène primitive, qui aurait eu lieu quand le patient était âgé d'un an et demi. Il aurait assisté à une relation sexuelle entre ses parents. Freud discutera très longuement la question de la réalité de cette scène. La conviction de son patient concernant cette proposition que fait Freud ne lui paraît pas non plus une garantie. Mais cet événement a laissé une empreinte, que le sujet n'a pas pu articuler verbalement, à la différence d'autres souvenirs remémorés dans la cure. Freud à ce point-là proposera l'hypothèse, inspirée de Lamarck*, qu'il s'agit peut-être d'une possession héritée, d'un héritage phylogénétique. Il écrit : « Nous voyons uniquement dans la préhistoire de la névrose que l'enfant recourt à ce vécu phylogénétique là où son vécu propre ne suffit pas. Il comble les lacunes de la vérité historique par une vérité préhistorique, met l'expérience des ancêtres à la place de son expérience propre. » Cette scène, qui n'a pas été symbolisée, a pourtant laissé une trace inscrite, mais ne peut s'atteindre par la remémoration. Il faudra l'intégrer dans le temps historique du sujet pour lui donner une figurabilité. Il y a donc une limite à la remémoration due à une sorte d'entropie qui limite ce retour en arrière. La question de ces dépôts de l'histoire culturelle humaine peut se comprendre dans la manière où le système langagier du sujet, son système verbal, ne lui est pas propre. Il s'agit d'une langue dans laquelle l'histoire fait son travail, c'est là où s'inscrit le sujet. Nous naissons à la langue, dans une langue qui nous fait, nous détermine, avec ces dépôts de la mémoire qui la constituent.
Paradoxalement, Freud a pu faire l'hypothèse que l'inconscient ne connaissait pas le temps, car ce qu'il retrouvait dans l'analyse, dans les symptômes, les formations de l'inconscient n'était marqué d'aucun indice temporel, n'était pas daté. Cette mémoire freudienne est d'autant plus active qu'elle n'est pas indexée temporellement, qu'elle est oubliée. C'est même le fait que le sujet ne saisit pas qu'il agit dans l'actualité du transfert sur quelque chose qui a été mémorisé mais non indexé temporellement qui fait tout le procès de la cure analytique. Il s'agira de faire cette histoire qui ne s'est pas faite en son temps, de remanier, de restituer l'histoire qui s'est racontée pour recouvrir ces lacunes, de produire un savoir de la névrose, savoir que le sujet ne se savait pas savoir. Mais ces blancs de l'histoire sont aussi ce qui meut le sujet, son mouvement même, dans la répétition, dans la quête de retrouvailles avec ce qui a été perdu. Ainsi, l'inconscient, cette mémoire de ce qui a été oublié, est le temps même et la condition de sa conscience.
1 S. Freud et J. Breuer, Etudes sur l'hystérie 1895, trad. A. Berman, Paris, PUF, 1956.
2 Voir S. Freud, La N aissance de la psychanalyse , Lettres à Wilhelm Fliess, notes et plans 1887-1902, trad. A. Berman, Paris, PUF, 1969.
3 J. Lacan, Ecrits , Paris, Seuil, 1966, p. 42 ; voir aussi J. Lacan, Le M oi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse. Le Séminaire. Livre II , 1954-1955, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1978.
4 J. M. Masson, Le R éel escamoté , trad. C. Monod, Paris, Aubier, 1984 ; voir aussi J. Malcom, Tempête aux archives Freud , Paris, PUF, 1986.
5 S. Freud, L' Interprétation des rêves , 1900, trad. I. Meyerson, Paris, PUF, 1967.
6 J. Lacan, Les P sychoses . Le Séminaire, Livre III , 1955-1956, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1981.
7 S. Freud, « Extraits de l'histoire d'une névrose infantile », 1918, in L'Homme aux loups par ses psychanalystes et par lui-même , trad. L. Weibel, C. Heim et J.-B. Pontalis, Paris, Gallimard, 1980.
NOTES
*Le médecin autrichien Joseph Breuer traita Anna O., et le récit de cette cure ainsi que la méthode originale qu'il utilisa, la méthode cathartique, intéressa Freud. Celui-ci, après un voyage à Paris où il rencontra Charcot, proposera à Breuer la rédaction en commun d'un ouvrage Les Etudes sur l'hystérie qui paraîtra en 1895. Malgré leur éloignement ultérieur, Freud présentera souvent Breuer comme le véritable inventeur de la psychanalyse.
*L'hystérie est une névrose d'expression clinique variée, présentant des symptômes somatiques dans l'hystérie de conversion, phobiques dans l'hystérie d'angoisse, etc. Connue depuis longtemps, elle ne prend la dimension d'une véritable catégorie nosographique qu'avec Charcot. Pour la psychanalyse, l'hystérie est au-delà des signes présentés et constitue une structure commune à ces tableaux divers.
*Le refoulement est synonyme de répression, mot en usage dans la littérature anglo-saxonne.
*Notion issue de la première théorie traumatique de l'hystérie et de son traitement par la méthode cathartique, l'abréaction est la décharge émotionnelle de l'affect lié au trauma psychique. Elle peut avoir lieu spontanément ou plus tardivement au cours du traitement.
*Le frayage est un terme proposé par Freud en 1895. Il s'agit de la diminution permanente d'une résistance, normalement présente, dans le passage de l'excitation d'un neurone à l'autre. Ultérieurement, l'excitation choisira la voie frayée de préférence à celle qui ne l'est pas.
*Le botaniste et zoologue Jean-Baptiste Lamarck a élaboré, vers 1800, la première théorie de l'évolution des êtres vivants. Il a défendu l'idée de l'hérédité des caractères acquis.
DOCUMENT larecherche.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
LA BIODIVERSITÃ |
|
|
| |
|
| |

Texte de la 6ème conférence de l'Université de tous les savoirs réalisée le 6 janvier 2000 par Jean-Claude Mounolou
La biodiversité.
La biodiversité ne fait pas lobjet dune discipline scientifique à proprement parler, elle est à un carrefour de rencontre entre les disciplines scientifiques, des sciences biologiques, des sciences physico-chimiques pour ce qui est de lenvironnement, des sciences humaines et sociales.
Ce carrefour, nous sommes tous convaincus quil existe. La biodiversité, cest la variété du monde vivant autour de nous : les arbres, ceux qui ont subi la tempête mais aussi ceux qui y ont résisté, cest aussi les poissons qui vont se trouver prisonniers dans des mares quand les crues seront terminées, cest aussi les microbes, les virus, cest aussi les prions.
Cette biodiversité a des fonctions. Dabord, pour chacun de nous, cest une ressource dans la vie quotidienne. Nous avons besoin de manger, de nous vêtir, de nous chauffer. Cest une ressource renouvelable, susceptible cependant dépuisement, mais cest aussi une ressource que lhomme a appris à renouveler et à enrichir. Bien entendu, cest un champ dactivité et de profit pour la société, cest un champ où la recherche trouve des objets à la hauteur de sa mission, où la conservation issue dun projet de société trouve des moyens et des champs daction, où la gestion va tâcher de faire lusage que lhomme souhaite de ces ressources biologiques et va les administrer. La biodiversité, cest enfin une image de nous-mêmes et des autres êtres vivants dans une vision éthique, avec des droits et une éducation.
La biodiversité telle que nous la vivons, nous, Parisiens, femmes et hommes de pays riche et développé, nous la vivons comme le symbole de la nature, dans la beauté et la diversité de son paysage. Lorsque nous nous sentons sentimentalement, viscéralement attachés à la biodiversité, nous commençons par penser à ça. Par contre, une mère de famille en pays tropical plutôt pauvre, quand elle pense à la biodiversité, pense à des choses beaucoup moins riches, peut-être tout aussi diverses pour le biologiste, avec lesquelles elle va nourrir sa famille : quelques petits piments, jaunes, verts, rouges, de plusieurs variétés, des pastèques, différents types darachides. La voilà la biodiversité. Cest celle aussi avec laquelle nous vivons. Et une bonne partie de lhumanité sintéresse à la biodiversité parce quelle a besoin de vivre.
Dun point de vue plus scientifique, ce que je retrouve quand je lis les livres des gens compétents me donne le vertige : vertige du temps et vertige des nombres.
Si nous parlons en espèces, dans les recensements des systématiciens des années 91, sont répertoriés 1.600.000 espèces mais le total estimé est probablement dix voire cent fois plus. Vertige devant linconnu.
Et là-dessus, on mexplique, sans me définir très clairement ce quest la domestication, quà peine quelques milliers de ces espèces sont de façon directe ou indirecte sous la tutelle de lhomme. Le reste, est-ce une richesse ? Est-ce un fardeau ? Faut-il aller en chercher dautres, puisque nous en utilisons déjà si peu dans ce que nous connaissons ?
Le vertige saccroît si je parle en termes de renouvellement. Les paléontologues, les biologistes de lévolution nous enseignent que la demi-vie moyenne dune espèce à la surface de la planète est de lordre du million dannées. A comparer aux trois et quelque milliards dannées que la vie a déjà vécu sur la Terre. Ce qui veut dire quil en est passé des espèces sur les sites sur lesquels nous vivons ! Combien sont nées ? Combien ont disparu ? Les nombres sont tellement grands. Je ne sais pas faire le calcul.
Et si je mintéresse maintenant aux individus, vous trouverez que la vie moyenne dun individu est, en général, de moins dune année. Certes, il y a des micro-organismes qui vivent quelques dizaines de minutes ou quelques heures, des végétaux qui sont annuels, dautres qui sont bisannuels, dautres qui sont pérennes. Nous sommes parmi les espèces qui vivons relativement longuement. Les arbres encore plus. Et vous avez, bien entendu, senti les effets de la tempête dans cette vision. Les mêmes livres nous disent que tous ces individus sont génétiquement différents. Chacun de nous certes se reconnaît comme partie prenante dune espèce, mais sait aussi quil est différent de son voisin, différent de son père, de sa mère, sait que ses enfants lui ressemblent sans être identiques à lui. Cest pour ça que jai le vertige des nombres, cest aussi pour ça que jai le vertige du temps.
Cest donc clair : cette biodiversité bouge tout le temps. Cest ce que jappelle un « système en devenir ».
Pourquoi alors vivons-nous une période de tension, dinquiétude à propos de cette biodiversité ? Parce que le temps de cette biodiversité - mais je devrais dire « les temps », tous ceux que jai passés en revue jusquà linstant -, ces temps sont clairement différents du rythme et du temps de la vie économique actuelle. Nous vivons à un rythme qui est beaucoup plus rapide que celui de la biodiversité, nous accélérons les choses. Est-ce que nous lui laissons le temps de se renouveler, dêtre toujours à la disposition de lhomme ? Ce faisant, je prends une position idéologique : je mets lhomme au milieu, je mets lhomme à coté, je mets lhomme au-dessus ou peut-être au-dessous - cela dépend de ce que vous pensez. Est-ce que jai le droit de faire ça ?
Nous allons aussi avoir un vertige dans lespace, parce que cette biodiversité nest pas distribuée de façon homogène : la flore de montagne nest pas la flore des plaines, la flore du petit square devant le CNAM, nest pas la flore que vous trouverez, par exemple, sur les bords de la Méditerranée maintenant que lhomme a mis du béton et des géraniums partout. Ce sont pourtant des milieux vivants, bien structurés, bien organisés, et les biologistes savent les décrire, savent analyser, décrire, suivre éventuellement leur fonctionnement. Les biologistes nous disent que ces sites de biodiversité sont des mosaïques plastiques, qui se déforment. Nous lavons vu avec la tempête. Nous avons pensé que cétait terrible, cette tempête, et cela lest pour les hommes, cela lest peut-être aussi pour les plantes - elles ne nous lont pas dit -, mais nous savons que, dans un autre territoire national, lîle de La Réunion, ces tempêtes sont absolument indispensables au maintien dune biodiversité dynamique sur lîle. Le cyclone, quand il passe, arrache les arbres, comme la tempête la fait ici dans la région ou en Charente. Après ces arbres, des espèces végétales pionnières sinstallent et vivent, elles laissent des graines, elles laissent des descendants très nombreux, elles sont remplacées par dautres, elles font le passage pour dautres qui sinstallent à leur tour. Les précédentes, on pourrait dire quelles disparaissent. Le botaniste averti est amené à les chercher avec beaucoup de soin sils veut retrouver des graines ou des plantules. Y a-t-il crise de cette biodiversité-là ? Peut-être. Mais, en tout cas, le système de lîle de La Réunion vit avec des successions, des cascades de diversités biologiques qui font partie de leur système, qui se sont installées et qui vivent comme ça.
Je suis convaincu, mais je voudrais que vous le soyez, que ce nest pas un système statique. Nous ne pourrons pas larrêter, cette biodiversité, mais nous pourrons peser sur son avenir.
Peser sur lavenir, cela veut dire que nous sommes dans un problème de société. Biodiversité, oui, mais les conflits arrivent. Tout le monde na pas la même opinion, tout le monde na pas le même intérêt. Certains veulent survivre. La mère de famille qui va au marché na pas le même objectif vis-à-vis de la biodiversité et des ressources quelle peut ramener à la maison pour ses enfants que ceux qui vivent avec des objectifs de société, eux aussi, dans des sociétés riches, structurées, dans des entreprises, publiques ou privées, dont lobjectif est le profit. Mais tous ceux-là mangent comme vous et moi tous les jours à leur faim et leur objectif, notre objectif, cest de payer la meilleure nourriture possible au plus bas prix. Nous ferons aussi des efforts pour des raisons qui concernent sentimentalement, spirituellement chacun de nous. Là-dessus, il faudra quand même, quelles que soient nos sociétés, assurer sécurité alimentaire, santé à chacun de nous. Il est bien clair que tout le monde nest pas égal devant ce système. Développements économiques, profits, développements durables : on voit les objectifs, on voit les conflits venir.
***
Quest-ce que la biodiversité ? La définition de la Convention sur la diversité biologique parle de variabilité entre organismes vivants dans des milieux différents. La diversité inclut la diversité au sein des espèces, entre les espèces et entre les écosystèmes. Cest une définition qui oublie le fonctionnement intime des organismes.
LUnion internationale pour la conservation de la nature ainsi que le Programme de la Banque mondiale ont une définition plus simple et probablement plus claire bien quambitieuse et parlent de « la totalité des gènes, des espèces et des écosystèmes dans une région ».
Ce qui nous fait parcourir lensemble de léchelle du niveau dorganisation du vivant. La biodiversité est donc un concept important, mais cest aussi un concept ambigu, pour tout le monde
Je vais donner quatre petits commentaires de biologiste.
Pour les généticiens et les évolutionnistes, la biodiversité, cest la diversité des gènes et des individus et celle des espèces. Ils savent étudier et comprendre certains processus. Ce sont les mutations, les échanges génétiques et la dynamique des génomes, qui est une façon peut-être grossière et pas très correcte de parler de tous ces remaniements qui se sont produits au niveau de lADN et qui ont autorisé lévolution dont parlait François Jacob.
Mais cela se passe dans un contexte de système biologique, de système écologique. Certains des objets qui apparaissent et disparaissent, ne font ni chaud ni froid à leurs voisins, dautres se trouvent avoir une propriété qui les favorise. Ce sont des questions de neutralité et de sélection, la question revisitée du darwinisme aujourdhui. Tout cela fonctionne avec des nombres, avec des fonctions - dans le jargon des biologistes, en méta-populations. Cest une autre façon de dire que le système est organisé en mosaïques et que certains individus passent de lune à lautre, séchangent, certains séteignent, le site est recolonisé par des individus de la même espèce, de la même famille génétique, parfois dautres différemment, certains reviennent chez leurs grands-parents, pour ainsi dire et, au passage, ils ont un peu changé en donnant de la richesse, de la nouveauté dans les sites occupés par leurs anciens grands-parents. Tout cela va donc de façon divergente. Le nombre des espèces, disent les évolutionnistes, est allé en augmentant, et beaucoup dentre elles ont disparu et nous nen recueillons aujourdhui que ce qui reste en lan 2000. Il y a dans ces dynamiques des processus qui sont bien déterminés, dont on peut analyser les mécanismes et prédire de façon certaine les résultats et dautres processus qui sont au contraire probabilistes, dont on peut dire comment ils fonctionnent mais pas avec quelle probabilité ils donneront tel résultat.
Ceci étant, le biologiste ne sintéresse pas quaux gènes et à lévolution, il sintéresse aussi au fonctionnement des organismes, des individus, à ceux qui ont froid, à ceux qui ont mal, à ceux qui ont faim, à la façon dont les animaux, les plantes, les micro-organismes, les hommes, les femmes se reproduisent, aux problèmes de démographie. Il y a là de la biodiversité. Les individus, les espèces nutilisent pas les mêmes stratégies de reproduction selon le milieu, lidée quils sen font et la façon dont ils le perçoivent. Cela a des conséquences. Il y a des espèces qui développent des organisations sociales pour raffiner leur réponse à cet objectif de reproduction et dautres qui utilisent les voisins, qui vivent en communauté. Ce sont des consortiums. Nous savons bien que les bons fromages ne sont pas le produit dune seule espèce de ferment lacté mais dun consortium astucieux qui sest partagé les tâches, qui sest entraidé pour faire apparaître des saveurs, des textures, des sapidités qui sont celles que nous, nous sélectionnons. Cest une vie de consortiums. Ces espèces microbiennes échangent entre elles. Elles échangent de quelle manière ? Elles échangent des signaux certes, des gènes quelquefois, elles échangent aussi et elles partagent les substrats pour se nourrir.
Nous en arrivons ainsi progressivement au système, à ces milieux, à ces régions. Cest le domaine de lécologie, lécologie scientifique.
Le consortium dans lécologie, cest linteraction entre espèces, cest une interaction durable. Claude Combes parlera ici même de la naissance de cette interaction, de la façon dont elle fonctionne, de son rôle dans la reproduction éventuellement sexuée des différents partenaires bien quils ne soient pas de la même espèce.
Ces habitats sont fragmentés. On a parlé de mosaïques. Pour un écologiste, cest extrêmement intéressant. Cest de là quil tire ses références, quil peut dresser ses comparaisons, quil peut expérimenter, au sens dun scientifique, cest-à-dire en faisant des prédictions sur la base dhypothèses, en analysant les résultats. Il découvre que les variations sur un même thème sont aussi extrêmement diverses, enrichissant notre biodiversité, mais quelles sont vulnérables.
Cependant, ce quils nous disent aussi, cest que, si nous faisons attention aux constantes de temps, au rythme des choses et des dynamiques, il y a différents types de scénarios possibles pour voir évoluer, se transformer ces écosystèmes.
Nos collègues décologie se posent à partir de là une question. La biodiversité a-t-elle une fonction ? Bien sûr que oui. Comment lanalyse-t-on ?
Pour répondre, il faut connaître les animaux, les bactéries, les plantes. Autrement dit, il faut être un bon systématicien, un bon botaniste. Depuis Linné, la systématique a construit la base de notre savoir vivant, de notre capacité à distinguer les objets les uns des autres. Cette systématique a tiré sa gloire mais elle a aussi vécu et elle vit encore la difficulté du vertige du temps et du vertige des nombres. Nous avons cruellement besoin de la systématique et nous naurons jamais fini cette systématique. En plus, tout change tout le temps. Dans tous ces endroits nouveaux que nous découvrons, dans tous ces remaniements qui vont se faire, il nous faudra connaître les êtres vivants. Peut-être que les enjeux de la systématique nouvelle sont non plus dans la connaissance des genres, des espèces, des sous-espèces, mais du côté de la connaissance des patrons, des collectivités, des fonctions. Il y a là un immense espace de liberté, de progrès pour les systématiciens.
Au passage, les systématiciens rencontrent des difficultés, parce que les généticiens disent que les échanges génétiques, les échanges dADN, cela existe. Rarement, heureusement, mais cela existe. Quel concept despèce alors utiliser ? Lorsque vous rencontrez un virus qui passe de la pomme de terre au tabac, direz-vous que ce virus fait partie de lespèce pomme de terre ou direz-vous quil fait partie de lespèce tabac ? Cest pourtant le même ADN, nucléotide par nucléotide. Moi, je ne sais pas répondre, mais je sais quil y a un problème pour les systématiciens et pour nous tous - et pour vous et pour moi. Parce que jai parlé du tabac gentiment, mais vous pensez bien que jaurais pu parler de lespèce humaine.
Donc, voilà les biologistes au travail. Allons-nous attendre pour faire quelque chose quils aient fini ce dont je viens de dire quils nauraient probablement jamais fini ? Sûrement pas. Ce système biologique, il faut bien lutiliser. Il faut avoir le courage de regarder cette biodiversité comme une ressource. Bien sûr, il faut la connaître. Bien sûr, il y a limpact de lhomme. Bien sûr, cela dépend du choix de société.
Alors, quelle démarche pouvons-nous proposer ? Nous proposons dévaluer la biodiversité, de regarder comment elle évolue et puis de traiter cette question-là dans nos décisions sociales et politiques en fonction de notre perception et de nos hiérarchies de valeurs. Cela passe auparavant par des inventaires, des observatoires, par des systèmes de conservation, cela passe par des ingénieries de gestion et dadministration. Il est bien clair que, si nous devons être plus nombreux sur cette planète, non seulement il faut accompagner cette préservation de la diversité biologique mais aussi nous avons intérêt à lamplifier, à ce quelle soit la plus riche possible, pour elle-même et peut-être aussi pour nous.
***
La biodiversité est en train de recevoir un encadrement juridique. Par rapport à la démarche du biologiste, la démarche de nos collègues des sciences juridiques est une démarche que jappelle inversée. Eux disent que cest moi qui suis inversé. Ils partent de léthique, de la société, des individus et définissent nos champs de liberté. Ils partent de nos rapports sociaux et proposent des lois et des règles que les citoyens votent à travers leurs élus. Ils partent des règlements, quil faut bien apporter aux conflits, et posent des interdits. Quand la société se fixe des objectifs, ils nous proposent des procédures compatibles avec les lignes précédentes. Pour cela, les juristes de la biodiversité ont besoin de connaître les mesures de gestion possibles, ils ont besoin dévaluer ce que les uns et les autres sont en train de faire.
Je vais prendre cette question en trois points, en redescendant les aspects de la biodiversité : des écosystèmes, des régions, jusquaux gènes.
Le droit et les écosystèmes, cest une vieille histoire. Cest ce que jappelle lhistoire de lapproche environnementale. Le droit de propriété est très ancien et il a des conséquences sur la biodiversité : droit de propriété foncière privée et publique. Il est dans notre Code, mais il existe aussi un code rural qui définit les usages, un droit de la mer, dont on sait quil est parfois bafoué. A lintérieur de ce corps juridique ont été définis par nos prédécesseurs, par nos pères, par nous-mêmes quand nous votons, des droits et servitudes particuliers : les droits de chasse, le régime des eaux qui règle la vie de la diversité aquatique mais aussi de lagriculture. Nous avons défini des mesures publiques, des mesures collectives de protection et de conservation. Nous avons un Conservatoire du littoral. Même lEurope sen est mêlée avec la directive « Habitats ». Je nai pas besoin de vous dire les conflits quil y a avec les chasseurs.
Ce droit a aussi été construit par espèces. Ici il nest plus question décosystèmes mais despèces. Quand on regarde la façon dont le droit évolue aujourdhui, on saperçoit que les sensibilités ont changé considérablement. Le loup, au temps de la guerre de Cent ans, était une espèce bannie. Nous cherchons aujourdhui à le réintroduire. Je ne dis pas que cest bon ou mauvais, je dis que cest une question de perception. Dautre part, nous navons pas la même attitude vis-à-vis despèces que nous assimilons à nous-mêmes et vis-à-vis dautres. Le nounours de nos enfants, on va le défendre tout en piétinant gentiment les plantes protégées de la flore pyrénéenne. Visiblement, nous navons pas le même sentiment pour lours que pour certaines petites plantes discrètes. Nous navons pas non plus de sentiments très gentils pour protéger lagent de la tuberculose. Pourtant, cest un être vivant, lui aussi. Nous aurions même tendance à le traiter autrement si nous le pouvions. Et si nous ny réussissons pas, cest peut-être aussi pour une question de société. Nous avons donc des espèces en voie de disparition, des espèces protégées, un droit, des classements, des mesures. Sont-elles bien appliquées ? Vous avez chacun votre réponse. Même pour les espèces domestiques, il y a un encadrement juridique de la diversité biologique. Dans le meilleur des mondes possible, on imaginerait que juristes et biologistes conçoivent un droit de la prospection sans ambition. Je crains bien que nous nen soyons pas encore là. Gardons ça comme un rêve.
Reste à parler du droit et de lapproche génétique. Ce nest pas nouveau, lapproche génétique. Depuis le Néolithique, les agriculteurs ont fait de lapproche génétique sans savoir quils faisaient de la génétique : ils ont domestiqué les plantes. Quand je vous ai dit que le blé à la veille de la guerre de Cent ans faisait cinq quintaux à lhectare, cétait bien un ancêtre du blé, cétait bien du blé, au sens de Linné, au sens de lespèce, mais cétait un type de blé qui navait probablement pas les capacités de production dans un milieu entretenu par lhomme quont les blés daujourdhui. Donc, les généticiens, les sélectionneurs, ceux qui améliorent les plantes, les agriculteurs, les paysans ont fait depuis de nombreuses années un travail. Ils gardaient leurs semences, plus ou moins habilement. Quelquefois, ils étaient obligés de les manger : cétait la disette. En 1920, la France fut parmi les premiers pays à développer un cadre juridique en instituant les certificats dobtention végétale qui témoignaient de la qualité de ce quun producteur de semences vend, avec reconnaissance du travail dagriculture fait. Tout ce système sest développé de 1920 jusquà nos jours. Il existe aujourdhui une législation parfaitement bien encadrée et une Union pour la protection des obtentions végétales, reprise par la FAO, sans dailleurs que tous les pays aient adhéré. En 1966, à une période de gloire et dactivité économique, lEtat français de lépoque a fait une loi sur lélevage et lencadrement de linsémination artificielle. Notre pays a fait ainsi de la génétique animale et a encadré sa production laitière et sa production de viande dans des systèmes réglementaires où les outils de contrôle démocratique devraient pouvoir sexercer.
Pour ce qui concerne le monde microbien, les choses sont différentes parce que ces petits objets vivants, bien quils représentent en masse la moitié du protoplasme vivant sur la Terre sont si petits que nous ne les voyons pas avec nos yeux. Nous ne nous y sommes donc pas intéressés comme aux lapins ou aux chênes. Depuis très longtemps, ils sont cependant soumis aux droits de brevets. Ils ont vécu une vie juridique, depuis la fin du siècle dernier jusquà récemment, différente de celle des plantes et des animaux. Cest la vie juridique des microbes.
Aujourdhui se produisent des conflits. Nous venons de vivre, disons, une quinzaine dannées durant lesquelles jai le sentiment davoir vécu trois événements majeurs. Dabord, même si elle est incomplète, la maîtrise des gènes. De la matérialité de lADN aux technologies classiques de génétique et de génie génétique, on est passé à la brevetabilité des séquences, des procédés et à une évolution du concept de ressource génétique, puisque, si vous pensez en termes de gènes, vous pouvez vous interroger. Quelle est la ressource ? Est-ce la plante ? Est-ce lADN ? Est-ce le procédé ? Est-ce celui qui a acheté le procédé ? Cest le débat aujourdhui. A Seattle, on en a entendu parler.
En parallèle, nous avons vécu une révolution de notre perception du statut juridique du monde biologique. Avant 1992, dans tous les textes du type de ceux de lUnion pour la protection des obtentions végétales, mais aussi dans les plans daction de la FAO ou dans dautres, y compris dans les plans daction dérivés des programmes de la Banque mondiale, la diversité biologique était définie comme un patrimoine commun de lhumanité. LUNESCO la écrit ainsi dans ses chartes. Vient 1992, la conférence de Rio : la biodiversité est en danger. Parmi les nombreux alinéas de la Convention, qui a force de traité international, il y en a un qui est important. Je dois dire quen tant quindividu, je ne men suis pas rendu compte tout de suite. Il ma fallu cinq ans pour le comprendre, mais je ne suis pas juriste. Peut-être aussi avais-je les yeux volontairement fermés par mes propres idées. Un alinéa dit en effet que « les Etats voient leur souveraineté reconnue sur la diversité biologique qui est sur leur territoire ». Ce qui veut dire que ce nest plus un patrimoine commun de lhumanité. Il est vrai que le mot « souveraineté » ne veut pas dire « propriété ». Doù un champ de conflits extraordinaire. Mais cest ça que nous vivons aujourdhui, qui plus est exacerbé par la mondialisation. Quest-ce quon vend ? Quest-ce quon échange ? Qui a les objets ? Qui a les droits ? Qui échange les droits et selon quels régimes ? Donc, propriété intellectuelle, structures économiques multinationales et puis les débats de Seattle. Vous les avez entendus.
Nous vivons donc une nouvelle situation, mais une situation où sont apparus aussi des espaces de liberté nouveaux.
Dabord, pour les Etats. Les Etats ont vu leur souveraineté reconnue. Je ne dis pas si cest bien ou mal, je le constate. Cest une situation où linnovation développée par les individus, développée par les entreprises, développée par les structures institutionnelles se voit ouvrir un champ daction beaucoup plus grand à des niveaux dorganisation du vivant, sur des échelles de temps et sur des valeurs bien différentes de ce que nous connaissions quand jétais à lEcole agronomique.
Pour les citoyens, il y a aussi un nouvel espace de liberté. Ils ont à agir, mais il faut quils se mettent au clair sur leur projet de société en fonction de ce quils pourront connaître, comprendre, accepter, refuser, de ce qui leur est proposé.
Dans cette nouvelle situation, je vois trois tendances se dessiner.
La première tendance est celle du biologiste qui sintéresse à ses petites plantes ou à ses petits animaux et qui constate leffacement de lidée de conservation statique avec une priorité donnée à une conservation dynamique qui peut être relayée et entraînée par le concept de ressource et celui dinnovation. Notre société va déjà dans ce sens-là.
Dautre part, ce sera à nous de faire ce quil faut éventuellement. Et dans ce « faire ce quil faut », nous aurons à nous poser la question : où sont, dans ce futur, la justice et léquité ? Comment sont partagés les pouvoirs des individus, les pouvoirs des faibles et les pouvoirs des puissants ? Qui prendra en charge les coûts ? Qui gérera le patrimoine ?
Enfin, il ny a rien là à déplorer. Il y a eu un réel progrès des connaissances, que lon a vu se matérialiser récemment sur les gènes mais les gènes ne sont pas tout. Ce ne sont pas les gènes qui font les hommes ni les citoyens. Les gènes font partie des hommes et des citoyens et ne sont pas les seules choses à faire les hommes et les citoyens. De ces connaissances qui sont sorties sur les gènes comme de celles qui vont sortir à propos du fonctionnement des organismes ou de lécologie, nous aurons besoin pour construire nos ingénieries, pour construire nos projets - et aussi pour tout le temps pouvoir les remettre en cause. |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
