|
| |
|
|
 |
|
BABYLONE |
|
|
| |
|
| |

Babylone
en akkadien Babilou (que l'on a interprété, plus tard et à tort, comme « Porte du dieu »)
Cet article fait partie du dossier consacré à la Mésopotamie.
Cité du pays d'Akkad (en Iraq).
Ville de Mésopotamie dont les ruines se trouvent à 90 km au sud de Bagdad (près de l'actuelle Hilla), Babylone fut la capitale d'une vaste région de Mésopotamie. Arrosée par le Tigre et l'Euphrate, elle connut l'une des plus brillantes civilisations du monde antique, qui se développa pendant près de douze siècles.
HISTOIRE
1. LE PREMIER EMPIRE BABYLONIEN (XIXe-XVIIe SIÈCLE AVANT J.-C.)
La ville de Babylone existe dès le xxiiie siècle avant J.-C., au temps de la splendeur d'Akkad. Le premier texte cunéiforme qui mentionne le nom de Babylone date du règne du roi d'Akkad Sharkali-sharri (v. 2185-2160 avant J.-C.). La cité, alors bien modeste, n'a pas le prestige de ses voisines du Sud : Nippour, Our, Éridou et Ourouk. Son entrée dans l'histoire ne débute véritablement qu'avec l'arrivée des Amorrites, ces Sémites occidentaux qui, à la fin du xxe siècle, submergent les pays de Sumer et d'Akkad. Parmi ces envahisseurs, un certain Sumou-aboum s'installe à Babylone et y fonde une dynastie qui régne pendant trois siècles (1894-1595). Les Amorrites, jusque-là nomades, se laissent alors assimiler par les Babyloniens, adoptent leur langue et sacrifient à leurs cultes. Les premiers rois amorrites prennent le plus grand soin de leur capitale ; les inscriptions qu'ils ont laissées font état de nombreux travaux de construction, de restauration et de fortification.
2. DU RÈGNE DE HAMMOURABI AUX HITTITES
Toutefois, cette première dynastie babylonienne ne devient une puissance que sous le règne de son sixième roi Hammourabi (1793-1750), qui en fait la capitale de son empire. Hammourabi, connu surtout pour son œuvre de législateur, est aussi un grand conquérant. Par des efforts continus, il parvient à dominer les anciennes « villes de royauté » : Isin, Ourouk, Our et Larsa. Plus au nord, il met fin à l'existence du royaume de Mari (1758), annexe Eshnounna (1755) et impose sa souveraineté à Ishmé-Dagan Ier, roi d'Assour.
Sous son règne, la Babylonie (pays de Sumer et d'Akkad unifiés) tient le devant de la scène mésopotamienne. Si, après Hammourabi, la civilisation babylonienne continue de rayonner, l'empire, lui, se révèle fragile. Samsou-ilouna (1750-1712) fait face à de nombreuses révoltes – dont celle de Larsa en 1738 – et perd une partie de l'ancien pays de Sumer. Ses successeurs tentent en vain de refaire l'unité de l'Empire mais en 1595, les Hittites s'abattent sur Babylone.
3. LA BABYLONIE KASSITE (1595-VERS 1153 AVANT J.-C.)
À la faveur de ce raid hittite, d'autres envahisseurs, les Kassites, descendus des montagnes de l'Est et du Nord-Est, s'emparent à leur tour de Babylone et y fondent leur propre dynastie. Tout comme leurs prédécesseurs, les Kassites adoptent la culture suméro-akkadienne et tentent de rendre à Babylone tout son prestige : Agoum II, premier souverain de la dynastie, rapporte les statues du dieu Mardouk et de sa parèdre (déesse à laquelle il est associé) Sarpanitou, enlevées par les Hittites. Vers 1530, les Kassites récupèrent Sumer ; la Babylonie à nouveau reconstituée retrouve sa suprématie d'autrefois.
Mais, à partir du xive siècle, harcelé par l'Assyrie, le royaume babylonien décline ; en 1203, le roi d'Assour Toukoulti-Ninourta Ier prend Babylone et s'empare des statues de Mardouk et de Sarpanitou. Humiliés, les Kassites parviennent un moment à redresser la situation et chassent les Assyriens, mais en 1153, à la suite d'un raid élamite, leur dernier représentant est emmené captif en Élam.
4. DE L'INVASION ARAMÉENNE À LA DOMINATION ASSYRIENNE (1153-626 AVANT J.-C.)
Dès lors, une dynastie locale – dite, d'après son lieu d'origine, dynastie d'Isin – prend la relève. Ses deux premiers rois reconduisent la politique de lutte contre l'hégémonie assyrienne et parviennent à rendre à Babylone ses divinités Mardouk et Sarpanitou (1136). Mais à peine ces statues ont-elles réintégré l'Esagila (temple principal de Babylone) que les Élamites, réitérant leurs pillages, les emportent à nouveau (1129). Avec Nabuchodonosor Ier (v. 1127-1105), troisième roi de la dynastie, la ville atteint le faîte de sa puissance. Il fait campagne dans le Zagros et rapporte en triomphe les statues divines. C'est probablement alors, au terme d'une ascension commencée sous le règne de Hammourabi, que Mardouk achève de supplanter Enlil (dieu de Nippour) ainsi que les autres divinités des différentes cités de basse Mésopotamie.
À partir du xie siècle, le royaume babylonien, en butte aux invasions des nomades araméens, entre dans une très longue période d'instabilité. Cette situation est habilement exploitée par les Assyriens qui parviennent, au viiie siècle, à annexer la Babylonie. Au siècle suivant, la ville de Mardouk, alors défendue par les Chaldéens – tribu d'origine araméenne –, est par deux fois saccagée, par les armées assyriennes de Sennachérib (689) puis d'Assourbanipal (648).
5. LA CITÉ DE BABYLONE AU TEMPS DES CHALDÉENS
Restaurée, embellie et fortifiée après les ravages assyriens, Babylone est aux viie et vie siècles avant J.-C. la plus grande ville de l'Orient. La splendeur babylonienne, reconnue par les prophètes juifs Isaïe et Jérémie, décrite, entre autres, par le Grec Hérodote et l’historien arabe Tabari, est aussi attestée par l'archéologie.
Le site couvre environ 975 ha délimités par une enceinte extérieure longue de 11,5 km ; celle-ci, construite à l'époque de Nabuchodonosor, se compose de deux murs : l'un, intérieur, épais de plus de 7 m, est fait de briques séchées au soleil ; l'autre, extérieur, large d'une dizaine de mètres, est édifié à partir de briques cuites. C'est au centre de cet espace que s'étend, à cheval sur le cours ancien de l'Euphrate, le cœur de la ville de Babylone.
6. LA SPLENDEUR ARCHITECTURALE DE LA CITÉ
Ce noyau (2,5 × 1,5 km), qui abrite les palais royaux, les temples, une voie dite « processionnelle » ainsi que des quartiers d'habitation, est également entouré d'un rempart. Son enceinte, en briques crues, percée de huit portes, est faite de deux murs parallèles flanqués de tours et séparés par un fossé rempli d'eau. La porte d'Ishtar, haute d'au moins 15 m, est remarquable par la richesse de son décor ; sa façade flanquée de deux tours est ornée de dragons (symboles de Mardouk) et de taureaux (symboles d'Adad), motifs en briques moulées en relief et émaillées en blanc et en jaune sur fond bleu réalisés à l'époque de Nabuchodonosor.
Parmi les bâtiments alignés de part et d'autre de la voie processionnelle, le palais sud, construit pour l'essentiel sous les règnes de Nabopolassar et de Nabuchodonosor, étonne par ses majestueuses dimensions (322 × 190 m). Au sud de ce palais se dresse la ziggourat appelée Etemenanki (« Maison du fondement du ciel et de la terre »). Cette tour à étage, assimilée à la tour de Babel, dont la destruction a été achevée par Alexandre le Grand, n'existe plus. On sait seulement qu'elle était construite sur un plan carré de 91 m de côté ; ses étages, peut-être au nombre de sept, supportaient une chapelle qui, selon Hérodote, était rehaussée de briques émaillées. À proximité de la ziggourat, toujours dans cette même partie de la ville, se dressait l'Esagila, énorme sanctuaire dédié à Mardouk.
7. L'EMPIRE NÉOBABYLONIEN (626-605 AVANT J.-C.)
Le Chaldéen Nabopolassar (626-605) fonde la Xe et dernière dynastie de Babylone. Allié des Mèdes dès 625, il attaque l'Assyrie, qui s'écroule en 612, rendant ainsi à Babylone son prestige. Son fils, Nabuchodonosor II (605-562) – célèbre pour avoir pris Jérusalem et déporté l'élite juive sur les bords de l'Euphrate –, échoue à s'emparer de l'Égypte mais réussit à dominer toute la Mésopotamie, la Syrie et la Palestine. La Babylonie, désormais maîtresse du couloir syrien et du nord de l'Arabie, détient le monopole du grand commerce. Les revenus considérables de l'empire sont en grande partie consacrés à l'embellissement des cités ; outre Babylone, Our, Ourouk, Nippour, Sippar, Kish, Larsa et Barsippa connaissent une intense activité architecturale.
8. LE DÉCLIN DE BABYLONE
Parmi les successeurs de Nabuchodonosor, Nabonide (556-539) est le seul qui se maintienne quelque temps sur le trône, mais il ne peut repousser l'attaque du Perse Cyrus II. Babylone prise en 539 est néanmoins traitée avec le plus grand respect ; ses dieux, entourés des égards de l'envahisseur, sont maintenus dans leurs temples. Cyrus II restaure même des sanctuaires à Our et à Ourouk ; à Babylone, où il établit sa résidence d'hiver, il fait construire un arsenal, un palais pour le prince héritier et un immense apadana (salle soutenue par des colonnes) pour son propre palais.
Cependant, les autres rois de Perse, accaparés par la guerre contre les Grecs, s'intéressent peu à leur nouvelle satrapie. En 482, Xerxès Ier, irrité par l'esprit « national » de ses sujets babyloniens, démantèle leur capitale et emporte la statue d'or de Mardouk. À partir du ve siècle, écartée du grand commerce, écrasée sous les charges fiscales, la Babylonie connaît un grand marasme économique. Sa situation culturelle est aussi peu brillante : les Perses, accourus en grand nombre sous les règnes de Darios et de Xerxès, imposent dans les vallées du Tigre et de l'Euphrate les divinités iraniennes ; l'araméen, devenu la langue officielle de l'Empire achéménide, achève de supplanter le dialecte babylonien. La culture suméro-akkadienne ne survit que dans les cercles étroits des scribes et des savants.
En 331, Babylone, amoindrie, opprimée et appauvrie, acclame Alexandre le Grand, qui en fait la capitale de l'Asie et voudrait lui redonner sa splendeur ; mais il la délaisse pour d'autres conquêtes. De retour neuf ans après, il a tout juste le temps d'y mourir. Dès lors, Babylone continue à courir vers son déclin ; peu après 301, la fondation macédonienne de Séleucie du Tigre lui ravit son statut de capitale. Les Parthes, indifférents à son sort, la laissent décliner.
Au ier siècle avant J.-C., le géographe grec Strabon trouva le site désert.
ARCHÉOLOGIE
Les premières fouilles systématiques du site de l’antique Babylone ont été menées entre 1899 et 1917. La ville mise au jour date surtout de l’époque néobabylonienne. De plan rectangulaire, la cité du Ier millénaire avant J.-C. était parcourue de canaux reliés à l'Euphrate et entourée de fortifications colossales. Ouvrant la voie processionnelle, la porte d'Ishtar (reconstituée à Berlin) était la plus importante. D'autres monuments étaient célèbres dans l'Antiquité : ziggourat, jardins de la légendaire Sémiramis, palais et jardins de Nabuchodonosor, Esagil, ou grand temple du dieu Mardouk, qui couvrait une surface de 550 × 450 m. Les dimensions et proportions de ces édifices obéissaient aux règles rigoureuses des nombres sacrés.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Louis XVI |
|
|
| |
|
| |
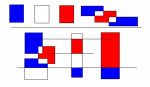
Louis XVI
1. DUC DE BERRY
1.1. UNE ENFANCE DANS L'OMBRE DU DUC DE BOURGOGNE
Le futur Louis XVI, d'abord titré duc de Berry, naît le 23 août 1754 de Marie-Josèphe de Saxe et du pieux Louis, seul fils de Louis XV, qui est la figure dominante du parti dévot à la cour de Versailles. Le duc de Berry est modestement fêté par la cour, car ses parents portent depuis février 1754 le deuil de leur deuxième fils, le petit duc d'Aquitaine.
À l'image de cette naissance effacée, l'enfance du futur roi se déroule dans l'ombre de son grand frère, le duc de Bourgogne, dauphin brillant, capricieux et autoritaire qui accapare tout l'amour de ses parents. Tout destine, en effet, le duc de Bourgogne à être roi. Le sort en décide autrement puisque le dauphin s'éteint à Pâques 1761, à l'âge de dix ans. Louis XV et les parents du dauphin ne se consolent pas de cette perte.
Le duc de Berry, désormais héritier direct du trône après son père, ne bénéficie pas pour autant d'un regain d'affection familiale ; surtout, il n’est pas éduqué comme il convient pour le préparer au métier de roi.
2. L’HOMME QUI N’ÉTAIT PAS FAIT POUR ÊTRE ROI
2.1. LE REFUGE DANS LA PRIÈRE ET DANS L'ÉTUDE
Il a vingt ans, l'âge des espérances, quand à travers la Cour retentissent les cris : « Le roi est mort, Vive le roi ! » Les courtisans le trouveront agenouillé, dans le refuge de la prière. Il y a là peut-être une des dimensions fondamentales du personnage. Dans un monde où il est de bon ton de railler une trop grande pratique religieuse et de tenir pour superstition ce qui est parfois quête sincère, Louis XVI est « austère et sévère ; il remplit exactement les lois de l'Église, jeûnant et faisant maigre tout le carême ». Pieux dans son cœur, il tolère les incartades de son entourage. Mais les voit-il toujours ? La qualité de sa foi ne le rend-elle pas plus étranger encore à un monde où tout l'a fait souffrir et qu'il a fui très jeune ?
Étranger, il l'est aussi par cette éducation qu'il reçut et le coupa du monde. L'un de ses précepteurs, l'abbé de Radonvilliers (1710-1789), lui a donné le goût de l'étude et il a tout seul acquis des connaissances étendues. « Il entend le latin et sait parfaitement la langue anglaise ; il connaît la géographie et l'histoire. » Mais, savant aimable et doux, son professeur n'a guère lutté contre cette peur que firent naître, peut-être, en lui les modèles qu'on lui donnait : Saint Louis, Louis XIV et cet aïeul, Louis XV, qui lui en imposait tant. À donner une décision, il se montrera tout le temps dans l'embarras.
Il a de ses ancêtres le solide appétit et l'amour de la chasse, dérivatif à ses velléités. Il mange et boit beaucoup, et « ses traits assez nobles empreints d'une teinte de mélancolie » s'empâteront trop vite. Et l'on rira de sa « démarche lourde », de sa mise négligée et du son aigu de sa voix.
2.2. BON PÈRE DE FAMILLE, PASSIONNÉ DE SERRURERIE
Puis il y a ce mariage (1770) avec Marie-Antoinette, cette princesse trop belle dont il ne saura que tardivement être l'amant. Il l'aimera profondément. « Quand elle lui parlait, raconte un témoin, dans ses yeux et dans son maintien il se manifestait une action, un empressement que rarement la maîtresse la plus chérie fait naître. » C’est en fonction des impératifs de sa politique extérieure, afin de renforcer l'alliance franco-autrichienne, que Louis XV avait décidé, sur le conseil de Choiseul, de marier le dauphin avec Marie-Antoinette, fille de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche.
La reine donna au roi un premier enfant, une fille, « Madame Royale », en 1778, puis un dauphin, qui mourut en 1789, enfin un autre fils, le futur Louis XVII, et une princesse qui mourut avant d'atteindre l'âge d'un an.
« Marie-Antoinette, c'est le seul homme de la famille », dira d'elle Mirabeau. L'ascendant qu'elle prit sur Louis XVI le retint à jamais d'exercer un métier, celui de roi, pour lequel il manifesta toujours de la répugnance. Désormais, il montrera « le goût le plus vif pour les arts mécaniques, pour la maçonnerie et la serrurerie ». Seul le bonheur que lui donnent ses enfants saura supplanter la joie qu'il y trouve. Il sut être un bon père, non pas un chef d'État que les circonstances réclamaient.
3. LES DÉBUTS DU RÈGNE : TURGOT OU L’INTROUVABLE RÉFORME FISCALE
3.1. LE PROBLÈME DE L'INIQUITÉ FISCALE
Ce gros homme, inconscient à demi du drame qui autour de lui se joue, n'est point arbitre entre les nobles et le tiers état levé pour sa dignité. Quand il sort de ses refuges, il est un aristocrate. Ce n'est pas passion partisane que de reconnaître ce fait dont il n'est qu'à moitié responsable et que toute sa vie proclame. Le Louis XVI qu'une hagiographie intéressée représente faisant l'aumône aux pauvres est aussi celui au nom duquel sont étranglés en place de grève ces hommes qui, lors de la guerre des Farines (1775), réclament un peu de pain pour que vivent leurs enfants.
Car la faim réapparaît dans les campagnes et les villes. La longue période de prospérité commencée quarante ans auparavant est, pour un temps, hachée de crises. En 1773 et 1774, les mauvaises récoltes font flamber les prix. Le petit exploitant en est le premier défavorisé, il n'a pas de surplus à vendre, et l'alimentation d'appoint qu'il doit acheter est hors de prix. Il restreint ses achats auprès des artisans, et ce manque à gagner oblige plus d'un maître à se séparer de ses compagnons. Quand la récolte est de nouveau abondante en 1781 et 1782, les prix s'effondrent et c'est le petit paysan qui en fait de nouveau les frais. Or, dans la France de l'époque, ses frères sont nombreux, et, dans les communautés rurales qu'ils forment, les conflits deviennent âpres avec le privilégié qui réclame les droits seigneuriaux, mais laisse ses gens payer seuls l'impôt.
3.2. LE PROJET DE TURGOT : RÉGÉNÉRER L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ
La question fiscale pousse le gouvernement monarchique, aujourd'hui comme hier, à la réforme ; mais cette réforme passe par une transformation de la société tout entière. Un homme semble l'avoir compris : Turgot. C'est cet homme de cinquante ans, qui s'est construit une solide réputation de bon administrateur quand il était intendant dans le Limousin, que Louis XVI choisit comme contrôleur des Finances, après avoir renvoyé le triumvirat Maupeou-Terray-d'Aiguillon et rappelé les parlements, mesures qui ont plu à l'opinion publique.
Avec Turgot, ce sont les économistes et les philosophes qui font leur entrée dans un poste clé de l'État. Il a un projet qui dépasse la seule amélioration de l'appareil financier de l'État : arrêter le gaspillage de la Cour, anéantir l'iniquité fiscale, mais aussi appeler l'ensemble des propriétaires qu'il affranchit des contraintes qui pèsent sur le marché à régénérer avec la royauté le corps politique.
LIBERTÉ DU COMMERCE
La dette exigible est de 220 millions. Pour la réduire, Turgot, reprenant la politique de Terray, refuse de faire de nouveaux impôts qui retomberaient une fois encore sur les plus déshérités. Il entreprend de contrôler les dépenses des principaux ministères et d'exiger partout l'économie. Au bout d'un an (1775), il réduit la dette de près de 20 millions.
Dans le même temps, il commence la réalisation de son vaste projet. D'abord permettre la multiplication des biens et l'enrichissement de la classe la plus utile du royaume : celle des propriétaires fonciers. Pour cela, il faut abolir les servitudes qui pèsent sur la production (suppression des corvées royales) et créer un vaste marché dans lequel s'établira le juste prix que le producteur est en droit d'attendre (liberté du commerce des grains). Cette liberté génératrice de progrès n'est pas seulement donnée aux propriétaires fonciers, l'artisanat se trouve aussi concerné par la suppression des corporations (jurandes).
ÉGALITÉ DEVANT L'IMPÔT
Mais la liberté qui est responsabilité touche aussi l'ordre social tout entier et le transforme. Dans chaque paroisse, une municipalité élue par les propriétaires fera comme d'autres assemblées consultatives (municipalités d'arrondissement et de province) « des sujets que l'on traitait jusqu'ici comme des enfants » des hommes qui coopéreront « comme des frères » et avec le roi à la bonne marche des affaires du pays. Les privilèges – et surtout les privilèges fiscaux – disparaîtront. Le gouvernement recevra une meilleure part de l'enrichissement général et sortira fortifié de la participation de citoyens dont la seule mesure sociale sera la propriété.
« Liberté, Égalité, Fraternité » : la patrie des possédants, des « hommes utiles », est-elle possible sans révolution ? C'est compter sans les aristocrates et sans les masses populaires. La conjonction de l'inconscience des uns et de la misère des autres va ruiner le projet. Mais celui-ci n'est-il pas mort-né ? Comment un gouvernement d'essence aristocratique pourrait-il survivre à une telle modification ?
3.3. LA DISGRÂCE DE TURGOT
LA GUERRE DES FARINES
Le fait historique, c'est la guerre des Farines(1775). La récolte est mauvaise, la liberté du commerce des grains gonfle encore leur prix, c'est-à-dire celui du pain. Des queues qui s'allongent à la porte du boulanger s'élève le murmure des femmes ; il gagne le foyer, la chaumière et l'atelier et se transforme dans la rue en émotion et en révoltes populaires. Le ministre du roi veut affamer le peuple ! Nobles d'épée ou parlementaires laissent dire ou attisent les propos de leur clientèle. Les marchés sont envahis, et les boulangeries saccagées. On arrête, on condamne et on tue les émeutiers. Le désordre s'installe. Paris et bientôt Versailles même reçoivent la visite des manifestants.
LA VERSATILITÉ DU ROI
L'ordre rétabli, un moment, Turgot poursuit son programme libéral, et la lutte se transporte au parlement. Menée par Jean-Jacques Duval d'Eprémesnil (1746-1794), la « robe » attaque les décrets sur la suppression de la corvée des routes et sur l'abolition des corporations. Elle fait au roi des remontrances. Celui-ci tente de briser l'opposition (lit de justice du 12 mars 1776), puis renonce sous les pressions conjuguées de la reine, des courtisans et des propres collègues de Turgot : dans le ministère, Maurepas s'inquiète de mesures auxquelles il répugne. Turgot est renvoyé (mai), la monarchie abdique.
LES RÉALISATIONS DE TURGOT
Le temps des réformes ne semble pourtant pas clos. Les innovations dont l'armée est le théâtre peuvent faire illusion : la suppression de la vénalité des charges, la création d'écoles militaires, la réforme de la milice, l'endivisionnement de l'armée, la discipline « à la prussienne », la dotation en machines de guerre modernes créent un instrument dont bénéficiera la future république.
Mais il y a aussi derrière tout cela l'action aristocratique qui pénètre et corrompt les transformations : le roi cherche à façonner un outil, l'aristocratie tend à le lui ravir en se réservant les postes de direction. Cette armée rénovée va servir à soutenir les insurgents américains (→ guerre de l'Indépendance américaine). L'entreprise enthousiasme la jeunesse libérale du royaume et elle compte de nombreux nobles dans ses rangs. Elle est un gouffre financier pour le Trésor royal (1778). Mais déjà Necker est là et le temps des faux remèdes commence.
4. DE NECKER À LA PRÉRÉVOLUTION
4.1. NECKER OU LE TEMPS DE L’ILLUSION
Choisi en 1776, le nouveau directeur général du Trésor royal, Necker, est un banquier, un protestant, un étranger. Il émerveille. On craignait la banqueroute, et il trouve de l'argent ; on disait les économies impossibles, et il semble les réaliser, car tout n'est qu'artifice.
Il abandonne les réformes fiscales et arrête le mécontentement de l'aristocratie. Les hommes éclairés le louent de mettre de l'ordre dans la complexité des droits perçus par la Ferme générale. La sensibilité du siècle est touchée par l'abolition de la « question préparatoire ». Il fait disparaître le servage sur le domaine du roi. Il ne rompt pas totalement avec l'expérience précédente, puisqu'il crée des assemblées provinciales des trois ordres. N'est-ce pas de nouveau une tentative d'association des élites au gouvernement monarchique ?
Mais n'est-ce pas de la poudre aux yeux ? Des historiens le soutiennent encore à notre époque ; ils font remarquer qu'il « élude en fait la question fiscale », qui est fondamentale, et, qu'ayant donné confiance, « il retourne à une politique systématique d'emprunts placés à des taux exorbitants auprès de banques amies » (G. Chaussinand-Nogaret). Il aidera ainsi le gonflement de la dette. La situation est malsaine ; le « compte rendu au roi » masque la réalité et fait croire pour longtemps à l'opinion publique qu'une bonne gestion a équilibré le budget (1781). Pourtant, une coalition s'est formée contre lui, et son « compte rendu » n'est qu'une manœuvre ou un dernier « coup d'éclat » contre elle. Elle rassemble les financiers traditionnels du roi ; les fermiers généraux, apeurés de voir le banquier genevois commencer à les éliminer ; les intendants qu'il a injustement attaqués, et, ennemis redoutables, les parlementaires inquiets des réformes judiciaires et administratives. De nouveau, Maurepas craint le prestige d'un rival. Il décide le roi à le renvoyer le 19 mai 1781.
4.2. J.-F. JOLY DE FLEURY ET LEFÈVRE D'ORMESSON
La conjoncture redevient favorable. De 1782 à 1787, la situation économique se rétablit. À l'extérieur, la France semble triompher de la Grande-Bretagne : la paix de Versailles (3 septembre 1783) assure l'indépendance des États-Unis, consolide la position française à Terre-Neuve, et les articles du traité de Paris (1763) relatifs à Dunkerque disparaissent. Le nouveau contrôleur des Finances, Calonne, saura, un temps, tirer avantage de cette situation.
Avant qu'il ne parvienne aux affaires, deux contrôleurs se succèdent encore à la tête des Finances : J.-F. Joly de Fleury (mai 1781-mars 1783) et Lefèvre d'Ormesson (avril-novembre 1783). Le premier recourt aux augmentations d'impôt et aux emprunts sans parvenir à combler le déficit. Il a le tort de ne pas le cacher et de demander des économies dont les courtisans risquent de faire les frais. Il est renvoyé.
Lefèvre d'Ormesson, jeune homme embarrassé de sa personne et qui ne prend jamais une décision sans consulter son maître, Vergennes, emprunte à la Caisse d'escompte. Le public, craignant l'appropriation par l'État de fonds privés, se presse en foule aux guichets pour retirer son argent.
Seconde maladresse : il cherche à transformer la Ferme générale en régie ; les fermiers réagissent en menaçant d'interrompre leur versement au Trésor. Ils soutiennent que son départ et son remplacement par Calonne sont nécessaires. Le roi n'aime guère ce dernier, mais une coterie se forme à la Cour autour des Polignac ; elle gagne finalement à sa cause la reine ; le roi cède.
4.3. CALONNE OU L’ÉCHEC ULTIME
LE RÉTABLISSEMENT DE LA CONFIANCE DANS L'ÉTAT
Avec Calonne, ce sont les financiers de Cour qui accèdent au contrôle. Titulaires d'offices qui les mettent à même de manier l'argent des impôts, ils confondent parfois leurs deniers avec ceux de l'État tout en sachant d'ailleurs l'aider quand la situation est difficile. Mais ces « capitalistes » ont la hardiesse d'investir leur argent dans l'industrie et le commerce, dont ils poussent la modernisation. C'est aussi le plan de Calonne : enrichir le pays pour que l'État puisse mieux trouver par l'impôt les espèces qui lui manquent. Mais l'État doit aider à cet enrichissement en drainant les capitaux et en les redistribuant aux commerçants et aux manufacturiers.
Avant tout, il faut emprunter : pour emprunter, il faut donner confiance. Calonne paye exactement les rentes venues à échéance. Puis il manœuvre pour que les emprunts d'État priment sur le marché. Il organise à cet effet une véritable publicité, Mirabeau étant son intermédiaire auprès de la presse. Il crée ainsi un courant à la hausse pour les valeurs d'État, tandis que baissent les valeurs concurrentes. Le ministre se fait agioteur : il s'entend avec les financiers qui placent l'emprunt dans le public : leur zèle est récompensé, le contrôleur aide leur spéculation. Enfin, le ministre reçoit de l'argent des détenteurs d'offices, des fermiers généraux, dont il perçoit un supplément de cautionnement. Ainsi, en trois ans, il réussit à rassembler 300 millions.
LES GRANDS TRAVAUX
Mais cette somme n'est pas, comme trop souvent jusqu'ici, utilisée pour des dépenses improductives. Elle aide l'œuvre de rénovation industrielle entreprise par des hommes soucieux de lutter à armes égales avec la Grande-Bretagne. Ainsi, l'État seconde les entreprises privées à la pointe du progrès technique : manufactures textiles ou sidérurgiques des Oberkampf, des Perier ou des de Wendel. L'État protège aussi les commerçants qui cherchent à évincer les Scandinaves dans le commerce français des matières premières pour la construction navale.
Toute une administration économique soutient l'activité des marchands et des fabricants. La réforme monétaire de 1785, rendue indispensable par la réévaluation de l'or, arrête la spéculation et débloque les espèces que les particuliers thésaurisaient. D'autres moyens sont en outre donnés pour que la production progresse. Les ports de la façade atlantique sont améliorés, et Marseille agrandit ses quais. La politique de construction routière commencée à l'époque de Louis XV est reprise et amplifiée. Les canaux de Bourgogne sont entrepris.
DERNIÈRE TENTATIVE : RETOUR AUX PLANS DE NECKER ET DE TURGOT
Mais la crise économique vient briser une expérience qui demandait du temps pour porter fruit. De nouveau, les difficultés ressenties par le monde agricole ralentissent la demande au secteur industriel, dès lors en crise. Un à un, les financiers qui travaillaient avec Calonne font faillite, et le crédit se contracte au moment où les impôts, étant donné la misère, rentrent mal.
Dans le même temps où l'État connaît de nouveau des embarras financiers, le scandale lié à l’affaire du Collier de la reine éclaire d’un jour cruel l'attitude équivoque des courtisans et ternit le prestige du roi et de la royauté.
Calonne, faute d'une hausse continue de la prospérité, doit retrouver les projets de ses prédécesseurs : l'égalité devant l'impôt, un impôt unique reposant sur toutes les terres, « la subvention territoriale ». On avait accusé Turgot de la projeter ; elle avait en partie causé sa perte. Calonne la reprend à son compte.
Mais l'homme est habile, et il sait qu'il aura contre lui le front des privilégiés, et que le parlement, en s'opposant à l'enregistrement des édits fiscaux, se fera leur porte-parole comme il l'a fait jadis sous le feu roi. Il commence par créer un courant d'opinion en sa faveur : aux paysans, il promet d'abolir les corvées et de diminuer la taille ; aux commerçants, de supprimer les douanes intérieures ; à l'élite, il promet la participation, par l'intermédiaire d'assemblées provinciales. Puis, pour tourner le parlement, il songe à réunir – comme Henri IV l'avait fait jadis –, une assemblée de notables. Les princes du sang encadreront des nobles, des membres du haut clergé, quelques représentants du tiers, tous triés sur le volet. Leur accord reçu, le roi s'en prévaudra pour faire appliquer le projet.
L'ÉCHEC DE CALONNE
Le calcul se révèle faux. Les notables réunis à Paris (22 février 1787) sont très vite sous l'emprise des courtisans hostiles à Calonne. Celui-ci, dépourvu de l'aide et des conseils de Vergennes, qui meurt quelques jours avant l'ouverture de l'assemblée des notables, commet la maladresse de présenter son projet en condamnant l'ordre existant. Traitant des causes profondes du malaise financier, il dénonce d'emblée « les abus des privilèges pécuniaires, les exceptions à la loi commune qui ne peuvent affranchir une partie des contribuables qu'en aggravant le sort des autres », il condamne « l'inégalité générale dans la répartition des subsides », il proteste contre « le déshonneur imprimé au commerce des premières productions », contre « les bureaux de traites intérieures et ces barrières qui rendent les diverses parties du royaume étrangères les unes aux autres », contre « les droits qui découragent l'industrie, ceux dont le recouvrement exige des frais excessifs et des préposés innombrables… ».
À travers son plaidoyer, c'est tout ce que la génération révolutionnaire va qualifier d'« ancien régime » qui est accusé. Prévenus contre le ministre, les notables voient leur crainte renforcée : n'est-ce pas leur position, leur prééminence sociale qui est en jeu ? L'ordre par excellence, le clergé, se sent directement menacé dans la possession de ses biens. Groupés autour de l'archevêque de Toulouse, Loménie de Brienne, les évêques contre-attaquent. Ils peuvent compter sur l'appui, du moins couvert, des propres frères du roi. Le comte de Provence, qui sera Louis XVIII, discrédite sa belle-sœur, projetant de faire déshériter un jour ses neveux. Le cousin du roi, le duc d'Orléans, croit en une monarchie à l'anglaise dont il serait le souverain.
D'autres coteries se forment ou se recréent. Il y a celle de Necker, qui agit « par vengeance, et dans l'espérance de le voir revenir en place » ; il y a celle de M. de Miromesnil, garde des Sceaux, « qui veut à toute force faire contrôleur général M. de Neville, sa créature » (Mémoires du baron J. de Besenval).
Calonne se tourne alors vers l'opinion publique. Imprimant tous les mémoires qu'il a remis aux notables, il l'informe que « le roi est arrêté dans le soulagement qu'il veut donner à ses peuples par ceux-là même qui devraient l'assister ». En vain. Le roi est troublé par l'opposition grandissante à Calonne. Il le renvoie le 8 avril 1787 et fait appel à celui qui est le chef de file de l'opposition, Loménie de Brienne.
« Le renvoi de Calonne fit apprécier le caractère du roi ; et, dès cet instant, les prétentions et la ténacité des notables n'eurent plus de bornes » (Besenval).
4.4. LOMÉNIE DE BRIENNE : LA RIPOSTE DU PARLEMENT
On a dit de l'archevêque de Toulouse qu'il « était l'égal de Calonne pour la moralité sans en avoir les talents, étant mieux à sa place dans un cercle de femmes qu'au timon des affaires : depuis vingt ans, il visait au ministère, et, dans l'assemblée des notables, dont il faisait partie, il n'avait combattu Calonne que pour le remplacer ».
Loménie de Brienne reprend les projets de l'homme qu'il a contribué à abattre ; il réclame un impôt territorial, un impôt du timbre, la suppression des corvées, la libre circulation des grains et des assemblées provinciales. Il n'obtient rien dans le domaine fiscal. On se décide à renvoyer l'assemblée qui venait ainsi de siéger durant trois mois (22 février-25 mai 1787). Brienne et le roi se retrouvent devant le parlement.
Celui-ci, de l'été 1787 au printemps 1788, se pose en champion des libertés du royaume. Habilement, les nobles de robe assortissent leur refus de la subvention territoriale d'une demande de convocation des états généraux, seuls aptes à voter les impôts nouveaux. Le 6 août 1787, l'enregistrement des édits a lieu de force, en lit de justice. Le lendemain, le parlement réuni proteste contre « la violence » qui lui a été faite. Le roi répond en exilant ses membres à Troyes. À travers la France, les autres parlements se déclarent solidaires, et le monde de la basoche (ensemble des notaires, avoués, huissiers), clientèle des magistrats, excite le peuple contre les agents de l'autorité royale. Devant l'ampleur que prend le mouvement, le roi rappelle le parlement, le 4 septembre 1787.
5. DE 1787 À 1789
5.1. L’OPPOSITION DU PARLEMENT
Mais il faut trouver de l'argent, et vite : l'impôt étant écarté, on en revient à l'emprunt. Pour obtenir cette fois l'enregistrement d'un édit prévoyant un emprunt de 420 millions, le gouvernement accepte de convoquer pour 1792 les états généraux. La séance royale où l'édit est présenté se transforme en lit de justice (19 novembre 1787). À la protestation du duc d'Orléans : « C'est illégal », le roi répond par le dernier cri de la monarchie absolue : « C'est légal, parce que je le veux. » Le duc est exilé en même temps que plusieurs conseillers. Puis le gouvernement prépare ce que certains appelleront son « coup d'État » : réduire le rôle du parlement.
DÉCLARATION DE GUERRE À LA MONARCHIE ABSOLUE
Mais les nobles de robe sentent la menace et de nouveau intéressent l'opinion publique à leur sort par des prises de position libérales : ainsi, le 4 janvier 1788, ils condamnent solennellement les lettres de cachet, dont l'emploi les menace directement. C'est surtout le 3 mai 1788 que leur déclaration a le plus de résonance. Ils attaquent les ministres et les accusent de vouloir instaurer le despotisme ; ils rappellent que « la France est une monarchie gouvernée par le roi, suivant les lois ; que ces lois… embrassent et consacrent le droit de la nation d'accorder librement les subsides par l'organe des états généraux, régulièrement convoqués et composés ; les coutumes et les capitulations des provinces ; l'inamovibilité des magistrats ; le droit des cours de vérifier, dans chaque province, les volontés du roi, et de n'en ordonner l'enregistrement qu'autant qu'elles sont conformes aux lois constitutives de la province, ainsi qu'aux lois fondamentales ; le droit de chaque citoyen, de n'être jamais traduit en aucune manière, par devant d'autres, que les juges naturels qui sont ceux que la loi lui désigne ».
Un mois après, l'assemblée du clergé, réunie pour fournir au roi un « don gratuit », prend fait et cause pour le parlement. Le haut clergé – car c'est lui qui tient la plume à ces remontrances au roi – souligne que « le peuple français n'est pas imposable à volonté. La propriété est un droit fondamental et sacré et cette vérité se trouve dans nos annales, quand même elle ne serait pas dans la justice et dans la nature… Depuis les premiers états généraux jusqu'à ceux d'Orléans et de Blois, le principe ne se perd jamais de vue que nulle imposition ne peut se lever sans assembler trois états et sans que les gens desdits états n'y consentent ». Nulle part, il n'est question de l'abolition des privilèges. Il s'agit pour les aristocrates de parvenir à réunir des états qu'ils domineront et qui seront un moyen de subjuguer la royauté. Mais les thèmes et le langage employé peuvent séduire le tiers ; liberté individuelle et liberté de consentir ou non l'impôt.
LES RÉFORMES TARDIVES DU ROI
Après s'être heurtée au refus du parlement de livrer ses meneurs, – d'Éprémesnil et Monsabert – la royauté tente de briser cette opposition aristocratique. En même temps qu'ils réduisent le parlement, les édits du 8 mai 1788 s'essayent à de profondes réformes. L'enregistrement des actes royaux sera désormais le fait d'une cour plénière formée de dignitaires de la couronne. Quarante-cinq « grands bailliages » reçoivent une partie des attributions judiciaires du parlement. L'organisation de la justice est simplifiée, rationalisée, et son exercice dépouillé de certains traits barbares comme la torture qui précédait l'exécution des criminels.
Pourtant cette réforme de Lamoignon, garde des Sceaux du roi, vient trop tard. Déjà, la province s'agite, mais, en prenant le relais de Paris, elle révèle que la bourgeoisie a, elle aussi, un programme de réformes et qu'elle n'entend pas être à la remorque des aristocrates. Encore est-elle prête à s'entendre avec eux, car elle craint les masses populaires que, apprenti sorcier, l'aristocratie a mises en branle dans l'été de 1788. La bourgeoisie accepterait le maintien des droits seigneuriaux et des privilèges honorifiques en échange de la liberté et de l'égalité politiques. Elle a fait l'apprentissage de celle-ci dans les assemblées provinciales, elle entend la maintenir lors des futurs états généraux. Mais ce compromis est-il possible ? Des notables comme Jean-Joseph Mounier ou Antoine Barnave, dans le Dauphiné, le croient. La parole va leur être donnée.
5.2. LA JOURNÉE DES TUILES
Durant l'été 1788, l'aristocratie pousse le peuple à la révolte ouverte pour soutenir le parlement. À Dijon, à Toulouse, à Rennes, à Pau et à Grenoble, des troubles éclatent. Dans cette dernière ville, les parlementaires refusent d'enregistrer les édits du 8 mai. Ils reçoivent des lettres de cachet. Le 7 juin, les boutiques se ferment, des hommes s'assemblent, ils sont armés de barres, de pierres, de haches et de bâtons. Beaucoup sont des « clients » des magistrats, car leur départ signifierait le ralentissement accentué des affaires. La troupe intervient. Du toit des maisons, des gens font pleuvoir une grêle de pierres, de briques et de tuiles. Cette journée des Tuiles aboutit au maintien des magistrats dans leur ville. Mais sept jours plus tard, les notables se réunissent : il y a là 9 membres du clergé, 33 nobles, 59 membres du tiers état. S'ils espèrent que les parlementaires seront réinstallés par le roi, ils demandent aussi la réunion des « états particuliers de la province », où les membres du tiers état siégeront en nombre égal à celui des membres du clergé et de la noblesse réunis. Cette assemblée sera le prélude à celle des états généraux du royaume.
5.3. LA DEMANDE DE CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX
Puis, le 21 juillet, à quelque distance de Grenoble, dans le château d'un gros industriel, Claude Perier, à Vizille, a lieu l'assemblée générale des municipalités du Dauphiné. Ecclésiastiques, nobles, tiers état mêlés arrêtent : « qu'empressés de donner à tous les Français un exemple d'union et d'attachement à la monarchie, prêts à tous les sacrifices – que pourraient exiger la sûreté et la gloire du trône –, ils n'octroieront les impôts par dons gratuits ou autrement que lorsque leurs représentants en auront délibéré dans les états généraux du royaume. Que dans les états de la province, les députés du tiers état seront en nombre égal à ceux des deux premiers ordres réunis ; que toutes les places y seront électives ; et que les corvées seront remplacées par une imposition sur les trois ordres ».
Ils arrêtent en outre « que les trois ordres du Dauphiné ne sépareront jamais leur cause de celle des autres provinces, et qu'en soutenant leurs droits particuliers ils n'abandonneront pas ceux de la nation ». Voilà qui dépasse le projet de l'aristocratie au début de sa révolte : il y a l'égalité politique, un premier pas de fait dans l'égalité fiscale, et surtout cette volonté d'échapper au cadre étroit des libertés provinciales pour s'élever jusqu'à la liberté de la patrie tout entière.
LE ROI CÈDE
Les caisses sont vides, les assemblées provinciales n'acceptent pas d'augmentation d'impôt, l'alliance semble se faire entre bourgeoisie et aristocratie, enfin les forces de répression échappent au roi. Tantôt les régiments (c'est le cas notamment de la cavalerie) sont dévoués à leurs chefs aristocrates, tantôt ils sont formés d'hommes sortis du peuple qui se rebellent contre la discipline indigne qu'on leur impose ou qui sont les victimes d'une réaction aristocratique qui leur bouche toute possibilité d'ascension sociale. Dans un cas comme dans l'autre, ils sont peu sûrs. Dans quelques mois, ils vont déserter en masse pour rejoindre le peuple en révolution.
N'étant plus maître de la situation, Brienne annonce la réunion des états généraux (5 juillet 1788), et un édit (8 août) les convoque pour le 1er mai 1789. Le même édit suspend la cour plénière. Le 24 août, Brienne se retire ; le 25, le roi appelle pour le remplacer Necker. La réforme de Lamoignon est abolie, les parlements rétablis. Mais si la royauté capitule, l'impossible alliance des aristocrates et de la bourgeoisie se défait.
5.4. LE « PARTI » DES PATRIOTES
Dès septembre 1788, le parlement signifie au tiers qu'il n'entend pas lui donner l'égalité politique demandée ; il estime en effet que les prochains états devront se réunir dans la forme qu'ils avaient en 1614 : les ordres séparés et chacun disposant d'une voix. Face aux aristocrates se forme alors le « parti » des patriotes.
Il groupe des bourgeois, surtout des banquiers ou des avocats, et des nobles libéraux. Quelques têtes s'en détachent : Mirabeau, La Fayette et surtout le duc d'Orléans. Il a à sa solde des publicistes, tel Pierre Choderlos de Laclos, qui répandent les idées du parti à Paris et en province : égalité civile, judiciaire et fiscale.
Dans l'immédiat, les patriotes se battent pour le doublement du tiers et le vote par tête et non par ordre aux états généraux. Des milliers de pamphlets ou de journaux circulent librement dans les salons, les sociétés de lecture et les cafés. Placardés dans les rues, ils suscitent le rassemblement et la discussion : les sujets du roi font mutuellement leur éducation politique et se découvrent, les uns les autres, membres solidaires d'une même communauté, des citoyens désireux d'établir la liberté et l'égalité, la fraternité qui leur procureront le bonheur.
Mais de cette « patrie », les nobles s'excluent en majorité ; s'accrochant à leurs privilèges, ils posent au roi la question : « Votre Majesté pourrait-elle se déterminer à sacrifier, à humilier sa brave, antique et respectable noblesse ? ».
Un premier coup semble lui être en effet porté le 27 décembre 1788 : le « Résultat du Conseil » du roi tenu à Versailles, ce jour, admet le doublement du tiers. En fait le principal est, pour l'aristocratie, sauvegardé : le roi ne se prononce pas sur le vote par tête. Le règlement électoral paraît le 24 janvier 1789.
6. LA RÉVOLUTION
6.1. ANTAGONISME ENTRE LES PRIVILÉGIÉS ET LE TIERS ÉTAT
La préparation des élections, leur déroulement ainsi que la rédaction des cahiers de doléances se font, dans beaucoup de régions, au milieu des émeutes du « quatrième ordre », celui des pauvres artisans ou paysans. Depuis 1778, le vin se vend mal. En 1789, les prix remontent, car la vendange a été insuffisante, mais le petit paysan n'a pas un contingent commercialisable, il reste dans la gêne. Dans le même temps, le prix du grain s'élève, mais la production du métayer n'est pas telle qu'il puisse en tirer profit. Dans les villes, le compagnon est souvent réduit au chômage ; la concurrence anglaise permise par le traité de 1786 accroît encore le malaise des fabricants français, notamment des textiles.
Des émeutes éclatent : c'est le cas à Paris, au faubourg Saint-Antoine, le 28 avril 1789. Des ouvriers prêtent au propriétaire d'une manufacture de papiers, Réveillon, l'intention de baisser les salaires de ses employés à 15 sous par jour. Malgré la force armée, la foule enfonce les portes et jette au feu registres de comptabilité, meubles et effets. La troupe tire, les émeutiers se dispersent (→ affaire Réveillon).
Il n'y a pas là le signe d'un affaiblissement de la fidélité à la monarchie. Les cahiers de doléances révèlent au contraire que, dans l'ensemble du corps social, c'est le loyalisme qui domine. Ils montrent aussi l'antagonisme entre les privilégiés et le tiers. De cette lutte, de jour en jour plus âpre, la brochure de Sieyès porte témoignage :
« Qu'est-ce que le tiers état ? Tout. La prétendue utilité d'un ordre privilégié pour le service public n'est qu'une chimère […] sans lui, tout ce qu'il y a de pénible dans ce service est acquitté par le tiers ; sans lui, les places supérieures seraient infiniment mieux remplies ; si les privilégiés sont parvenus à usurper tous les postes lucratifs et honorifiques, c'est en même temps une iniquité odieuse pour la généralité des citoyens et une trahison pour la chose publique. »
C'est la spécificité de la Révolution française que d'être cette lutte sans merci entre une aristocratie qui défend par tous les moyens ses « droits » et la bourgeoisie poussée en avant par les masses populaires. Dans ce combat, la monarchie peut-elle être d'un autre côté que celui de l'aristocratie ? À qui en doute, il faut rappeler la séance du 2 mai 1789, où les députés aux états généraux furent présentés au roi : il reçut le clergé à huis clos dans son cabinet, ceux de la noblesse, selon le cérémonial, les portes grandes ouvertes ; les représentants du tiers défilèrent dans sa chambre à coucher.
6.2. LA DÉCHÉANCE DU ROI : « LOUIS CAPET »
Le 5 mai, les états généraux s'ouvraient. Le règne de Louis XVI allait s'achever, celui du peuple souverain commençait. Avec la mise à bas de l'Ancien Régime et son retour de force de Versailles à Paris le 6 octobre 1789, le roi ne trouve plus la volonté politique suffisante pour affronter les événements. Louis XVI se replie sur la défense des principes de la monarchie de droit divin, ceux de son éducation, ceux que lui ont légués ses pères. Ses résistances et ses revirements ruinent le compromis institutionnel élaboré par la Constituante. Devenu monarque constitutionnel, le roi s'efforce, par l'application du veto, de freiner le mouvement révolutionnaire.
Prisonnier de sa famille et surtout de celle de Marie-Antoinette, il met finalement son espoir dans les émigrés (échec de la fuite à Varennes, juin 1791). Formant un ministère girondin, en mars 1792, le roi voit dans la guerre, pour des raisons inverses de celles des révolutionnaires, le moyen de sortir de la situation où il s'est enfermé. Mais le veto qu'il met aux décrets de salut public, après les premières défaites françaises, soulève contre lui le peuple de Paris. Le 20 juin 1792, les Parisiens envahissent les Tuileries, l'obligent à coiffer un bonnet rouge et à boire du vin à la santé de la Nation. Le peuple de Paris l'appelle dès lors « Louis le Dernier ».
L'insurrection du 10 août 1792, qui fait plusieurs centaines de morts, oblige le roi à se placer sous la protection de l'Assemblée. Le 13 août, le roi et sa famille sont emprisonnés au Temple. Le 21 septembre, la royauté est abolie, et Louis, désormais rétrogradé au rang de simple particulier et appelé du nom de Capet, est considéré comme « traître » à la nation.
Le 13 novembre, alors que la Convention examine le rapport de son Comité de législation sur l'éventuel jugement de l'ex-roi, Saint-Just présente les arguments pour une exécution sans jugement : « Les citoyens se lient par le contrat ; le souverain ne se lie pas, ou le prince n'aurait point de juge et serait un tyran. […] Le pacte est un contrat entre les citoyens […]. Conséquemment, Louis, qui ne s'était pas obligé, ne peut pas être jugé civilement. » Il se prononce pour la mort immédiate : « Il opprima une nation libre ; il se déclara son ennemi ; il abusa des lois : il doit mourir pour assurer le repos du peuple, puisqu'il était dans ses vues d'accabler le peuple pour assurer le sien. » La Convention ne le suit pas ; cependant, après la découverte par Roland des papiers personnels de Louis contenus dans l'armoire de fer, le 20 novembre, qui fournisse des pièces permettant d'étayer la trahison du roi, elle décide, le 3 décembre, de juger elle-même l'ex-roi.
6.3. LA MORT DU ROI
Le procès s'ouvre le 11 décembre. L'ex-roi est conduit à la Convention où il entend l'acte d'accusation dressé contre lui : organisation de la contre-révolution, conspiration, responsabilité dans le massacre du Champ-de-Mars et dans d'autres événements où des patriotes trouvèrent la mort, soutien de l'émigration…
Louis désigne comme avocat Tronchet et Target, mais ce dernier se récuse et Malesherbes s'offre à le remplacer. Puis, devant l'ampleur de leur tâche, les deux avocats s'adjoignent Romain Desèze.
Le 26 décembre, Louis est de nouveau entendu par la Convention. Desèze demande que l'ex-roi soit jugé en citoyen : « Prenez garde que si vous ôtiez à Louis l'inviolabilité de roi, vous lui devriez au moins les droits de citoyen ; car vous ne pouvez pas faire que Louis cesse d'être roi quand vous déclarez vouloir le juger, et qu'il le redevienne au moment de ce jugement que vous voulez rendre. Or, si vous voulez juger Louis comme citoyen, je vous demanderai où sont ces formes conservatrices que tout citoyen a le droit imprescriptible de réclamer. » Il présente ainsi une argumentation fondamentale sur la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, et s'écrie : « Je cherche parmi vous des juges, et je n'y vois que des accusateurs. Vous voulez prononcer sur le sort de Louis, et c'est vous-mêmes qui l'accusez ! »
Le 17 janvier, le procès s'achève sur le vote des députés. À la première question, « Louis est-il coupable ? », 694 députés sur 721 répondent oui. « Le peuple doit-il voter pour décider du sort de l'ex-roi ? » : 423 voix répondent non, contre 281 oui. Enfin, à la question « Quelle peine sera infligée à Louis ? », 361 députés sur 721 répondent la mort, soit une voix de majorité ; il faut cependant ajouter 26 députés qui se prononcent pour la mort tout en demandant si la Convention doit ou non faire différer l'exécution. Cette position entraîne un quatrième vote sur le sursis, qui est repoussé par 380 voix contre 310.
Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793, à 10 heures 20, sur la place de la Révolution (aujourd'hui place de la Concorde). La portée symbolique de cette mort dépasse de beaucoup la personnalité du roi : elle illustre la politique dite de la table rase, qui, de nos jours encore, suscite les interrogations des penseurs et théoriciens politiques de toutes tendances.
PLAN
*
* 1. DUC DE BERRY
* 2. L’HOMME QUI N’ÉTAIT PAS FAIT POUR ÊTRE ROI
* 3. LES DÉBUTS DU RÈGNE : TURGOT OU L’INTROUVABLE RÉFORME FISCALE
* 4. DE NECKER À LA PRÉRÉVOLUTION
* 5. DE 1787 À 1789
* 6. LA RÉVOLUTION
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
L'AFGHANISTAN |
|
|
| |
|
| |
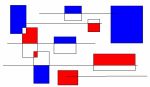
Afghanistan
DOCUMENT larousse.fr LIEN
État d'Asie centrale, l'Afghanistan est limité au nord par le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, au nord-est par la Chine, au sud-est par le Pakistan et à l'ouest par l'Iran.
* Superficie : 650 000 km2
* Nombre d'habitants : 30 552 000 (estimation pour 2013)
* Nom des habitants : Afghans
* Capitale : Kaboul
* Langues : dari et pachto
* Monnaie : afghani
* Chef de l'État : Ashraf Ghani
* Chef du gouvernement : Ashraf Ghani
* Constitution :
* Adoption : 4 janvier 2004
* Entrée en vigueur : 26 janvier 2004
Pour en savoir plus : institutions de l'Afghanistan
GÉOGRAPHIE
C'est un pays en majeure partie montagneux (surtout au nord : Hindu Kuch) et aride (souvent moins de 250 mm de pluies), ouvert par quelques vallées (Amou-Daria au nord, Helmand au sud). Au pied des reliefs, relativement arrosés, se sont développées les cultures céréalières et fruitières et implantées les principales villes (Kaboul, Kandahar, Harat). Le reste du pays est surtout le domaine de l'élevage, souvent nomade, du mouton. La culture du pavot (opium), officiellement interdite, demeure florissante. Les richesses minières du sous-sol (cuivre, lithium) semblent prometteuses. La population, islamisée, présente une grande diversité ethnique, avec des éléments appartenant au groupe iranien (Pachtouns [40 %] et Tadjiks [30 %]) et d'autres d'origine turque (Ouzbeks, Turkmènes, Kirghiz). Elle a gravement souffert, en même temps que toute l'économie du pays, de l'occupation soviétique des années 1980, et des divers conflits qui se sont succédé depuis.
1. LE MILIEU NATUREL
L'Afghanistan est un haut pays dont l'ossature est constituée par un axe montagneux médian qui, de direction ouest-est, à l'ouest (où il est scindé en trois faisceaux parallèles, séparés par les hautes vallées du Mourgab et du Hari Rud) et au centre (où il se soude en une masse unique, le Kuh-e Baba), se redresse dans l'Est (vers une direction S.-O./N.-E.), dans l'Hindu Kuch, qui va se fondre dans le nœud orographique du Pamir. Sur le versant nord de l'arc montagneux médian, les collines et les plaines de piémont du Turkestan afghan descendent jusqu'à 250-300 m d'altitude vers l'Amou-Daria, qui délimite la frontière avec le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Au sud-ouest, les cuvettes du Sistan, où se perd le Helmand, s'abaissent jusqu'à 460 m. La frontière avec le Pakistan est occupée par un autre axe montagneux (les chaînes du Paktia, 3 500 m), qui va se fondre à la hauteur du bassin de Kaboul (1 800 m) dans l'Hindu Kuch, dont le sépare au sud-ouest le fossé Kandahar-Ghazni. À l'est, la vallée de la rivière de Kaboul donne accès au Pakistan par le bassin de Djalalabad et la passe de Khaybar.
Le climat de ces hautes terres est très rude, extrêmement continental et en même temps fortement marqué par l'aridité, la plus grande partie du pays ne recevant guère que de médiocres pluies d'orages de printemps ou les dernières précipitations apportées par des dépressions hivernales d'origine méditerranéenne qui arrivent ici très effacées. Le Sud-Est reçoit seul les derniers effluves de la mousson indienne (pluies d'été qui constituent la majeure partie des précipitations jusque dans la région de Kaboul). Le total des précipitations tombe à moins de 100 mm par an dans le Sistan. Il se tient vers 200-400 mm sur les piémonts nord et sud des montagnes médianes et ne devient appréciable que sur les sommets de l'Hindu Kuch oriental, où il peut dépasser un mètre, et sur les chaînes du Sud-Est arrosées par la mousson. C'est là que se trouvent les seules véritables forêts du pays (étage inférieur de chênes et pins ; cèdres deodars en altitude), qui alimentent une exportation régulière et une contrebande active vers le Pakistan. Les montagnes centrales ne comportent, au-dessus des steppes à pistachiers des piémonts, qu'un étroit étage de forêts de genévriers (entre 2 000 et 2 700 m d'altitude, au-dessous de la steppe alpine), d'ailleurs presque complètement détruit aujourd'hui.
Trois décennies consécutives de guerre (depuis 1979) ont bouleversé la géographie économique et humaine de l'Afghanistan. Victime, en raison de sa situation géopolitique, du « grand jeu » entre les Britanniques et les Russes, puis entre les États-Unis et l'ex-U.R.S.S., le pays accuse un retard économique et social parmi les plus forts du monde.
2. LES POPULATIONS
Dans ce contexte aride, les montagnes médianes ont servi de refuge à des populations sédentaires, essentiellement de langue persane (parlée par environ le quart de la population du pays), qui s'y sont accrochées dans des terroirs irrigués de fond de vallée, aménagés en terrasses, et entourés de cultures pluviales sur les pentes, tandis que les piedmonts steppiques étaient submergés par des populations nomades lors des grandes invasions médiévales turco-mongoles. Mais l'axe montagneux a été d'autant plus imperméable au nomadisme qu'il était plus élevé et plus arrosé. Dans l'Est se sont maintenues des populations de langue darde (groupe intermédiaire entre les parlers indiens et iraniens), restées païennes (les Nurestanis ou Kafirs [infidèles]) jusqu'à la fin du xixe s., à côté des Tadjiks de langue persane qui y sont la population dominante, cultivateurs habiles et artisans, dans les bourgades et les villes (Kaboul) du piedmont. Les Tadjiks, qui constituent l'ancienne population aborigène persane, parlent un dialecte persan khorassanien (dari) ; ils sont sédentaires et détribalisés de longue date. Au centre, les Hazara, également de langue persane, ont subi une influence turco-mongole beaucoup plus prononcée, qu'ils ont assimilée linguistiquement, mais qui a laissé des marques dans le genre de vie (abris dérivés de la yourte comme habitats d'été). À l'O. (plus morcelé et plus sec), les Tchahar Aymaq (« les quatre tribus »), de langue également persane, mais franchement semi-nomades, ont été fortement influencés par la culture matérielle des nomades turcs. Sur le versant nord des montagnes médianes, ceux-ci ont totalement submergé les vieux agriculteurs autochtones du piedmont. Une importante minorité turcophone (15 à 20 % de la population totale du pays) se partage, dans ce qui est devenu le « Turkestan afghan », entre les deux peuples dominants de basse Asie centrale : Ouzbeks à l'E. et Turkmènes en cours de détribalisation à l'O.
Au sud des montagnes médianes, enfin, s'est individualisé le peuple des Pachtouns (ou Pathans), parlant une langue iranienne orientale (pachto), dont d'importantes fractions, à la suite du contrecoup des invasions médiévales, sont passées au nomadisme dans les déserts méridionaux et s'y sont organisées en grandes confédérations, Durrani au S. et la grande tribu nomade des Rhalzays (ou Ghalzays) qui estivent dans les montagnes centrales. Peuple dominant du pays, les Pachtouns ont été à l'origine de l'État afghan au xviiie siècle Abd-al-Rahman (1880-1901), puis ses successeurs, ont favorisé leur extension plus ou moins dans tout le pays, dans le but d'asseoir leur domination politique. Ils ont ainsi ouvert les hauteurs du Hazaradjat aux nomades du Sud comme pâturages d'été, puis ont installé dans le Turkestan d'importants groupes, nomades ou sédentaires.
Les principales minorités mixtes sont des Baloutches au S., des Kirghiz au N.-E., des Jats, des Kizil Bach, des sikhs, et des peuples dits « arabes ». La confession dominante est l'islam sunnite hanafite. Les Hazara et une partie de la population persane aborigène sont chiites duodécimains ou parfois ismaéliens. Les structures tribales sont généralement désagrégées, à l'exception des tribus pachtouns et, dans une moindre mesure, des Hazara. Le pouvoir politique traditionnel est assumé par le khan, ou mir, assisté d'un conseil tribal ou « des barbes blanches ». La propriété foncière est liée à celle de l'eau d'irrigation, les terres non irriguées étant collectives. La semi-nomadisation est répandue : réduite (campement d'été sur les champs en friche, assurant leur fertilisation) ou à moyenne et longue distance entre les pâtures de montagne, l'été, et les vallées, l'hiver. L'habitat d'hiver est généralement la maison de terre séchée à toit plat ou à dôme ; l'habitat d'été est, au N., la yourte mongole circulaire, au S., la tente noire de poils de chèvre (habitat unique des nomades). Les mariages interethniques sont rares ; les mariages entre cousins, ou mieux les mariages croisés, sont préférés en raison de la dot élevée. La monogamie domine. Avec 6,6 enfants par femme, le taux de fécondité du pays est l'un des plus élevés du monde, derrière celui du Niger. L'espérance de vie à la naissance, inférieure à 44 ans, est la plus faible du monde.
Turkmènes et Ouzbeks pratiquent de nombreux artisanats (tapis, feutre, métaux, etc.).
La répartition du peuplement opposait traditionnellement les piémonts du Nord aux terres méridionales, beaucoup moins peuplées. Mais les mouvements de population et le million de morts lié à la guerre avec l'Union soviétique ont contribué à la désertification de plusieurs régions : les régions frontalières du Pakistan et de l'Iran ont ainsi perdu plus de 80 % de leurs habitants, tandis que la région de Kaboul a connu une augmentation de 40 % de sa population.
3. LE SECTEUR AGRICOLE ET LE MONDE RURAL
L'Afghanistan constitue un cas extrême de sous-développement, qui s'explique en partie par l'isolement du pays, dû à la situation continentale, mais aussi au rôle d'État tampon entre les possessions russes et britanniques en Asie, qu'aucune grande puissance n'avait intérêt à ouvrir vers l'extérieur. C'est seulement depuis 1964 qu'un tunnel à travers le col du Salang, à plus de 3 000 m d'altitude, a permis la construction d'une route carrossable en hiver entre les deux versants de l'Hindu Kuch, et la route de rocade périphérique à revêtement stable qui fait le tour du pays n'est pas encore complétée au N.-O. L'Afghanistan, d'autre part, n'a pas de réseau ferroviaire.
Le secteur agricole occupe encore plus de la moitié de la population active et fournit le tiers du produit intérieur brut. Une des originalités de l'Afghanistan réside dans l'importance du nomadisme : environ 6 à 7 % de la population le pratique sur la quasi-totalité du territoire. Le nomadisme pastoral (moutons et chèvres), qui a longtemps dominé l'agriculture sédentaire, est aujourd'hui en net recul. Il n'aboutit pas toujours, cependant, à une sédentarisation mais se traduit, souvent, par la recherche de travaux saisonniers. Le reste de l'activité agricole se répartit entre les fonds de vallées et les oasis des piémonts. Ces dernières sont dépendantes, pour la plupart, de l'irrigation, qui y est très ancienne : on distingue les oasis à karez (galeries drainantes souterraines) des grandes oasis fluviales. La construction de barrages modernes (Dahla, Kadjakay, Darounta) ont permis une augmentation notable de la surface irriguée. La culture céréalière d'hiver (blé et orge) prédomine, tandis que le riz, le maïs et le coton (au nord) sont cultivés, l'été, lorsque l'eau est suffisante (ce qui n'est pas le cas de la majorité des oasis). Les fonds de vallées permettent une agriculture plus intensive, en terrasses irriguées, grâce à une pluviométrie plus importante.
4. LE SECTEUR INDUSTRIEL
Seulement le cinquième de la population afghane est urbaine. Kaboul, avec plus de 3 millions d'habitants, concentre la plupart des activités industrielles du pays. Les secteurs dominants sont l'agroalimentaire, le textile (coton) et les constructions mécaniques. L'artisanat (tapis, soieries, orfèvrerie, etc.) reste actif. La rivière de Kaboul, en aval de la capitale, permet son alimentation en énergie grâce à ses centrales hydroélectriques. Mais l'afflux de réfugiés (la ville ne comptait que 900 000 habitants en 1979) a profondément déséquilibré le réseau urbain en sa faveur. Le second pôle industriel du pays se trouve au nord, autour de Mazar-e Charif, qui comprend des usines chimiques (engrais) et textiles. Le sous-sol afghan ne recèle pas de pétrole mais possède un gisement de gaz naturel, au nord, dans le Turkestan afghan (Chebarghan). Les autres ressources minières sont très difficilement exploitables à cause du relief, mais elles semblent prometteuses (cuivre, lithium...). L'existence de lapis-lazuli dans le Badakhchan n'a guère qu'une importance symbolique, tandis que le charbon de l'Hindu Kuch, à l'est, produit environ 1 000 tonnes par an, une quantité négligeable. Le pays dispose d'un fort potentiel énergétique (électricité, gaz), encore inexploité.
L'état de l'économie afghane est catastrophique. Les exportations (gaz, fruits secs, dérivés du textile, peaux et cuirs) sont inférieures aux importations et le pays dépend largement de l'aide internationale et humanitaire. L'Afghanistan est redevenu en 2002 le premier producteur mondial d'opium. La culture du pavot a retrouvé le niveau record de la fin des années 1990, après avoir très fortement diminué sous le régime des talibans qui l'avaient interdite en 2000.
HISTOIRE
1. INTRODUCTION : UN CARREFOUR DE CIVILISATIONS
Situé au cœur de l'Asie, l'Afghanistan est le lieu de rencontre des nomades, Scythes, Huns, Turcs, Mongols, et des grandes civilisations sédentaires, souvent expansionnistes, d'Iran, de Chine et d'Inde. Des voies internationales, utilisées très anciennement, le traversent : la plus prestigieuse est la « route de la soie », qui évoque l'antique commerce entre la Chine et Rome ; d'autres, souvent des variantes de celle-ci, ont été, au cours des siècles, empruntées par les armées, les missionnaires et les commerçants. Aussi l'Afghanistan reçoit-il toutes les influences ; mais il ne se contente pas de les subir, il est un creuset et donne peut-être autant qu'il emprunte. Ainsi joue-t-il, par exemple, un rôle capital dans la diffusion du bouddhisme vers l'Est et de l'islam en Inde.
Relevant en définitive essentiellement du monde iranien, il ne forme un État qu'à une date récente ; pendant des siècles, il dépend de vastes empires, parfois créés par ses habitants, parfois les englobant seulement. De structure tribale, et ethniquement diversifié par les dépôts des invasions (turcophones et Mongols surtout), il professe néanmoins un nationalisme qui reflète le sens aigu de la communauté culturelle et l'amour des antiques traditions. Presque exclusivement musulman sunnite (→ sunnisme), il accorde une place essentielle au fait religieux.
2. DES ORIGINES À LA NAISSANCE DE L'AFGHANISTAN MODERNE
2.1. LES ARYENS
La préhistoire est encore mal connue. Les missions françaises ont cependant mis au jour, à Mundigak, sept niveaux de civilisation s'étageant du IVe millénaire aux alentours de l'an 500 avant J.-C. C'est à une époque indéterminée que les Aryens, venus de l'ouest, occupent le pays et fixent son ethnie de base.
DANS L'EMPIRE PERSE
Sous les Achéménides, l'Afghanistan, sans doute intégralement conquis par Cyrus, est divisé en cinq satrapies par Darios Ier. La pax iranica y règne pendant deux siècles, ce qui lui permet de participer au grand essor de l'Iran et de se laisser imprégner par la réforme religieuse de Zarathushtra.
CENTRE D'UNE CIVILISATION GRÉCO-BOUDDHIQUE
La conquête d'Alexandre (329 avant J.-C.) provoque, plus qu'ailleurs, une symbiose de la Grèce, de l'Iran et de l'Inde. Mais les satrapies subsistent et, à la mort d'Alexandre, entrent en lutte intestine. Les Séleucides, la dynastie indienne des Maurya et le royaume de Bactriane dominent tour à tour.
L'EMPIRE KUSHANA
À la fin du iie siècle avant J.-C., de nouvelles invasions aryennes amènent la prépondérance de la tribu kushana, qui atteint son apogée sous Kujula (en grec Kadphisês) au ier siècle après J.-C. et sous Kanishka au iie siècle. Malgré la présence d'autres courants religieux (autel du feu à Surkh Kotal), le pays se livre alors au bouddhisme (grand sanctuaire de Bamiyan). Son très grand essor est seulement freiné par le retour en force de l'Iran avec les Sassanides (iiie siècle) et les invasions des Huns Blancs ou Hephthalites (Turco-Mongols), qui font régner insécurité et oppression.
2.2. DES ARABES AUX SÉFÉVIDES
UNE LENTE ISLAMISATION
En 651 (conquête de Harat), les Sassanides sont vaincus par les armées arabes, qui occupent le pays. Elles se heurtent à une vive résistance qui empêche toute arabisation et rend l'islamisation fort lente : l'antique Kapisha (région de Kaboul) ne sera convertie qu'à la fin du ixe siècle, et, jusqu'au xiiie siècle, il subsistera de nombreuses principautés vassales ou indépendantes.
LES GHAZNÉVIDES
Dans le Nord, les Samanides, Iraniens originaires de Saman, près de Balkh, obtiennent la prépondérance. Les mercenaires turcs qu'ils recrutent amènent une ère nouvelle. En 962, l'un d'eux, Alp Tigin, se rend indépendant dans la région de Ghazni. Ses successeurs, et surtout Mahmud (999-1030), à la tête de la dynastie des Ghaznévides, étendent leur domination jusqu'à Ispahan et lancent dix-sept expéditions sur l'Inde. De Ghazni, rivale de Bagdad, ils font un centre remarquable, où brillent artistes et écrivains : parmi eux Ferdowsi (ou Firdusi), le poète national de l'Iran. Mais les Ghaznévides sont bientôt obligés de reconnaître la suprématie d'autres Turcs, les Grands Seldjoukides d'Iran, et disparaissent sous les coups de princes afghans, les Ghurides, qui se posent comme leurs héritiers : dès lors, Afghans et Turcs afghanisés fournissent princes et cadres des monarchies indo-musulmanes.
INVASIONS MONGOLES
Cette haute civilisation des xie et xiie siècles, égale à celle de l'Afghanistan bouddhique de jadis, sombre sous l'invasion de Gengis Khan, qui s'acharne particulièrement sur le pays (1221-1222).
LA RENAISSANCE TIMURIDE
Aux dévastations mongoles s'ajoutent celles de Timur Lang (Tamerlan), qui se fait couronner à Balkh en 1370 et est responsable, entre autres, de la ruine du riche système d'irrigation : le pays ne s'en relèvera jamais. Pourtant, autour de Harat s'épanouit la Renaissance timuride, commencée avec Chah Rokh (1405-1447) et conduite à son sommet par Hoseyn Beyqara (Husayn Bayqara) [1469-1506] et son ministre Mir Ali Chir Navai.
PARTAGÉ ENTRE L'INDE ET L'IRAN
L'Afghanistan oriental, enfermé sur lui-même, revient à l'actualité quand le Turc Baber s'installe à Kaboul (1504) et conquiert l'Inde, où il fonde la dynastie dite des Grands Moghols, mais il demeure pour ceux-ci une province lointaine, négligée. À la même époque, l'Afghanistan occidental passe aux mains des Séfévides d'Iran.
3. NAISSANCE DE L'AFGHANISTAN MODERNE
3.1. FONDATION DE LA PREMIÈRE DYNASTIE NATIONALE AFGHANE
La décadence moghole et l'affaiblissement des Séfévides, au début du xviiie siècle, rendent leurs libertés aux remuantes tribus afghanes et permettent la naissance de l'Afghanistan moderne, que préfigurent la révolte et la déclaration d'indépendance de Mir Veys (Mir Ways) [1707], chef de la tribu Ghalzay. Mais les Ghalzays doivent affronter le mouvement national de Nader Chah (ou Nadir Chah), qui prend Kandahar et Kaboul en 1738. Un officier de Nader, Ahmad Khan, de la tribu des Abdalis, se proclame roi à Kandahar dès que Nader Chah est assassiné (1747) et fonde la dynastie des Durrani, première dynastie afghane indépendante. Comme ses devanciers, il intervient à plusieurs reprises en Inde, et il constitue un royaume vaste mais instable. Son successeur, Timur Chah, qui transfère sa capitale à Kaboul, le garde en paix, mais, à sa mort, ses fils et ses féodaux se disputent sa succession (1793).
3.2. ENTRE LES IMPÉRIALISMES ANGLAIS ET RUSSE
Finalement, Dust Mohammad (Dust Muhammad), actif dès 1818, est reconnu émir à Kaboul (1838) et il fonde la dynastie des Barakzay (ou Muhammadzay). Renonçant aux provinces indiennes, il se consacre entièrement à l'Afghanistan, devenu État tampon entre les impérialismes anglais et russe. Tour à tour victime et bénéficiaire de l'intervention britannique, Dust Mohammad est, lors de la première guerre anglo-afghane (1839-1842), remplacé par Chodja al-Molk (Chudja al-Mulk) [1839], puis, à la suite d'une insurrection et de la destruction de l'armée anglaise d'Alexander Burnes (1842), il est replacé sur le trône mais contraint à subir un semi-protectorat.
La pression russe sur l'Asie centrale amène en 1878 l'Angleterre à une deuxième guerre afghane, et Abd al-Rahman (1880-1901) est obligé de reconnaître les frontières de la « ligne Durand » (1893). Les efforts de Habib Allah (1901-1919) et d'Aman Allah (1919-1929) pour sortir leur pays de son isolement sont annihilés par la volonté anglaise de le renforcer.
3.3. INDÉPENDANCE ET OUVERTURE
Seule la troisième guerre afghane, dite « guerre d'indépendance », consacre la pleine reconnaissance de la souveraineté de l'Afghanistan : armistice de Rawalpindi (8 août 1919), traité de Kaboul (22 novembre 1921).
Aman Allah entreprend la modernisation du pays : Constitution (1922), code administratif (1923), début de l'instruction féminine (1924) ; nouvelle Constitution (1928) ; il voyage en Europe et se fait nommer roi. La réaction conservatrice ne tarde guère. Le souverain est renversé et un aventurier, Habib Allah Khan, exerce pendant six mois une dictature sanguinaire.
Nader Khan (Nadir Khan), parent d'Aman Allah, abat l'usurpateur et se fait proclamer roi (1929). Instruit par l'expérience, il reprend avec prudence les réformes, mais n'en est pas moins assassiné en 1933. Son fils Zaher Chah (Zahir Chah) lui succède. De culture française et tout acquis aux idées nouvelles, il fait adhérer son pays à la Société des Nations (SDN) [1934], l'ouvre progressivement sur l'extérieur. En 1937, il signe le pacte de Sadabad avec la Turquie, l'Iran et l'Iraq, mais ne se laisse pas pour autant entraîner dans la Seconde Guerre mondiale.
3.4. PAUVRETÉ ET CONSERVATISME
Le retrait des Britanniques de l'Asie du Sud, avec l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, en 1947, laisse l'Afghanistan dans une situation économique catastrophique : l'isolement du pays, voulue par le Royaume-Uni, et son archaïsme politique freinent sa modernisation, mais sa position géostratégique de première importance suscite la mobilisation des organisations internationales, qui vont lui fournir une assistance considérable.
Cependant, l'URSS et les États-Unis cherchent à y étendre leur influence ; les Soviétiques, depuis le Tadjikistan voisin, envoient des conseillers dans les régions septentrionales, tandis que les Américains sont présents dans le sud du pays. L'aide internationale cumulée, de 1957 à 1977, s'est élevée à 1,7 milliard de dollars, faisant alors de l'Afghanistan le pays le plus aidé du monde, eu égard à ses potentialités : mais les rivalités américano-soviétiques empêchent toute concertation quant à l'efficacité du soutien apporté. De plus, le conservatisme du pouvoir, malgré une tentative de démocratisation du pays entre 1963 et 1973, bride les initiatives de décollage économique. La famille royale, s'appuyant avant tout sur les Pachtouns, s'enlise dans sa revendication du Pachtounistan face à son voisin pakistanais : le nouvel État issu de la partition de l'Inde comprend en effet, dans ses marges occidentales, des populations pachtounes également présentes du côté afghan.
La nouvelle Constitution (1964), approuvée par le roi Zaher, permet l'émergence de nouveaux partis, mais le Parlement est rapidement paralysé, tandis que les récoltes de 1970 et 1971 sont catastrophiques. L'échec de la monarchie, sanctionné par le coup d'État républicain (16-17 juillet 1973) dirigé par Mohammad Daud Khan, cousin et beau-frère du roi, avec le soutien de l'URSS, suivi par l'arrivée au pouvoir des communistes, s'explique avant tout par son attachement profond à ses privilèges et son refus de la modernité ; c'est aussi le fait d'une jeunesse aristocratique formée en Occident ou en URSS et déçue par l'immobilisme du gouvernement.
4. L'AFGHANISTAN DANS LA GUERRE (1978-2001)
4.1. L'ARRIVÉE DES COMMUNISTES AU POUVOIR
Un coup d'État communiste, le 27 avril 1978, met fin à la république de Daud Khan. Le leader du parti démocratique du Peuple (PDP), Nur Mohammad Taraki, prend le pouvoir, instaure une dictature d'obédience marxiste et permet à l'URSS – grâce à la signature d'un traité d'amitié et de coopération (décembre 1978) –, d'étendre davantage son influence sur le pays. La montée de la gauche s'était opérée dès les années 1960, mais elle restait profondément divisée en raison de rivalités personnelles et claniques. Babrak Karmal, du parti de gauche Parcham (le Drapeau), qui avait au départ soutenu le prince Daud Khan, est poussé par les Soviétiques de s'unir avec le Khalq (le Peuple), autre formation marxiste, pour former le PDP et renverser Daud Khan.
L'influence des communistes est directement liée à l'éducation de nouvelles couches de la population, qui demeurent exclues du jeu clanique et politique et qui voient le pays s'enfoncer dans une arriération économique : toutefois, leur prise du pouvoir provoque l'exil de plus de 100 000 personnes et ravive les tensions entre les factions au sein du PDP. Babrak Karmal, écarté par Nur Mohammad Taraki, finit par prendre le pouvoir grâce à l'intervention de l'armée soviétique en décembre 1979, après l'assassinat de celui-ci, puis de son successeur, Hafezollah Amin. Le pays sombre alors dans une double guerre : la lutte contre l'Armée rouge, qui dure jusqu'en 1989, et la guerre civile, qui continue de déchirer le pays, malgré la profonde évolution de sa nature et de ses finalités sur les deux décennies.
4.2. L'INTERVENTION SOVIÉTIQUE (DÉCEMBRE 1979-1988)
LES MOUDJAHIDIN
Les raisons de l'intervention soviétique restent encore obscures. C'est sans doute en partie pour protéger ses nombreux ressortissants – dont une partie avait péri lors de massacres perpétrés par l'opposition islamiste – que l'Union soviétique décide d'envoyer l'Armée rouge. Le pouvoir est très vite assimilé au parti de l'étranger, et l'opposition (les moudjahidin) s'organise sur des bases claniques, ethniques et religieuses ; les Hazara (chiites), dans l'Ouest et le Centre, reprennent rapidement le contrôle de leur région ; les sunnites forment la majorité de la population.
L'ENLISEMENT DE L'INTERVENTION SOVIÉTIQUE
Contestée par une grande partie de la communauté internationale, l'armée soviétique s'enlise dans une « sale guerre » : elle est dépourvue de la logistique adéquate pour faire face à une guérilla mieux entraînée qu'elle au climat et au relief hostiles, et ne parvient pas à mobiliser la population soviétique pour envoyer au front sa jeunesse au nom d'une idéologie en déclin. L'intransigeance des dirigeants de l'URSS– malgré les demandes réitérées de l'ONU de retirer les troupes soviétiques – et l'importance des enjeux internationaux conduisent à une impasse de laquelle Mikhaïl Gorbatchev tente de sortir, dès son arrivée au pouvoir en 1985.
L'INGÉRENCE DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES
Les États-Unis concentrent leur aide, par l'intermédiaire du Pakistan et avec le soutien actif de l'Arabie saoudite, vers les sunnites pachtouns, tandis que l'Iran chiite, qui vient d'achever sa révolution islamiste, soutient les Hazara. Dans ce contexte d'anarchie, le gouvernement de Babrak Karmal ne parvient pas à imposer son régime, et ses réformes brutales envers les paysans ne font que renforcer l'opposition. Parallèlement, des centaines de milliers d'Afghans émigrent vers le Pakistan, l'Iran et l'Occident.
LES ACCORDS DE GENÈVE (AVRIL 1988) ET LE RETRAIT DES TROUPES SOVIÉTIQUES (FÉVRIER 1989)
En mai 1986, l'échec de Babrak Karmal est patent et conduit à son remplacement par Mohammad Nadjibollah : celui-ci lance en 1987 un appel à la « réconciliation nationale » et fait adopter en novembre une Constitution qui n'a plus rien de socialiste. Le 14 avril 1988, un accord est signé, à Genève, entre le Pakistan, l'Afghanistan, les États-Unis et l'URSS. Il prévoit, outre le retrait sur neuf mois des troupes soviétiques du territoire afghan, des accords bilatéraux avec le Pakistan, garantissant l'intégrité politique de l'Afghanistan vis-à-vis de son voisin et formulant les modalités de retour des réfugiés.
4.3. LA GUERRE CIVILE
Mais le départ des troupes de l'Armée rouge est loin de mettre fin à la guerre civile, sur laquelle la présence soviétique jetait un voile, cachant la complexité des alliances et des divisions. La fracture entre nationalistes et communistes, vive durant l'occupation soviétique, s'estompe pour laisser place à des rivalités entre fondamentalistes islamistes, dirigés par Gulbuddin Hekmatyar, et modérés. Ces divisions sont la principale raison de la chute tardive du gouvernement de Mohammad Nadjibollah (16 avril). Après le départ des Soviétiques, celui-ci, en effet, ne contrôle que les grandes villes, alors que l'opposition des moudjahidin tient les campagnes. L'intervention de l'ONU, qui œuvre pour un règlement politique du conflit, l'engagement de l'URSS et des États-Unis d'arrêter leurs livraisons d'armes ne pourront empêcher la prise de Kaboul par l'opposition. Le régime tombe le 29 avril 1992.
L'ÉTAT ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN
Cette victoire est cependant loin de mettre fin à la guerre civile : le factionalisme de l'opposition prend la forme d'une rivalité ethnique, selon la division classique entre Tadjiks du Nord, regroupés au sein du Djamiat-i Islami et dirigés par le commandant Ahmad Chah Masud, et Pachtouns du Sud, rassemblés autour du Hezb-i Islami et menés par Gulbuddin Hekmatyar. L'accord de Peshawar permet la création d'un État islamique d'Afghanistan le 28 avril 1992. Mais, si les ethnies du Nord obtiennent, par l'intermédiaire du commandant Masud, le ministère de la Défense du gouvernement intérimaire dirigé par Sibghbatollah Modjaddedi, les forces de G. Hekmatyar reprennent le combat durant l'été. La confirmation de Burhanuddin Rabbani, en décembre, au poste de président de la République islamique d'Afghanistan n'empêche pas une nouvelle « bataille de Kaboul » au début de l'année 1993. L'accord de paix signé en mars à Islamabad maintient B. Rabbani à son poste, tandis que G. Hekmatyar devient Premier ministre.
L'AVANCÉE DES TALIBANS
L'apparition des talibans, à l'automne 1994 dans la région de Kandahar, reste mystérieuse. Regroupés autour du mollah Omar, ils ne se distinguaient pas des autres mouvements anticommunistes durant l'invasion soviétique, mais leur présence était déjà attestée.
Soutenus par le Pakistan, qui joue un rôle prépondérant dans leur entraînement, ces étudiants de madrasa, majoritairement d'ethnie pachtoune, se réclament d'une idéologie ultrafondamentaliste prenant sa source dans l'école de Deoband, en Inde, qui prônait à la fin du xixe siècle un retour à l'islam pur afin de lutter contre l'influence de l'hindouisme.
Les talibans réussissent rapidement à prendre le contrôle du sud du pays. Leur succès n'est pas tant lié à leur force militaire qu'à un réel soutien de la population qui, lassée par vingt années de guerre, voit en eux une possible pacification du pays. Les talibans rétablissent effectivement l'ordre dans les régions qu'ils contrôlent, grâce à une application très stricte de la charia, mêlée à une pratique scrupuleuse des coutumes rigoristes pachtounes.
La prise de Mazar-e Charif, bastion de l'opposition du général Rachid Dostom, puis celle de Bamiyan, contrôlée jusqu'alors par les chiites, au cours de l'été 1998, permet aux talibans d'étendre leur conquête, facilitée par l'incapacité de l'opposition de s'unir : tout sépare en effet le général ouzbek R. Dostom des chiites de Karim Khalili et du Tadjik Masud.
En mars 1999 cependant, un accord intervient entre les forces d'opposition afghanes : le commandant Masud, à la tête de l'Alliance du Nord, a désormais la tâche de conduire toutes les opérations militaires contre les talibans. Mais ces derniers, après une succession de victoires militaires importantes (prise, notamment, de Taloqan), contrôlent la quasi-totalité du pays en septembre 2000.
À partir de 1999, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte une série de sanctions votées à l'initiative des États-Unis à l'encontre des talibans afin d'obtenir l'extradition d'Oussama Ben Laden, d'origine saoudienne, tenu pour être le principal instigateur des attentats contre les ambassades américaines de Dar es-Salaam (Tanzanie) et de Nairobi (Kenya) en août 1998.
Par ailleurs, les conditions de vie déplorables imposées aux femmes (privées d'éducation et exclues du monde du travail) contribuent à propager à l'étranger une image passablement ternie du régime des talibans. En mars 2001, l'application d'un décret ordonnant la destruction de toutes les statues du pays, incluant les bouddhas de Bamiyan, site majeur de l'art pré-islamique en Afghanistan, provoque de vives protestations dans le monde, y compris dans des pays alliés, le Pakistan et l'Arabie saoudite.
4.4. LA GUERRE D'AFGHANISTAN ET LA CHUTE DES TALIBANS
La mort du commandant Masud (9 septembre 2001), victime d'un attentat probablement commandité par al-Qaida, suivie par les attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington, provoquent un renversement rapide de la situation en Afghanistan.
Le président G. W. Bush lance immédiatement un ultimatum aux talibans, les enjoignant de livrer Ben Laden et le mollah Omar dans les plus brefs délais. Faute de réponses convaincantes, les États-Unis décident d'intervenir militairement en Afghanistan après s'être assurés du soutien du Pakistan – particulièrement impliqué dans la problématique régionale – et de celui de l'Ouzbékistan, susceptible de servir de base arrière aux troupes américaines. La Russie, la Chine, l'Iran et, afin d'éviter tout risque de dérapage au Proche-Orient, l'ensemble des États arabes, sont également consultés.
Opération « Liberté immuable », Afghanistan, 2001
Le 7 octobre débute l'opération « Liberté immuable » avec le soutien des Occidentaux. Les frappes « ciblées » de l'armée américaine (épaulée par les Britanniques), permettent une avancée rapide des troupes de l'Alliance du Nord, qui reconquiert, le plus souvent sans combattre, villes et villages abandonnés par les talibans (libération de Kaboul en novembre). Défaits, ces derniers, soit se replient dans quelques bastions, dont la région de Tora Bora, où les bombardements s'intensifient, soit se regroupent dans la vallée de Shawal, dans le Nord-Waziristan pakistanais.
4.5. LE PROCESSUS DE BONN (2001-2005)
UN GOUVERNEMENT INTÉRIMAIRE
Alors que la traque des terroristes se poursuit en vain (ni Ben Laden, ni le mollah Omar n'ont été capturés), le 27 novembre s'ouvre à Bonn une conférence interafghane destinée à organiser l'après-talibans.
Un accord intervient le 5 décembre. Il prévoit la création d'un gouvernement intérimaire, sous la direction d'un proche des États-Unis, le Pachtoun Hamid Karzai, et la tenue d'une assemblée traditionnelle ou Loya Djirga, afin de désigner un chef de l'État provisoire et de préparer la mise en place d'une Assemblée constituante. De retour dans son pays (avril 2002), après vingt-neuf années d'exil, l'ex-roi Zaher Chah convoque la Loya Djirga qui plébiscite, en juin, H. Karzai à la tête de l'exécutif afghan pour une période de dix-huit mois. Ce dernier entre en fonction après avoir présenté le nouveau gouvernement, au sein duquel de nombreux seigneurs de la guerre reviennent en force.
En dépit de la mise en place (décembre 2001) de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) sous mandat de l'ONU dans la capitale et ses environs – le reste du pays demeurant de la compétence des forces américaines et de leurs alliés afghans –, l'insécurité prévaut (assassinat des ministres de l'Aviation civile et des Travaux publics en février et en juillet 2002 ; tentative d'assassinat d'H. Karzai en septembre 2002). À la veille de l'ouverture de la Loya Djirga qui doit décider de la future Constitution, le mandat de la FIAS, placée sous commandement de l'OTAN depuis août 2003, est élargi au-delà de Kaboul et renouvelé pour un an.
UNE NOUVELLE CONSTITUTION
Le 4 janvier 2004, au terme de difficiles tractations, les 502 délégués de la Loya Djirga approuvent une nouvelle Constitution, qui institue une république islamique (sans proclamation de la charia) à régime présidentiel fort, néanmoins tempéré par l'institution de deux vice-présidents élus sur le même ticket que le président. Elle ouvre la voie à l'organisation d'élections initialement prévues en juin 2004, mais reportées au 9 octobre compte tenu des difficultés à établir des listes d'électeurs, des menaces des talibans et de l'insécurité qui domine dans le sud et le sud-est du pays.
Après avoir écarté en juillet de son ticket, comme l'y invitaient les États-Unis, le puissant ministre de la Défense et vice-président Mohammad Fahim, H. Karzai est élu avec 55,4 % des suffrages contre 16,3 % à son rival immédiat, l'ancien ministre et leader de l'ex-Alliance du Nord, le Tadjik Yonous Qanooni. En décembre, H. Karzai nomme un nouveau gouvernement dont sont exclus la plupart des chefs de guerre.
Point d'orgue du processus de Bonn, les élections législatives et provinciales du 18 septembre 2005, les premières depuis 1969, sont marquées par un taux de participation de 50 % (inférieur à 30 % dans les régions pachtounes). Le nouveau Parlement bicaméral comprend la Chambre haute, composée de 102 membres élus par les collectivités locales et de personnalités nommées par le président, et la Chambre basse, dont les 249 députés sont, pour moitié d'entre eux, d'ex-moudjahidin, 68 sièges y étant réservés aux femmes.
5. VERS UNE STABILISATION (2005-2015)
Si le processus de Bonn semble s'être achevé avec succès, des défis majeurs attendent les nouvelles autorités afghanes pour une stabilisation complète du pays. À peu près réussie dans la région de Kaboul, la mise en place de l'administration est quasi inexistante dans le reste du territoire, État de non-droit où sévit une insécurité grandissante en raison essentiellement de la résurgence des talibans.
5.1. LA RÉSURGENCE DE L'INSURRECTION DES TALIBANS ET LA MENACE D'AL-QAIDA
Chassés du pouvoir fin 2001, les talibans, radicalisés, réinvestissent peu à peu leurs anciens bastions avec l'aide des populations pachtounes, des fondamentalistes du Pakistan, et des djihadistes d'al-Qaida. Dans les provinces du Sud essentiellement pachtounes où ils bénéficient de solidarités religieuses et tribales fortes, les talibans mettent à profit l'incurie et la corruption des autorités issues des élections pour recruter de nombreux jeunes dans leurs rangs. Ce ralliement leur est d'autant plus aisé que la désillusion est grande au sein d'une population déçue de ne voir se réaliser aucune des promesses annoncées par la communauté internationale en 2001 et heurtée par les nombreuses bavures des forces de la coalition internationale (en 2007, au moins 1 633 civils ont été tués, dont 321 par des bombardements). Formée dans les madrasas qui se sont multipliées dans les FATA (Federally Administred Tribal Areas) ou « zones tribales » pakistanaises le long de la frontière avec l'Afghanistan, cette génération de néo-talibans bénéficie de l'aide financière, technique et stratégique des djihadistes d'al-Qaida. L'organisation d'Oussama Ben Laden, mise en déroute par l'alliance de la guérilla sunnite irakienne avec l'armée américaine à Bagdad, a elle-même trouvé refuge à la frontière afghano-pakistanaise, grâce à la complicité des services secrets pakistanais (ISI) et à l'ambivalence du général-président Pervez Mucharraf. En reconstituant leurs forces dans le sanctuaire pakistanais, les talibans afghans inspirent même la création d'un mouvement taliban pakistanais.
5.2. UNE INSÉCURITÉ CROISSANTE
À partir du printemps 2006, les talibans afghans forment avec les djihadistes d'al-Qaïda, les fidèles de l'ancien Premier ministre G. Hekmatyar et les tribus pachtounes une coalition d'insurgés. Multipliant les opérations de guérilla contre la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS), les forces de sécurité afghanes, les relais du gouvernement ou les acteurs de développement, ils parviennent rapidement à reprendre le contrôle des zones rurales dans la plupart des régions pachtounes et ont pour objectif l'encerclement de Kaboul. À partir de 2005, ils commettent leurs premiers attentats suicide puis des assassinats de personnalités politiques ou de représentants de la société publique, des prises d'otages et des enlèvements d'étrangers. Leurs attaques deviennent particulièrement meurtrières à partir de l'automne 2007 (75 morts à Pol-e-Khomri, dont 59 enfants et 6 parlementaires ; 100 morts dans la province de Kandahar, le 17 février 2008). Le nombre de pertes enregistrées par la FIAS malgré son renforcement (50 000 hommes en 2008, dont un tiers d'Américains), dépasse – pour la première fois en 2008 depuis le déclenchement des deux guerres – celui des pertes subies par la coalition internationale en Iraq.
Toutefois, la population civile afghane paie le plus lourd tribut à l'insurrection (1 600 morts en 2005, 4 000 en 2006, près de 6 000 en 2007). Elle subit en outre une grave détérioration de ses conditions de vie en raison de l'augmentation du prix des produits de première nécessité et du risque de pénurie alimentaire, de conditions climatiques rigoureuses (désertification croissante, plus de 1 000 morts lors de l'hiver 2008). Enfin, elle ne bénéficie pas de l'aide internationale.
5.3. UNE AIDE INTERNATIONALE « GASPILLÉE, INEFFICACE ET NON COORDONNÉE »
Promise depuis 2001 et destinée à la reconstruction (90 % des dépenses publiques de l'État), l'aide internationale s'avère insuffisante et inefficace.
Bien que les besoins du pays demeurent immenses, la distribution de l'aide internationale est inéquitable, mal ciblée ou dilapidée par une corruption endémique. Sur 25 milliards de dollars d'aide promise, 10 milliards n'ont pas été versés. Par ailleurs, l'aide destinée au financement de projets civils est largement inférieure à l'assistance liée à la sécurité telle que la formation de l'armée nationale afghane (ANA) et de la police nationale. Or la première, dont les effectifs croissent régulièrement pour atteindre 80 000 soldats en 2008, demeure inopérationnelle faute de moyens logistiques ; la seconde – 60 000 hommes formés en 2008 – est rongée par la corruption.
Alors que le pays enregistre d'incontestables progrès (accès plus larges à la santé et à l'éducation grâce notamment à la construction d'hôpitaux, d'écoles et de routes), il continue, malgré les coûteux programmes de lutte contre la drogue lancés par la communauté internationale, de battre des records de production d'opium (8 200 tonnes en 2007, soit une progression de plus de 30 % en un an et la quasi-totalité de la production mondiale) et de cannabis, la drogue représentant plus de la moitié de son PIB.
Adopté en janvier 2006 lors de la conférence internationale de Londres sur l'aide à l'Afghanistan, un nouveau « Pacte pour l'Afghanistan », prenant le relais du processus de Bonn, précise les modalités de la coopération entre l'Afghanistan et la communauté internationale jusqu'en 2010, encadrée par la Mission d'Assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA).
5.4. CHANGEMENTS DE STRATÉGIE
Les difficultés rencontrées par les troupes de l'OTAN face à la recrudescence des attaques des insurgés relancent la question de la stratégie des Occidentaux en Afghanistan.
Réunie le 12 juin 2008 à Paris à la demande des autorités afghanes, la Conférence de soutien à l'Afghanistan marque de la part de la communauté internationale l'amorce d'un changement notable de stratégie, perceptible dans l'octroi de nouvelles aides financières (promesse d'environ 20 milliards de dollars), dans l'annonce d'un mandat « renforcé » de la MANUA, mais surtout dans l'abandon de la stratégie du « tout militaire » au profit d'un investissement massif sur le terrain civil.
De leur côté, les autorités afghanes définissent une Stratégie nationale de développement pour l'Afghanistan (ANDS) pour la période 2008-2013, dans laquelle elles expriment le souhait de définir elles-mêmes leurs propres besoins et d'être davantage associées à la gestion de l'aide internationale. Dans cet esprit d'« afghanisation de la paix », H. Karzai lance avec l'aide de l'Arabie saoudite une offre de dialogue au mollah Omar en septembre. Celle-ci, toutefois, demeure sans succès. En revanche, l'arrivée au pouvoir au Pakistan d'Asif Ali Zardari (élu le 8 septembre), succédant à Pervez Mucharraf contraint à la démission en août, permet d'espérer l'ouverture d'une ère nouvelle dans les relations afghano-pakistanaises.
Les États-Unis pour leur part, après avoir pris conscience que le front central de la guerre contre al-Qaida ne se situe pas en Iraq mais au Pakistan et en Afghanistan, décident également de revoir leur stratégie. À partir de janvier 2009, le nouveau président américain, Barack Obama, place l'axe afghano-pakistanais au cœur de ses priorités. Cette approche « régionale » du dossier afghan reçoit le large soutien de la communauté internationale lors de la conférence internationale sur l'Afghanistan (La Haye, mars), mais bute sur des intérêts nationaux divergents, voire antagonistes, en particulier entre l'Inde et le Pakistan. Ce dernier, lui-même déstabilisé sur son propre territoire et allié des États-Unis mais dont l’armée et services secrets militaires (ISI) sont en même temps suspectés de double jeu, affiche officiellement sa volonté de lutter en collaboration avec Kaboul contre le « terrorisme ». De son côté l'Inde, craignant surtout un retour au pouvoir des talibans dans le cadre d’une alliance avec Islamabad à la recherche d’une « profondeur stratégique », resserre également ses liens avec le gouvernement Karzai par d’importants investissements dans la reconstruction du pays.
5.5. LA RÉÉLECTION DE H. KARZAI ET LE « PROCESSUS DE KABOUL »
Malgré les opérations d’intimidation des talibans (dont l’attentat contre le siège de la FIAS au cœur même de Kaboul), les élections présidentielle et provinciales se tiennent en août 2009. Mais la fraude massive avérée conduit à un recomptage des voix et ce n’est qu’après le retrait de son rival, Abdullah Abdullah – ex-ministre des Affaires étrangères limogé en 2006 et ancien proche du commandant Masud – que H. Karzai est finalement officiellement proclamé en novembre vainqueur de ce scrutin très contesté, avec moins de 50 % des suffrages.
Prenant notamment en considération l’engagement du gouvernement à lutter contre la corruption, la conférence internationale réunie à Kaboul (juillet 2010) confirme la décision adoptée à Londres en janvier de canaliser sur deux ans 50 % de l’aide internationale à travers le budget national et de l’aligner progressivement sur les « programmes de priorité nationale ». Elle approuve également l'objectif du gouvernement afghan d'assumer la sécurité du pays à partir de 2014 et appuie la ligne fixée en juin à l’occasion d’une « Loya Djirga pour la paix » prévoyant en particulier l’ouverture de négociations avec les insurgés qui renonceraient à la violence.
Parallèlement, tout en maintenant la date de juillet 2011 pour le début du retrait de leurs forces, les États-Unis – qui rapatrient au même moment leurs troupes combattantes d’Iraq – renforcent leur dispositif militaire en Afghanistan. Avec 30 000 soldats supplémentaires, l’engagement américain doit ainsi atteindre environ 90 000 hommes sur les 130 000 de la FIAS dont le commandement est par ailleurs confié, à partir de juillet, au général David Petraeus considéré comme le « pacificateur » de l’Iraq.
En septembre, alors que le président H. Karzai propose une nouvelle offre de dialogue au mollah Omar (celui-ci dément de son côté toute ouverture de pourparlers) ont lieu les élections législatives et, en octobre, un « Haut conseil pour la paix » présidé par l’ancien président de la République B. Rabbani est officiellement institué. À l’issue d’un long dépouillement, les résultats du scrutin, marqué par de nombreuses irrégularités, sont publiés le 24 novembre : autour de 4 millions d’électeurs se sont rendus aux urnes, soit un taux de participation d’environ 38 %. Peu avant, lors de son sommet tenu à Lisbonne le 20 novembre, l’OTAN a confirmé le transfert progressif entre 2011 et 2014 des responsabilités en matière de sécurité au gouvernement afghan, et précisé les termes de leur coopération future dans le cadre d’un « partenariat à long terme ».
5.6. L’ENLISEMENT APRÈS DIX ANS DE PRÉSENCE INTERNATIONALE
En septembre 2011, l’assassinat de B. Rabbani par un commando taliban est un nouveau coup porté au frêle processus de paix lancé l'année précédente. Intervenant après plusieurs attaques, dont celles lancées en juin et en août contre l'hôtel Intercontinental et le centre culturel britannique, il relance le débat sur la capacité des forces afghanes à assurer seules la sécurité et prendre la relève des troupes internationales après 2014.
Alors que la FIAS (dont les forces françaises) placées depuis juillet sous le commandement du général John Allen, continue d’essuyer des pertes à Kaboul ou sur le terrain, des négociations secrètes avec les talibans ne sont toujours pas écartées par les Américains.
Parallèlement, en octobre, reconnaissant par ailleurs l’échec de la lutte contre l’insurrection, le président Karzai conclut un pacte stratégique avec l’Inde dans la perspective du futur retrait des forces occidentales, un accord qui n’entraîne toutefois aucune réaction de la part du Pakistan. En revanche, ce dernier est le grand absent de la conférence internationale, réunie à Bonn en décembre, à l’issue de laquelle les Occidentaux assurent de leur soutien le président afghan qui demande le maintien de l’aide internationale jusqu’en 2024 et s’engage, une fois de plus et sans véritablement convaincre ses interlocuteurs, à lutter plus résolument contre la corruption.
5.7. VERS LE RETRAIT DES FORCES INTERNATIONALES
Le rapatriement effectif des forces françaises d’Afghanistan (autour de 4 000 militaires en 2011) à partir de juin 2012 anticipe la fin progressive de la mission de la FIAS.
Le 18 juin 2013, le président Karzai lance la dernière étape de la transition vers la prise en main de la sécurité par les forces nationales afghanes dans l’ensemble du pays. Formées et entraînées par la FIAS, ces dernières sont composées notamment de l’Armée nationale afghane (ANA), de la Force aérienne afghane et des forces de police nationale et locale. En juin 2014, les troupes occidentales ne comptent plus qu’environ 49 900 soldats dont 32 800 Américains.
La signature d’un accord bilatéral de sécurité (BSA), qui prévoit le maintien d’un appui militaire après le retrait prévu à la fin de l’année, ayant été reportée par H. Karzai, la succession de ce dernier constitue une importante étape politique.
Pour lire la suite, consulter le LIEN ( haut de page ).
|
| |
|
| |
|
 |
|
RÃPUBLIQUE DOMINICAINE |
|
|
| |
|
| |
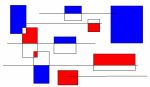
République dominicaine
en espagnol República Dominicana
État des Grandes Antilles baigné au nord par l'océan Atlantique, au sud par la mer des Antilles, la République dominicaine occupe la partie orientale de l'île d'Haïti.
* Superficie : 48 400 km2
* Nombre d'habitants : 10 404 000 (estimation pour 2013)
* Nom des habitants : Dominicains
* Capitale : Saint-Domingue
* Langue : espagnol
* Monnaie : peso dominicain
* Chef de l'État : Luis Abinader
* Chef du gouvernement : Luis Abinader
* Nature de l'État : république à régime présidentiel
* Constitution :
* Entrée en vigueur : 13 juin 2015
Pour en savoir plus : institutions de la République dominicaine
GÉOGRAPHIE
À l'Ouest, montagneux, ouvert par des fossés d'effondrement, s'oppose l'Est, formé surtout de plaines et de collines, domaines de la canne à sucre (principale ressource), de la banane, du riz, du café, du cacao et du tabac. Le tourisme est en plein essor. La population (dont Saint-Domingue concentre un peu plus de 20 %) s'accroît rapidement et est largement métissée.
1. LES MILIEUX NATURELS
Le relief est tourmenté. Il est constitué d'une succession de plaines, de fossés d'effondrement, de vallées et de montagnes disposés en bandes parallèles orientées E.-S.-E. à O.-N.-O. La Cordillère centrale forme l'épine dorsale du pays (pic Duarte, 3 175 m) ; elle s'abaisse à l'est en un seuil assez bas (277 m) pour faciliter le passage entre la plaine côtière du Sud (bas plateau calcaire) et le fossé Cibao-Vega Real (remblayé d'alluvions fertiles). Au-delà du seuil, elle se prolonge par la sierra de Seibo (600 à 700 m d'altitude) jusqu'au cap Engaño. La côte nord est bordée par la Cordillère septentrionale (1 249 m), qui s'allonge jusqu'à la presqu'île de Samaná. Au sud-ouest, du cap Beata à la Cordillère centrale, se succèdent une plaine côtière, la sierra de Bahoruco (dans la presqu'île de Baharona), le fossé du lac Enriquillo (−40 m au-dessous du niveau de la mer), la sierra de Neiba, le fossé de la vallée de San Juan et de la plaine d'Azua.
Le climat, tropical (température moyenne de 25 à 26 °C) est assez humide. Les pluies se concentrent de juin-juillet à novembre-décembre, les autres mois correspondent à la saison sèche. La répartition géographique des pluies présente de vigoureux contrastes : les fossés abrités sont secs (moins de 800 mm d'eau par an dans la vallée de San Juan) ; les versants exposés aux vents d'est, très arrosés (plus de 2 m d'eau par an dans la presqu'île de Samaná). De violents cyclones peuvent ravager le pays. La végétation naturelle présente une très grande variété de formations selon la pluviométrie et l'altitude : des steppes à cactus et à buissons d'épineux à la forêt dense et à la forêt de pins caraïbes. Le potentiel agricole est important et diversifié (près de 80 % du territoire sont utilisables pour l'agriculture et l'élevage).
2. LE PEUPLEMENT
L'île de Hispaniola était l'un des principaux centres de peuplement des Arawaks au sein des Antilles avant l'arrivée des Espagnols en 1492. Sa colonisation a entraîné un désastre démographique chez les Amérindiens, victimes du pillage, des maladies et de l'établissement du travail forcé. La disparition de la population amérindienne a conduit les Espagnols à utiliser des esclaves africains, mais la pratique de l'esclavage n'atteignit jamais la même ampleur que dans la partie occidentale de l'île, colonisée par les Français. La population actuelle de la République dominicaine est donc le fruit d'un métissage très large entre les descendants des esclaves africains et les colons européens. Le pays, qui compte également des communautés chinoises et japonaises, a attiré des milliers d'émigrants en provenance d'Haïti (État correspondant à l'ancienne partie française de l'île), mais aussi de Cuba, de la Jamaïque et de la Guadeloupe, et ce malgré l'instauration, sous la dictature de Rafael Leónidas Trujillo y Molina (1930-1961), d'une politique raciste qui cherchait à favoriser le blanchiment de la population en encourageant l'immigration européenne.
La population est aujourd'hui principalement urbaine (65 %) à la suite d'un exode rural massif pendant les années 1970. Elle se concentre à Saint-Domingue, à San Pedro de Macoris et à La Romana, dans le sud du pays, ainsi qu'à Santiago de los Caballeros, dans le nord. À l'image de ses voisines antillaises, la population dominicaine est jeune (31 % des habitants sont âgés de moins de 15 ans). Malgré diverses incitations gouvernementales en faveur de la régulation des naissances, les taux de natalité (24 ‰) et d'accroissement naturel (1,8 % par an) restent encore élevés. De très nombreux Dominicains ont préféré émigrer à l'étranger, tandis que, paradoxalement, il existe un fort courant de main-d'œuvre illégale en provenance d'Haïti. Enfin, l'analphabétisme, qui touchait 13 % des plus de 15 ans en 2002, reste un grave problème minant le développement du pays.
3. LES CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES
La République dominicaine est l'un des pays les plus pauvres de la région des Antilles. Son économie, fragile, repose avant tout sur l'agriculture, mais cette forte dépendance à l'égard du secteur agricole est compensée par la vitalité et la croissance de l'industrie manufacturière ainsi que par l'essor spectaculaire du tourisme. Mais le développement économique se heurte toujours à des difficultés structurelles, comme le montrent, par exemple, les déficiences chroniques dans l'alimentation électrique des particuliers et des entreprises. La République dominicaine reste encore très marquée par la terrible récession survenue dans le courant des années 1970. La concomitance de deux phénomènes, à savoir la chute vertigineuse des revenus d'exportation du sucre et la forte augmentation des dépenses énergétiques, a alors plongé le pays, au bord de la faillite, dans une crise profonde, aggravée par une corruption érigée en système et par la subordination des autorités politiques aux intérêts économiques des compagnies multinationales américaines. La République dominicaine a dû s'en remettre aux exigences du Fonds monétaire international (F.M.I.), qui préconisait des réformes structurelles importantes, comme le dégraissage d'une fonction publique jugée pléthorique. Mais l'application de ces directives a eu de terribles répercussions sociales, entraînant une succession d'émeutes contre la vie chère et la misère. Cependant, elle a permis à l'économie dominicaine de renouer avec la croissance. Cependant, plus de la moitié de la population active est au chômage ou sous-employée et la dette extérieure reste écrasante (plus de 7 milliards de dollars en 2005).
Les principaux produits d'exportation sont le sucre et le ferronickel. Le pays importe du pétrole, des biens de consommation ainsi qu'une bonne partie de ses produits alimentaires. En 1998, le pays a été durement touché par les inondations qui ont suivi le passage du cyclone Georges. Ses principaux partenaires commerciaux sont les États-Unis, loin devant le Mexique et le Japon. La République dominicaine a signé en 1998 un accord de libre-échange avec la Communauté des Caraïbes (Caricom).
Le secteur agricole et la pêche contribuent à 12 % du produit intérieur brut (P.I.B.) et emploient 16 % de la population active. Les cultures tropicales vouées à l'exportation coexistent avec une importante agriculture de subsistance (maïs, riz). La canne à sucre constitue la principale culture commerciale, devant la banane, le cacao (12e rang mondial) et le café. Cependant, l'industrie sucrière a subi de lourdes pertes ces dernières années, en raison d'une chute significative de ses niveaux de production.
L'industrie fournit le quart du P.I.B. et occupe 15 % des actifs. L'exploitation minière représente une source non négligeable de revenus. Elle repose essentiellement sur la production de ferronickel et, dans une bien moindre mesure, sur l'extraction d'or et d'argent. L'industrie manufacturière, principalement concentrée autour de la capitale, Saint-Domingue, a connu une forte croissance. Les petites unités industrielles dominent, une bonne partie d'entre elles étant spécialisées dans la transformation de la production agricole (raffinage du sucre, production de mélasse, confection de cigares et de cigarettes). L'activité de la sous-traitance est en pleine expansion et contribue, pour une large part, à la vitalité du secteur secondaire.
De son côté, l'essor du tourisme soutient l'activité économique d'un pays bénéficiant de ressources géographiques exceptionnelles qui en font une destination privilégiée dans la région des Antilles. La République dominicaine a développé de manière substantielle son parc hôtelier et ses structures d'accueil, en promouvant les offres « tout inclus », si bien qu'au début des années 1990 elle accueillait plus de un million de touristes par an. Le nombre de visiteurs n'a pas cessé d'augmenter depuis (4 millions en 2011) et les recettes en devises dépassent 4 milliards de dollars par an.
HISTOIRE
1. DU PARTAGE COLONIAL AUX ERREMENTS DE L'INDÉPENDANCE
Les Espagnols, avec Christophe Colomb, abordent l'île en 1492 et entreprennent sa colonisation dès 1493. Elle fut la première base de l'expansion des Espagnols dans les Antilles et le reste du continent américain.
Placée au centre des rivalités coloniales, elle est officiellement partagée entre la France et l'Espagne au traité de Ryswick (1697). La France acquiert la partie occidentale de l'île, mais la délimitation des deux territoires n'est réalisée qu'en 1776, par le traité d'Aranjuez. Au traité de Bâle (1795), l'Espagne cède finalement sa colonie à la France, alors que la partie française est en pleine insurrection antiesclavagiste. En 1801, l'ancien esclave Toussaint Louverture, principal chef de l'insurrection, occupe la partie espagnole de Saint-Domingue pour le compte de la France. Mais celle-ci envoie dans l'île le général Leclerc puis le général Rochambeau pour rétablir son autorité et le système esclavagiste. Ces troupes sont battues dans la partie française, qui devient la République indépendante d'Haïti en 1804. En revanche, la partie espagnole reste sous l'autorité militaire française. Les émigrés dominicains à Porto Rico réussissent à chasser les dernières troupes françaises en 1809 et à rattacher la partie orientale de l'île à l'Espagne, ce qui est confirmé par le traité de Paris (1814).
À l'instigation de José Núñez de Cáceres, la colonie devient indépendante en décembre 1821. L'existence du nouvel État n'est que de très courte durée, puisqu'il est envahi par Haïti en 1822. L'île connaît l'unité politique, mais la domination haïtienne est rejetée en février 1844, et l'indépendance de la République dominicaine est à nouveau proclamée. Incertain de la capacité de son pays à l'indépendance et prétextant une menace haïtienne, le président Santana fait voter la rétrocession de la République dominicaine à l'Espagne en mars 1861. La nouvelle annexion provoque une large réaction populaire, qui aboutit, après une nouvelle guerre, à l'indépendance définitive en 1865.
2. IMPÉRIALISME ET DICTATURE
La République dominicaine est secouée par des révoltes et des coups d'État, et les États-Unis interviennent à plusieurs reprises à la fin du xixe s. pour assurer le paiement des dettes. De 1916 à 1924, les Américains occupent même le pays. Pendant cette période, les États-Unis procèdent à une remise en ordre, à leur profit, de l'économie et mettent aussi sur pied une Garde nationale, dont ils confient le commandement à un jeune officier, Rafael Leónidas Trujillo y Molina. À partir de 1930, celui-ci impose son pouvoir absolu sur l'État, pouvoir fondé sur la terreur, une répression très dure et un culte effréné de la personnalité. L'île devient son domaine privé, et il contrôle toute la vie économique. Il procède au redressement financier, poursuit de grands travaux, fait distribuer des terres de l'État aux petits paysans, ce qui entraîne un développement économique spectaculaire. L'année 1960 marque le début de la désagrégation du régime de R. L. Trujillo y Molina ; en juin, le dictateur est compromis dans une tentative d'assassinat contre le président du Venezuela, Rómulo Betancourt. En août, les pays membres de l'Organisation des États américains (OEA) décident des sanctions contre la République dominicaine, tandis que le régime est condamné par l'Église et abandonné par les États-Unis. Le 30 mai 1961, R. L. Trujillo est assassiné ; le président du parti révolutionnaire dominicain (PRD), Juan Bosch, rentre d'exil. Accusé d'être une créature de la famille Trujillo y Molina, le président Joaquín Balaguer (nommé en 1960 par R. L. Trujillo y Molina) doit démissionner le 16 janvier 1962, et Rafael Bonelly lui succède. Une nouvelle Constitution est ratifiée en août 1962. Les élections du 20 décembre assurent le succès du parti de Juan Bosch, qui devient président de la République. Mais, le 25 septembre 1963, un putsch militaire le renverse et institue un triumvirat civil.
3. LE DIFFICILE CHEMIN VERS LA DÉMOCRATIE
3.1. LA RÉVOLUTION CONSTITUTIONNALISTE
En avril 1965, de graves événements ensanglantent le pays. Une fraction progressiste de l'armée aux ordres du colonel Francisco Caamaño, jouissant d'une large adhésion populaire, renverse le triumvirat. La guerre civile, restée ancrée dans la mémoire historique dominicaine sous le nom de Révolution constitutionnaliste, les oppose alors aux généraux partisans de l'ordre dictatorial ancien.
Effrayés par le succès des partisans de F. Caamaño ainsi que par l'éventualité de la victoire d'une révolution de type castriste, les États-Unis interviennent militairement dans le pays, mais leur occupation n'est approuvée qu'a posteriori par l'OEA.
Un gouvernement provisoire est mis en place avant la tenue de nouvelles élections en 1966, très contestées par les partis de gauche, qui donnent la victoire à Joaquín Balaguer, du parti réformiste social chrétien (PRSC).
3.2. LE GOUVERNEMENT PERSONNEL DE JOAQUÍN BALAGUER (1966-1978)
Héritier de la période Trujillo y Molina, le président Joaquín Balaguer inaugure une nouvelle ère de gouvernement personnel, n'utilisant pas moins la terreur, la violence et la fraude que son prédécesseur pour anéantir l'opposition et assurer sa réélection en 1970 et 1974.
Deux tentatives de débarquement armé d'opposants en 1973 et en 1975 sont implacablement écrasées et utilisées à des fins de propagande pour renforcer son pouvoir. Fort du soutien des États-Unis, J. Balaguer mobilise les forces sociales en poursuivant la politique des grands travaux. Pourtant, à la surprise générale, il est battu aux élections de 1978 par Antonio Guzmán, issu du parti révolutionnaire dominicain (PRD).
3.3. ANTONIO GUZMÁN (1978-1982) ET JORGE BLANCO (1982-1986)
L'armée tente une nouvelle fois d'empêcher l'alternance politique. Elle se ravise après avoir subi de fortes pressions de la part des États-Unis, qui ne craignent plus de dérives socialistes de la part du PRD. Le nouveau gouvernement, atteint lui aussi par la corruption, se heurte à la crise économique et perd une bonne partie de sa base populaire à la suite de l'application de mesures d'austérité.
Aux élections de 1982, le PRD conserve le pouvoir mais change de leader, en la personne de Jorge Blanco, qui se heurte lui aussi aux effets d'une crise économique et sociale profonde.
3.4. LE RETOUR DE JOAQUÍN BALAGUER (1986-1996)
J. Balaguer revient au pouvoir à la suite des élections de 1986, marquées par la violence. Malade et quasi aveugle, le vieux caudillo renoue avec la tradition de la fraude et de la corruption pour se maintenir au pouvoir aux élections de 1990 et 1994. Mais, vivement contesté par ses concitoyens et par la communauté internationale, il accepte de réduire son mandat de moitié et de ne pas se présenter à l'élection de 1996.
3.5. LEONEL FERNÁNDEZ (1996-2000) ET HIPÓLITO MEJÍA (2000-2004)
La victoire revient à Leonel Fernández, du parti de la Libération dominicaine (PLD), fondé par Juan Bosch après son départ du PRD. Lors des élections législatives et municipales du printemps 1998, le parti du président essuie un grave revers au profit du PRD.
En 1998, Saint-Domingue rétablit ses relations diplomatiques avec Cuba, au terme de presque quarante années de gel.
En mai 2000, le candidat social-démocrate, Hipólito Mejía (PRD) est déclaré vainqueur à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, grâce au retrait du candidat du PLD, Danilo Medina, arrivé en deuxième position. À mi-mandat, la cote de popularité du chef de l'État, qui s'était présenté comme le défenseur des pauvres, s'effondre à mesure que l'économie plonge dans une brutale récession ; en moins de deux ans, la rapide dévaluation du peso et l'inflation ont amputé de moitié le pouvoir d'achat des Dominicains.
En mai 2003, la faillite frauduleuse de la banque Baninter (1,9 milliard d'euros) secoue le pays et dévoile un système de corruption généralisé. Rejetant la responsabilité de la crise sur des facteurs externes tels que le prix élevé du pétrole, Hipólito Mejía réprime durement les grèves générales de novembre 2003 et de janvier 2004. L'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle de mai 2004 provoque une grave crise au sein son propre parti (PRD).
3.6. LE RETOUR DE LEONEL FERNÁNDEZ (2004-2012)
Lassés, les Dominicains optent pour le changement et élisent, pour la seconde fois, au premier tour L. Fernández avec plus de 51 % des suffrages. Ce dernier profite de sa popularité et de la faiblesse des partis d'opposition pour faire adopter par le Parlement un budget d'austérité. Il promet de résoudre la crise énergétique qui affecte gravement la vie quotidienne des Dominicains et s'engage à combattre les fléaux de la corruption et de la criminalité.
Alors que les relations avec Hugo Chávez avaient été rompues en 2003, un « accord de coopération énergétique » prévoyant la livraison de pétrole à des tarifs préférentiels dans le cadre du programme Petrocaribe, est signé avec le Venezuela en novembre 2004. En septembre 2005, le congrès – initialement réticent en raison des conditions imposées – ratifie l'association de la République dominicaine à l'accord de libre-échange entre les pays d'Amérique centrale et les États-Unis (ALEAC ou CAFTA) qui est effective en mars 2007. Avec l'appui du FMI, le gouvernement parvient ainsi à redresser la situation économique du pays.
Fort de ce bilan positif, L. Fernández remporte l'élection présidentielle de mai 2008. Avec plus de 53 % des suffrages, il est élu pour un troisième mandat, au premier tour de scrutin, devant Miguel Vargas, candidat du PRD, qui obtient de 5 % des suffrages. Tout en accusant le gouvernement sortant d'avoir massivement utilisé les moyens à sa disposition pour assurer cette réélection (en allégeant notamment par des subventions les prix du carburant et de certains produits de première nécessité), le chef de l'opposition admet sa défaite tandis que l'OEA reconnaît la transparence du scrutin.
Le 26 janvier 2010, alors que se profilent les élections législatives et municipales, une nouvelle Constitution prohibant la réélection consécutive du président de la République entre en vigueur. Avec 105 députés sur 183 à la Chambre et 31 sièges sur 32 au Sénat, le PLD et ses alliés s’imposent massivement au mois de mai.
Sur le plan régional et international, les relations de la République dominicaine avec Haïti – en dépit de quelques tentatives de rapprochement – restent tendues, en raison notamment des expulsions massives d'immigrés haïtiens par la République dominicaine. Elles se détériorent en 2005 après que la Cour interaméricaine des droits de l'homme juge le gouvernement dominicain coupable de discriminations envers les immigrés d'origine haïtienne. Elles connaissent une nette amélioration au lendemain de l'élection du président René Préval en Haïti (février), qui réserve sa première visite à la République dominicaine. Par ailleurs, cette dernière offre son assistance à son voisin dévasté par un tremblement de terre en janvier 2010.
Après avoir organisé la 36e assemblée générale de l'OEA en juin 2006, la République dominicaine accueille, en mars 2007, le premier sommet régional sur les drogues, la sécurité et la coopération ainsi que la conférence ministérielle des pays de la Caraïbe sur la lutte contre le terrorisme et le crime transnational. En février 2010, à l’occasion de la célébration du 166e anniversaire de son indépendance, elle réitère son engagement dans la lutte contre le trafic de stupéfiants (reconnaissant l'implication de certains militaires). En janvier 2010, elle offre son hospitalité à Manuel Zelaya, président déchu du Honduras, dernier acte d’une longue crise institutionnelle qui a secoué ce pays pendant plusieurs mois.
3.7. DANILO MEDINA SÁNCHEZ (2012-)
Ne pouvant plus se représenter à l’élection présidentielle de mai 2012, L. Fernandez laisse la place à son ancien homme de confiance, devenu son rival lors des élections primaires au sein du PLD en 2007 : Danilo Medina Sánchez est ainsi élu à la tête de l’État avec 51,21 % des voix face au candidat du PRD, l’ancien président Hipólito Mejía, qui refuse de reconnaître officiellement sa défaite.
Entré en fonctions le 16 août, D. Medina s’engage à mettre en œuvre un programme de développement visant une réduction de la pauvreté absolue et la promotion de la classe moyenne, tout en maintenant le taux de croissance à 4,5 % par an en moyenne.
Ce mandat est en effet marqué par un retour à une forte croissance économique qui atteint jusqu’à 7 % en 2014-2015. Tiré notamment par le tourisme et une forte demande intérieure, ce développement s’accompagne d’une réduction du déficit budgétaire, à la suite notamment d’une impopulaire hausse des impôts et d’un important programme en faveur de l’éducation et de l’alphabétisation. Bien que toujours très inégalement répartie – en diminution mais estimé à 30 %, le taux de pauvreté reste l’un des plus élevés d’Amérique latine –, cette croissance contribue à la popularité du Président qui est facilement réélu pour un second mandat en 2016 à la suite d’une réforme constitutionnelle adoptée par le Congrès le 13 juin 2015.
Face à une opposition en proie aux divisions, D. M. Sánchez remporte ainsi plus 61 % des suffrages devant Luis Abinader, candidat du PRM (Parti révolutionnaire moderne) issu de la scission du PRD qui se rallie au PLD au sein du Bloc progressiste. Ce dernier obtient une majorité de 128 sièges (dont 106 pour le PLD) à la Chambre des députés et de 29 au Sénat (26 au PLD). Fort de cette large victoire, le président poursuit dans sa politique « social-libérale » de soutien à la croissance, estimée à plus de 6 % en 2018.
Les relations avec Haïti ne s’améliorent guère après la décision de la Cour constitutionnelle (septembre 2013) de retirer la nationalité dominicaine aux enfants nés sur le sol de la République dominicaine de parents étrangers en situation irrégulière au moment de leur naissance, avec effet rétroactif jusqu’en 1929. Concernant pour l’essentiel des personnes d’origine haïtienne, la décision crée des milliers d’apatrides et suscite les protestations des ONG et de l’OEA. Un plan de régularisation et une loi sur la naturalisation sont adoptés en vue de résoudre la situation. Mais, tandis que les expulsions se poursuivent, la réforme est inscrite dans la constitution de 2015 et contribue à la détérioration des relations entre Dominicains et Haïtiens.
PLAN
*
* GÉOGRAPHIE
* 1. Les milieux naturels
* 2. Le peuplement
* 3. Les caractéristiques économiques
* HISTOIRE
* 1. Du partage colonial aux errements de l'indépendance
* 2. Impérialisme et dictature
* 3. Le difficile chemin vers la démocratie
* 3.1. La Révolution constitutionnaliste
* 3.2. Le gouvernement personnel de Joaquín Balaguer (1966-1978)
* 3.3. Antonio Guzmán (1978-1982) et Jorge Blanco (1982-1986)
* 3.4. Le retour de Joaquín Balaguer (1986-1996)
* 3.5. Leonel Fernández (1996-2000) et Hipólito Mejía (2000-2004)
* 3.6. Le retour de Leonel Fernández (2004-2012)
* 3.7. Danilo Medina Sánchez (2012-)
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
