|
| |
|
|
 |
|
Les agrégats de méningocoques coulent dans les vaisseaux sanguins comme un liquide visqueux |
|
|
| |
|
| |
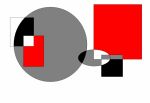
Les agrégats de méningocoques coulent dans les vaisseaux sanguins comme un liquide visqueux
06 juillet 2018 RÉSULTATS SCIENTIFIQUES GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE
Une collaboration entre biologistes et physiciens a permis de décrypter une étape clé de l’infection causée par le méningocoque, un pathogène humain responsable de méningites chez les nourrissons et les jeunes adultes, pathologies qui, malgré une prise en charge rapide, présentent un taux de mortalité qui reste très important. Ce travail a été publié le 17 mai 2018, dans la revue Cell.
L’infection humaine se caractérise par l’accumulation de bactéries à l’intérieur des vaisseaux sanguins qui se trouvent entièrement remplis de bactéries bien que, ni les mécanismes de formation, ni l’impact de ce processus ne soient connus. Intrigués par la formation de ces agrégats intravasculaire, le consortium de scientifiques, regroupant biologistes et physiciens, s’est attelé à comprendre cette étape de l’infection, tout particulièrement sa base physique.
Il ressort de cette étude que les agrégats bactériens formés par le méningocoque se comportent de façon inattendue, comme un liquide visqueux, avec la viscosité du miel. Les bactéries se multiplient rapidement dans les vaisseaux sous forme d’agrégats qui s’adaptent ainsi progressivement à la géométrie complexe du réseau vasculaire, comme un liquide qui s’écoule. L’étude montre que la formation de ces agrégats et leurs propriétés physiques sont essentielles pour la progression de l’infection.
Les propriétés de liquide visqueux des agrégats dépendent d’un facteur de virulence appelé pilus de type IV. Il s’agit de long filaments adhésifs et dynamiques qui s’allongent et se rétractent en permanence à la surface de la bactérie. Ces filaments permettent aux bactéries de se trouver, de se rapprocher et d’entrer en contact de façon réversible. L’agrégation est donc basée sur un processus aléatoire d’attraction entre les bactéries. Ces filaments permettent aux bactéries de se trouver, de se rapprocher et d’entrer en contact de façon réversible. L’observation montre que cette dynamique d’interaction entre bactéries voisines est aléatoire, et contribue donc de manière active à l’agitation globale des bactéries dans l’agrégat. Sur le plan physique ce processus d’interaction confère à ces agrégats des propriétés originales de fluide hors d’équilibre jusque-là non décrites. Par exemple, les bactéries à l’intérieur des agrégats présentent une motilité plus élevée que celle observée par la diffusion des bactéries isolées. Ainsi, au-delà de proposer une meilleure compréhension d’une infection humaine létale, cette étude dévoile un nouveau type de matière active basée sur la présence des forces attractives intermittentes entre ses éléments constituants.
Cette étude pluridisciplinaire a pu être réalisée grâce à une étroite collaboration entre un laboratoire spécialisé dans les infections causées par le méningocoque (G. Duménil, Institut Pasteur et INSERM) et des physiciens. La collaboration avec les équipes de Hugues Chaté (CEA, CNRS, Université Paris-Saclay), Nelly Henry (CNRS, Sorbonne Université) et Raphael Voituriez (CNRS, Sorbonne Université) a permis de coupler une approche expérimentale quantitative avec un modèle physique de matière active.
DOCUMENT CNRS LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
société animale |
|
|
| |
|
| |

société animale
Consulter aussi dans le dictionnaire : société
Groupement d'individus d'une espèce animale présentant une structure sociale caractéristique.
ÉTHOLOGIE
Chez les animaux sociaux, qu'il s'agisse d'insectes (abeilles, fourmis, termites, etc.) ou de mammifères (éléphants, singes, etc.), les comportements fondamentaux, liés à l'alimentation, à la reproduction et à la protection, impliquent la présence et, souvent, la participation des congénères.
PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES
La vie sociale se structure à travers la communication entre les individus, les échanges de signaux et d'informations. À partir de ces échanges se créent puis se dénouent des liens privilégiés. Temporaires ou durables, ceux-ci unissent les individus et constituent l'ossature de la vie en société.
À l'intérieur des groupes sociaux, on peut voir émerger la diversité et la spécialisation, diversité des individus, des liens et des fonctions, spécialisation des rôles et des tâches. La spécialisation apparaît clairement dans les sociétés d'insectes qui abritent gardiens, fourrageurs, soigneurs, etc. On sait aujourd'hui cependant que chaque « spécialiste » possède une certaine souplesse comportementale lui permettant de participer à diverses tâches. On retrouve ces éléments plus ou moins fortement dans les chasses collectives de carnivores comme les lionnes, les lycaons et les loups ou, simplement, dans la contribution des membres du groupe à l'élevage des jeunes (également chez les lycaons).
La cohésion du groupe social est garantie par l'importante dépendance de l'individu à l'égard de ce groupe. Elle s'impose également dans le cas d'une menace extérieure, représentée par une autre société limitrophe et concurrente ou par les prédateurs.
LES INSECTES SOCIAUX
Parmi les arthropodes, si certaines espèces d'araignées témoignent d'une forme d'organisation sociale (coopération pour la construction des toiles, pour la capture des grosses proies et même pour le nourrissage des jeunes), les exemples de sociétés véritables sont seulement connus dans la classe des insectes : termites, fourmis, bourdons, certaines espèces d'abeilles et de guêpes ont ainsi le statut d'insectes sociaux.
LES SOCIÉTÉS DE VERTÉBRÉS
Si, chez les insectes sociaux, la reine ou le couple royal représentent, par analogie, l'appareil sexuel de la société organisée, chez les vertébrés, en revanche, tout individu adulte est un reproducteur potentiel (à l'exception des rats-taupes, rongeurs africains dont la vie sociale est organisée à la manière de celle des insectes). En outre, les structures sociales des insectes sont fermées aux étrangers, alors que celles des vertébrés se caractérisent par une certaine ouverture, rendant possibles les échanges.
Chez les oiseaux, la forme sociale la plus avancée s'observe dans la reproduction communautaire ou coopérative. Elle désigne la particularité pour des individus d'élever des jeunes qui ne constituent pas leur progéniture.
Chez les mammifères, à l'exception des loups, des gibbons et de certains rongeurs, qui sont monogames (dans ce cas, l'unité sociale est de type familial), la polygamie conduit à différentes structures sociales. Le mâle peut s'associer à plusieurs femelles pendant la période de reproduction et constituer un harem temporaire, comme chez les cerfs et les éléphants. Chez ces derniers, femelles et petits se regroupent pour constituer des structures matriarcales.
Dans d'autres espèces, les liens entre un mâle et un groupe de femelles peuvent se maintenir au-delà de la période de fécondité de ces dernières. La constitution d'un harem permanent, comme chez les babouins sacrés, entraîne alors la formation de groupes de mâles célibataires. D'autres groupes réunissent plusieurs mâles et plusieurs femelles (notamment chez les macaques). Si, de par son statut, le mâle dominant de chaque unité sociale a priorité sur toute activité sexuelle, en pratique cela s'avère rarement le cas. En outre, les liens particuliers entre individus jouent un rôle fondamental dans l'organisation des groupes.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
On a tous en nous quelque chose de Néandertal, sauf⦠|
|
|
| |
|
| |

On a tous en nous quelque chose de Néandertal, sauf…
COMMUNIQUÉ | 09 JUIN 2017 - 11H27 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION
AddThis Sharing Buttons
Une étude menée par des chercheurs de l’Inserm au sein de l’Irset « Institut de recherche en santé, environnement et travail »[1] montre que la sélection naturelle a « purgé » de notre organisme l’essentiel des traces de nos lointains cousins Néandertal et Dénisovien dans les gènes responsables du brassage génétique indispensable à la reproduction. Les chercheurs démontrent, en effet, que les gènes exprimés au cours de la méiose dans les cellules à l’origine des gamètes sexuels sont fortement dépourvus de variations génétiques d’origine néandertalienne issues du croisement entre Homo sapiens et Homo neandertalis. Ces résultats sont publiés dans Molecular Biology and Evolution.
Une question taraude les paléontologues depuis des décennies concernant les cousins de l’Homme moderne aujourd’hui disparus, les hommes de Néandertal et de Dénisova : Quelle a été la nature des interactions entre l’Homme moderne et les autres espèces du genre Homo aujourd’hui éteintes ?
En effet, il y a des centaines de milliers d’années, les migrations humaines de l’Afrique vers les autres continents se sont succédé, ce qui a conduit à la coexistence en Eurasie d’Homo sapiens avec diverses autres espèces du genre Homo aujourd’hui disparues. En 2014, le séquençage du génome d’un Néandertalien a été rendu possible par la découverte de fragments d’os dans lesquels il restait de l’ADN. L’émergence très récente de la paléogénomique a permis d’établir que 1 à 3% du génome des Eurasiens actuels sont hérités des néandertaliens, alors que 3 à 6% du génome des Océaniens sont hérités d’un autre cousin ancestral, les dénisoviens. Les femmes et les hommes qui peuplent la planète aujourd’hui sont issus de ces nombreux métissages fondamentaux qui ont permis l’expansion des populations humaines grâce à l’acquisition de caractères favorables aux adaptations climatiques et environnementales.
Toutefois, une particularité étonnante est récemment apparue : les variations génétiques héritées des métissages avec ces espèces disparues ne sont pas réparties de manière égale sur les chromosomes. C’est ainsi que l’équipe du Pr. David Reich a démontré que ces variations génétiques « archaïques » étaient très peu présentes sur les gènes exprimés spécifiquement dans le testicule de l’Homme moderne.
D’où la question clef adressée dans leur étude par les chercheurs rennais : au sein du testicule et de l’ovaire, à quelles fonctions précises sont assignés ces gènes appauvris en variations génétiques néandertaliennes et dénisoviennes ?
C’est pour répondre à cette question que les chercheurs de l’Inserm ont comparé les gènes présents dans les différents types cellulaires du testicule (cellules de la lignée germinale, cellules de Sertoli, cellules de Leydig etc.).
Les résultats obtenus montrent que seuls les gènes exprimés spécifiquement lors du processus à l’origine du brassage génétique, appelé méiose, sont très fortement appauvris en allèles ancestraux d’origine néandertalienne et dénisovienne. Les conclusions se sont avérées identiques lors de l’étude des cellules germinales présentes dans les ovaires fœtaux humains. La méiose étant un processus unique et fondamental de la spermatogenèse et de l’oogenèse, la sélection naturelle a donc « purgé » de notre patrimoine génétique les variations génétiques qui auraient pu nuire à son bon déroulement et donc s’avérer délétères pour la perpétuation de notre espèce.
Pour Frédéric Chalmel et Bernard Jégou, les coordinateurs de cette étude, celle-ci indique que « bien que le brassage génétique entre les Hommes modernes et ces hominines disparus nous ait permis d’acquérir de nouveaux traits adaptatifs importants pour notre survie, elle a probablement eu un impact négatif sur la fertilité des premiers hybrides. C’est sûrement pourquoi, les gènes impliqués dans la méiose, un processus biologique particulièrement sensible, ont été purgés de variations génétiques archaïques. Ce travail est la première étude de paléo-fertilité et est susceptible de révéler des processus évolutifs impliqués dans certains cas d’infertilités rencontrés de nos jours ».
[1] Institut de recherche en santé, environnement et travail ; Inserm ; Ecole des hautes études en santé publique, Université de Rennes 1.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
FUSEAU MITOTIQUE |
|
|
| |
|
| |

Fuseau mitotique
Fuseau mitotique à la métaphase, on retrouve les 2 cdifférents moteurs protéiques.
Le fuseau mitotique, ou appareil mitotique achromatique, est un système mis en place par les cellules eucaryotes pour permettre la migration des chromatides lors de la division cellulaire dès le stade de la prophase. Il est constitué de microtubules et de protéines associées et forme un véritable fuseau entre les pôles opposés d’une cellule. Il assure une bonne répartition des chromosomes dans les cellules lors de la division. Il est donc indispensable à un bon développement cellulaire.
Notons que certains auteurs distinguent le fuseau mitotique (seulement les fibres chromosomiques et continues) et l'appareil achromatique (fuseau + centrosomes + fibres astériennes).
Notes et référencesLes différents types de fibres
Les fuseaux mitotiques sont constitués de microtubules qui se polymérisent à partir du centrosome. Dans la cellule en division, il existe trois classes différentes de fibres. Bien qu'elles soient de constitution similaire, leurs rôles divergent.
* Fibres astériennes :
Ces fibres se développent autour du centrosome ou microtubule organizing center (MTOC) et se dirigent vers la membrane cytoplasmique de la cellule. L'hypothèse émise est qu'elles jouent un rôle dans la mise en place du fuseau et interviendraient dans un mécanisme biologique survenant à la suite de la mitose, c'est la cytodiérèse. Après la cytodiérèse, les fibres d'asters serviraient à la formation du cytosquelette de chaque cellule fille.
* Fibres polaires ou continues ou chevauchantes :
Ces fibres vont se développer à partir du centrosome ou microtubule organizing center (MTOC) pour rejoindre le centre de la cellule en mitose et s'insérer (s'intercaler) entre les autres fibres polaires provenant du deuxième centrosome localisé à l'autre pôle de la cellule. Elles se lient grâce à des protéines motrices dont la chromokinésine qui se situe sur les télomères des chromosomes. En aucun cas elles ne se prolongent sur une longueur suffisante pour atteindre le centrosome du pôle opposé.
* Fibres chromosomiques ou kinétochoriennes :
Ces fibres se polymérisent du centrosome vers les chromosomes. Lors de la prométaphase, l'extrémité + du fuseau kinétochorien se fixe sur un complexe protéique situé au niveau du centromère des chromosomes. La fixation de ce complexe est faite par des protéines motrices, dont la dynéine et la kinésine.
Dynamisme moléculaire
Assemblage et désassemblage du fuseau
Le fait que les fuseaux mitotiques soient constitués de microtubules en fait une structure cellulaire dynamique qui se polymérise et se dépolymérise à tout moment. La longueur des fuseaux varie selon la polymérisation ou la dépolymérisation des microtubules pendant la mitose. Ces deux mécanismes sont dus à un flux des sous-unités d'alpha et beta tubuline. Il y a selon les besoins cellulaires des ajouts très rapides de sous-unités de tubuline alpha ou bêta permettant aux fuseaux de se développer suffisamment pour se fixer soit sur les kinétochores, soit sur des fibres polaires opposées. Lorsqu'il y a dépolymérisation du microtubule, cela se traduit par une perte de sous-unités de tubuline, ce qui entraîne un raccourcissement des fibres. Même si l'ajout et la soustraction de sous-unités de tubuline se font aux deux extrémités des fibres, les extrémités - restent toujours vers le centrosome, ce qui permet de déplacer le chromosome ou la chromatide attaché aux extrémités + des fibres. La vitesse de polymérisation/dépolymérisation des fuseaux est fonction de son extrémité : à l'extrémité + elle sera rapide tandis qu'à l'extrémité - elle sera lente.
Mitose
Au début de la mitose, les deux centrosomes se séparent, et chacun forme le noyau d'un arrangement de microtubules en rayons appelés aster. Les deux centrosomes se déplacent vers les deux côtés opposés du noyau pour former les deux pôles du fuseau mitotique. Lors de la prophase, les chromosomes répliqués se condensent et les fuseaux mitotiques commencent à s'assembler à l'extérieur du noyau. Pendant la pro-métaphase, l'enveloppe nucléaire se rompt, ce qui permet aux fuseaux d'entrer en contact avec les chromosomes et de les lier par l'intermédiaire de leurs kinétochores. L'attachement des microtubules sur les kinétochores se fait à la partie positive des microtubules. Durant la métaphase, le fuseau mitotique rassemble tous les chromosomes au niveau de son centre (plaque équatoriale). Pendant l'anaphase, les deux chromatides sœurs de chaque chromosome répliqué se dissocient de façon synchrone, et le fuseau chromosomique les tire en directions opposées vers les deux pôles de la cellule. Au cours de la télophase, les fibres polaires sont à l'origine d'une élongation de la cellule permettant de faire de la place pour les deux cellules filles à venir. Le fuseau mitotique permet la séparation des chromosomes et participe à la formation des deux cellules filles.
Régulation du fuseau
Il existe dans la cellule un équilibre entre la tubuline sous forme d'hétérodimères et la forme polymérisée des microtubules. Cet équilibre est extrêmement sensible, par exemple aux variations de la concentration de calcium. Comme la cellule est capable, grâce à des systèmes tampons et des pompes, de moduler localement et très rapidement la concentration de calcium, elle dispose donc d'un mécanisme de régulation très efficace et elle a la possibilité de contrôler la formation de microtubules et leur dissociation en dimères ou en monomères de tubulines. Un deuxième mécanisme de contrôle, qui est cependant à plus long terme, est la stabilisation des microtubules par des protéines associées ou des modifications chimiques comme une acétylation ou une détyrosylation.
Les fuseaux mitotiques subissent deux types de contrôles.
* L'origine du premier est une protéine située dans le kinétochore de chaque chromatide. Il a été mis en évidence que la protéine Mad 2 (mitotic arrest deficient 2) retarde la progression de la mitose lorsque certains chromosomes ne sont pas alignés dans la plaque métaphasique. Mad 2 empêche des réactions protéolytiques qui permettent à la cellule de rentrer dans le stade de l'anaphase. Quand les chromosomes sont alignés dans la plaque métaphasique, les kinétochores perdent cette protéine. La disparition de Mad 2 permet la suite de la mitose.
* Le deuxième est un contrôle mécanique, c'est le type de tension que subit le chromosome qui lui permet d'émettre ou non un signal d'inhibition qui retarde l'anaphase. La tension mécanique présente lorsque le chromosome est attaché uniquement à un microtubule chromosomique permet l'émission du signal d'inhibition. Lorsque chaque chromatide du chromosome est reliée à un microtubule, alors la tension mécanique change et le signal d'inhibition est stoppé. Ce sont ces deux systèmes qui régulent l'entrée en anaphase de la cellule.
*
Poisons des fuseaux mitotiques
Il existe un certain nombre de molécules chimiques qui peuvent être considérées comme des poisons du fuseau mitotique. C’est le cas des taxanes, de la colchicine et des vinca-alcaloïdes. Ces molécules bloquent la polymérisation ou la dépolarisation des microtubules. Certaines de ces molécules sont utilisées sur le plan thérapeutique pour soigner les tumeurs cancéreuses à fort index prolifératif. Il est donc possible de ralentir leur progression ou de les détruire en bloquant le fuseau mitotique et donc la mitose des cellules tumorales en évitant de toucher les cellules normales qui prolifèrent beaucoup moins.
Notes et références
* B. Alberts, A. Jonhson, J. Lewis, M. Raff, Biologie moléculaire de la cellule 4e édition, Flammarion Médecine-Sciences, Traite de médecine, 09/07/2004, (ISBN 2-257-16219-6), p. 1031
*
* G. Karp, Biologie cellulaire et moléculaire 2e édition, De Boeck, 01/04/2004, (ISBN 2-8041-4537-9), p. 593:604
*
* H.Plattner, J. Hentschel, Manuel de poche de Biologie cellulaire 3e édition, Flammarion Médecine-Sciences, atlas de poche, 01/04/2009, (ISBN 978-2-257-00004-0), p. 284, 285, 397
*
* B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Jonhson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, L'essentiel de la biologie cellulaire 2e édition, Flammarion Médecine-Sciences, Traite de médecine, 19/08/2005, (ISBN 2-257-15123-2), p. 640:655
DOCUMENT wikipédia LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
