|
| |
|
|
 |
|
De nouvelles perspectives thérapeutiques pour les patients porteurs dâanomalies lymphatiques liées à une mutation du gène PIK3CA |
|
|
| |
|
| |

De nouvelles perspectives thérapeutiques pour les patients porteurs d’anomalies lymphatiques liées à une mutation du gène PIK3CA
06 OCT 2021 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION
L’équipe du service de néphrologie-transplantation rénale adultes de l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, de l’Inserm et d’Université de Paris a mené des travaux, coordonnés par le Pr Guillaume Canaud, qui ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques pour les patients porteurs d’anomalies lymphatiques liées à une mutation du gène PIK3CA.
Les résultats de cette étude ont fait l’objet d’une publication le 6 octobre 2021 au sein de la revue Science Translational Medicine.
Les malformations lymphatiques, anciennement appelées lymphangiomes, sont des malformations du système lymphatique qui peuvent être localisées (cutanées, sous cutanées ou muqueuses) ou plus rarement étendues à l’ensemble du corps. Elles sont le plus souvent congénitales et visibles avant l’âge de 2 ans. Elles sont fréquemment localisées dans les régions axillaire et cervicale. Ces malformations peuvent s’accompagner de « poussées inflammatoires » douloureuses, de compression d’organes, notamment de la trachée nécessitant alors la mise en place d’une trachéotomie, d’épanchements diffus dans la plèvre ou d’infection grave. Elles peuvent parfois menacer le pronostic vital. Ces malformations ont très souvent un important retentissement esthétique et un fort impact sur l’insertion des patients dans la société.
Dans l’immense majorité des cas, les malformations lymphatiques sont dues à une mutation du gène PIK3CA acquise au cours du développement embryonnaire (in utero). Les traitements actuels reposent sur des scléroses percutanées guidées par la radiologie et/ou des chirurgies souvent délabrantes. Elles peuvent être associées à des soins de support tels que des corticoïdes pour traiter les poussées inflammatoires, des antalgiques, des antibiotiques, une assistance respiratoire nocturne et un soutien nutritionnel et psychologique. Dans certains cas, un traitement immunosuppresseur, la rapamycine sirolimus, est utilisé avec une efficacité variable. Il n’y a aucun traitement approuvé dans cette indication pour le moment.
Le travail de recherche qui vient d’être publié dans la revue Science Translational Medicine ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques pour ces patients porteurs d’anomalies lymphatiques liées à une mutation du gène PIK3CA.
De nouvelles perspectives thérapeutiques pour les patients porteurs d’anomalies lymphatiques liées à une mutation du gène PIK3CA >> voir la vidéo
L’équipe a créé le premier modèle murin porteur d’une mutation du gène PIK3CA spécifiquement dans les vaisseaux lymphatiques qui récapitule les différents types de malformations lymphatiques présentées par les patients. Ce modèle expérimental peut développer selon les besoins des malformations très localisées ou au contraire très diffuses.
L’équipe a ensuite identifié l’alpelisib (BYL719), inhibiteur spécifique de PIK3CA, et démontré son rôle comme molécule thérapeutique d’intérêt dans ce modèle préclinique. Fort de résultats très prometteurs chez l’animal, les chercheurs ont ensuite traité six patients, trois enfants et trois adultes, présentant des malformations lymphatiques sévères secondaires à une mutation PIK3CA, ayant résisté aux traitements conventionnels.
En six mois, le traitement par alplesib s’est accompagné d’une amélioration des symptômes des patients (douleurs, poussées inflammatoires, suintements, gêne à la déglutition…) et d’une réduction de 48% du volume des malformations mesurées en IRM. Comme précédemment rapporté dans une autre indication, le traitement a été bien toléré.
Ce travail, grâce au nouveau modèle expérimental créé, permet de mieux comprendre la physiopathologie des malformations lymphatiques mais ouvre surtout de nouvelles perspectives thérapeutiques très prometteuses.
Ce travail de recherche a été soutenu par :
-European Research Council (CoG 2020 grant number 101000948 and PoC-2016 grant number 737546)
-Agence Nationale de la Recherche – Programme d’Investissements d’Avenir (ANR-18-RHUS-005)
-Agence Nationale de la Recherche – Programme de Recherche Collaborative (19-CE14-0030-01).
-CLOVES SYNDROME COMMUNITY (West Kennebunk,USA)
-Emmanuel BOUSSARD Foundation (London, UK)
-Fondation DAY SOLVAY (Paris, France) Fondation TOURRE (Paris, France)
-Fondation BETTENCOURT SCHUELLER (Paris, France)
-Fondation Simone et Cino DEL DUCA (Paris, France)
-Fondation Line RENAUD-Loulou GASTE (Paris, France)
-Fondation Schlumberger pour l’Éducation et la Recherche (Paris, France)
-Inserm
-Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
-Université de Paris
-Et de nombreux autres généreux donateurs
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
NERF |
|
|
| |
|
| |

nerf
Consulter aussi dans le dictionnaire : nerf
Cet article fait partie du dossier consacré au système nerveux.
Cordon blanchâtre composé de fibres nerveuses, conduisant les messages moteurs du système nerveux central vers les organes, et les messages sensitifs et sensoriels en sens inverse.
Les nerfs, avec les ganglions nerveux (petits renflements sur le trajet des nerfs), constituent le système nerveux périphérique, par opposition au système nerveux central (encéphale et moelle épinière).
STRUCTURE DES NERFS
Les nerfs sont formés de fibres nerveuses parallèles, qui sont elles-mêmes des prolongements (axones ou dendrites) de cellules nerveuses (→ neurones). Outre les fibres nerveuses, les nerfs comportent des cellules de Schwann, qui forment une gaine (myéline) autour de certaines fibres ; un tissu de protection (tissu conjonctif) entoure les faisceaux de fibres (périnèvre) et l'ensemble du nerf (épinèvre).
FONCTION
Dans un nerf coexistent deux sortes de fibres : les fibres motrices, qui amènent des informations vers les organes et les tissus, et les fibres sensitives, qui transportent des informations vers le système nerveux central.
Parmi les fibres, on distingue par ailleurs les fibres somatiques (appartenant au système nerveux de la vie de relation, conscient), qui innervent les muscles squelettiques, la peau et les articulations, et les fibres végétatives (appartenant au système nerveux autonome, inconscient), qui innervent la paroi et les muscles des viscères et les glandes.
C'est pourquoi les nerfs se classent selon deux critères, qui sont leur composition en fibres et la partie du système nerveux central à laquelle ils sont rattachés.
Selon leur composition en fibres, on distingue, d'une part, les nerfs moteurs (allant jusqu'aux muscles) et les nerfs sensitifs (partant des organes des sens) et, d'autre part, les nerfs végétatifs (innervant les viscères et les glandes). En réalité, beaucoup de nerfs sont mixtes, composés de plusieurs types de fibres.
Selon la partie du système nerveux central à laquelle ils sont rattachés, on distingue les nerfs rachidiens (rattachés à la moelle épinière) et les nerfs crâniens (rattachés à l'encéphale).
PATHOLOGIE
Les nerfs peuvent être lésés au cours de différentes circonstances :
– névrite (atteinte inflammatoire, toxique ou infectieuse) ;
– compression (celle du nerf médian dans le canal carpien du poignet, par exemple) ;
– tumeur (névrome, neurinome) ;
– traumatisme (souvent par une section par une arme blanche ou par balle).
Voir aussi : fibre nerveuse, neurinome, névrite, névrome.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Maîtriser la peur : le cervelet, partenaire inattendu des troubles de lâhumeur |
|
|
| |
|
| |

Maîtriser la peur : le cervelet, partenaire inattendu des troubles de l’humeur
14 AVR 2023 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Les Axones du cervelet (en bleu) se retrouvent autour de neurones du thalamus qui vont vers le cortex préfrontal (vert) mais pas autour de ceux qui vont vers l’amygdale (rouge), autre région impliquée dans le contrôle des émotions. ©Equipe Neurophysiologie des Circuits Cérébraux, Inserm/CNRS/ENS-PSL
Les travaux d’une équipe pilotée par Clément Léna et Daniela Popa, directeurs de recherche Inserm à l’Institut de Biologie de l’ENS, parus dans Nature Communications révèlent l’importance du cervelet dans les émotions. Cette région du cerveau, surtout connue pour son rôle dans le contrôle moteur, agit aussi sur une aire du cortex préfrontal impliquée dans les émotions, et par ce biais régule l’extinction des souvenirs aversifs. Ce travail ouvre la voie à une meilleure compréhension de la régulation des émotions dans les troubles de l’humeur, mais aussi dans diverses conditions pathologiques comme par exemple l’anoxie périnatale, les tumeurs cérébrales ou encore les effets de l’alcool.
Pour survivre ou simplement optimiser son existence, mieux vaut être capable de reconnaître les risques et ajuster sa conduite en conséquence. Par des mécanismes associatifs, le cerveau apprend à identifier les indices annonciateurs du danger. Ces associations doivent être continuellement mises à jour, notamment pour reconnaître l’innocuité d’indices perçus jusque-là comme menaçants mais ne s’avérant plus associés à un danger.
Un défaut dans les processus de neutralisation de tels indices exposerait à accumuler seulement les associations négatives en conduisant, par exemple, à maintenir indéfiniment des réponses émotionnelles intenses à un traumatisme passé. Cependant, plutôt que d’oublier ces indices devenus négligeables, une des méthodes employées par le cerveau est de confier au cortex préfrontal le soin de réprimer leur signification aversive, grâce à un véritable apprentissage de l’innocuité, aussi appelé extinction.
En étudiant le cerveau des souris, l’équipe composée de chercheurs et chercheuses de l’ENS-PSL et de l’Inserm a montré que la zone du cortex préfrontal en charge de cette fonction reçoit des informations en provenance du cervelet (via un relai dans le thalamus, cf. figure). Les chercheurs sont parvenus à effectuer une inactivation ciblée de cette projection en y introduisant des récepteurs inhibiteurs artificiels. Ils ont observé que lorsque ce circuit est inactivé, la réponse de peur à un stimulus qui ne représente plus un danger se prolonge anormalement, ce qui indique un déficit d’apprentissage.
Les enregistrements de l’activité dans ce circuit cérébral ont alors révélé que le cervelet participe à l’apprentissage de la répression des souvenirs négatifs en stoppant des activités rythmiques cérébrales associées à l’état de peur.
Ces travaux complètent une étude précédente de la même équipe, qui avait démontré que l’intensité de l’association « indices – dangers » était également sous contrôle du cervelet, par des projections vers une autre région du cerveau que le cortex préfrontal.
Alors que le cervelet est très connu pour son rôle dans le système moteur (les effets moteurs de l’alcool sont par exemple à peu près entièrement dus à un effet sur le cervelet), ces démonstrations d’une régulation par le cervelet de la formation et de l’extinction de la mémoire émotionnelle sont importantes. Elles montrent que cette structure agit sur les processus clés de la régulation des émotions générées par nos expériences passées. Ce travail ouvre notamment la voie à une meilleure compréhension de la régulation des émotions dans les troubles de l’humeur, mais aussi dans diverses conditions pathologiques, liées par exemple à la sensibilité du cervelet à l’anoxie périnatale, aux tumeurs cérébrales ou aux effets de l’alcool.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Les Nanoblades : des navettes pour opérer le génome |
|
|
| |
|
| |
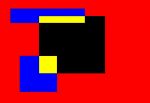
Les Nanoblades : des navettes pour opérer le génome
27 MAR 2019 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION | IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION, INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE
©Adobestock
Pour éditer le génome de façon précise, les chercheurs disposent désormais des « ciseaux génétiques » CRISPR/Cas9, outil très prometteur pour la thérapie génique. Le défi technologique aujourd’hui est d’amener cet outil jusqu’au génome de certaines cellules. Dans cet objectif, une équipe associant l’Inserm, le CNRS, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’École normale supérieure de Lyon au sein du Centre international de recherche en infectiologie (CIRI) ont développé des capsules permettant d’amener CRISPR/Cas9 jusqu’à l’ADN cible : les Nanoblades. Décrites dans Nature Communications, elles ouvrent des perspectives pour la recherche sur l’édition du génome des cellules souches humaines.
Depuis 2012, la communauté scientifique dispose d’une méthode révolutionnaire pour « opérer » le génome de façon précise : le système CRISPR/Cas9. Ces ciseaux moléculaires sont capables de couper l’ADN à un endroit précis dans une grande variété de cellules. Ils offrent par conséquent des perspectives considérables pour la recherche et pour la santé humaine. Cependant, amener ces « ciseaux génétiques » jusqu’à leur cible – notamment le génome de certaines cellules souches – reste un défi technique.
C’est sur cette problématique que travaillent des équipes de recherche de l’Inserm, du CNRS, de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et de l’École normale supérieure de Lyon qui ont développé les Nanoblades[1], des particules qui permettent de délivrer CRISPR/Cas9 dans de nombreuses cellules, y compris des cellules humaines.
Les scientifiques ont eu l’idée d’encapsuler le système CRISPR/Cas9 dans des structures ressemblant beaucoup à des virus et assurer ainsi sa livraison au sein d’une cellule cible, en fusionnant avec la membrane de cette dernière.
Pour concevoir ces Nanoblades, les chercheurs ont exploité les propriétés de la protéine rétrovirale GAG, qui a la capacité de produire des particules virales non infectieuses car dénuées de génome. L’équipe de recherche a fusionné la protéine GAG d’un rétrovirus de souris avec la protéine CAS9 – le ciseau du système CRISPR. Cette nouvelle protéine dite « fusion » fait l’originalité des Nanoblades.
Par conséquent, et à l’inverse des techniques classiquement utilisées pour modifier le génome, les Nanoblades encapsulent un complexe CRISPR/Cas9 immédiatement fonctionnel ; elles ne délivrent donc aucun acide nucléique codant le système CRISPR/Cas9 dans les cellules traitées. « L’action de CRISPR/Cas9 dans les cellules est ainsi temporaire. Elle est également plus précise et préserve les régions non ciblées du génome, atout particulièrement important dans le cadre d’applications thérapeutiques », précisent les auteurs.
Enfin, les chercheurs ont utilisé une combinaison originale de deux protéines d’enveloppe virales à la surface des Nanoblades pour leur permettre d’entrer dans une large gamme de cellules cibles.
Les scientifiques ont démontré l’efficacité des Nanoblades in vivo, dans l’embryon de souris, pour un large spectre d’applications et dans un large panel de cellules cibles où d’autres méthodes sont peu performantes. « Les Nanoblades s’avèrent notamment efficaces pour corriger le génome des cellules souches humaines, cellules d’un grand intérêt thérapeutique (notamment dans la reconstitution de tissus) mais restant difficiles à manipuler par les méthodes habituelles », précisent les auteurs de ces travaux.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
