|
| |
|
|
 |
|
Un nouveau modèle dâorganoïde pulmonaire pour mieux comprendre et traiter les maladies respiratoires chroniques obstructives |
|
|
| |
|
| |
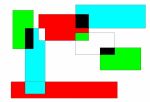
Un nouveau modèle d’organoïde pulmonaire pour mieux comprendre et traiter les maladies respiratoires chroniques obstructives
05 Sep 2024 | Par Inserm (Salle de presse) | Physiopathologie, métabolisme, nutrition
Image montrant les cellules ciliées (en magenta) et le mucus (en cyan) dans le modèle bronchioïde tubulaire développé par les chercheurs. Les noyaux de cellules sont en gris clair. © CRCTB
Les maladies respiratoires obstructives chroniques représentent un défi de santé publique en raison d’un taux d’incidence important et croissant, ainsi que d’un arsenal thérapeutique limité pour certaines d’entre elles. Une recherche, dirigée par des chercheurs de l’université de Bordeaux et de l’Inserm au sein du Centre de recherche cardio-thoracique (CRCTB), a permis de développer un modèle tubulaire in vitro des voies respiratoires, qui pourra être utilisé pour des tests précliniques. Cette étude a été publiée dans la revue European Respiratory Journal.
Les maladies respiratoires obstructives chroniques, telles que l’asthme ou encore la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), sont caractérisées par une limitation des débits d’air. Elles représentent un enjeu sociétal majeur en raison de taux élevés de morbidité, d’invalidité et de mortalité. La BPCO – paradoxalement peu connue du grand public – est la 3e cause de mortalité dans le monde selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avec 3,23 millions de décès en 2019. Elle est causée par une exposition importante à des particules et gaz nocifs. Si le tabagisme (actif et passif) est responsable de la majorité des cas dans les pays occidentaux, la BPCO peut avoir d’autres causes comme une exposition professionnelle à des poussières, mais encore la pollution de l’air intérieur (cuisine et chauffage au feu de bois ou au charbon…) dans les pays en voie de développement
Pour lire la suite , consulter le LIEN.
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
A Toulouse, une découverte majeure dans la prise en charge de lâinsuffisance rénale chronique |
|
|
| |
|
| |
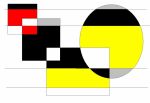
Des chercheurs et chercheuses du CHU de Toulouse, de l’Inserm et de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier ont récemment fait une découverte dans la compréhension et le traitement de l’insuffisance rénale chronique, une pathologie touchant des millions de personnes à travers le monde. Publiée dans Science Translational Medicine, cette avancée scientifique prometteuse repose sur l’identification de la responsabilité d’une protéine inflammatoire dans les complications graves de la maladie, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle approche thérapeutique.
La calcification vasculaire : une complication grave de l’insuffisance rénale
L’insuffisance rénale chronique touche 10% de la population adulte mondiale et jusqu’à 30% des personnes de plus de 70 ans en Europe.
L’une des principales complications de l’insuffisance rénale chronique est la calcification vasculaire, un phénomène au cours duquel des minéraux s’accumulent anormalement dans les parois des vaisseaux sanguins, provoquant leur rigidification et contribuant au développement de maladies cardiovasculaires graves, qui sont les principales causes de décès chez ces patients.
A date, les traitements à disposition ont des effets limités et ne permettent pas de prévenir ou de traiter la calcification vasculaire.
LIEN INSERM |
| |
|
| |
|
 |
|
DEVELOPPEMENT INTELLECTUEL |
|
|
| |
|
| |
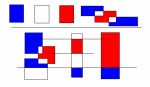
Syndrome de Cloves : Quand l’étude d’une maladie rare permet d’avancer sur des maladies plus répandues
Une équipe de recherche internationale pilotée en France par l’Inserm, le CNRS, le CHU Grenoble-Alpes, l’université Grenoble-Alpes, l’Assistance publique des hôpitaux de Paris – APHP et par l’université d’Essen en Allemagne, a réussi à identifier deux nouveaux gènes qui jouent un rôle dans l’apparition de troubles du développement intellectuel (TDI), en collaboration avec Sorbonne Université, le CHU de Nantes, l’université de Nantes et celle de Rouen-Normandie. Les scientifiques ont aussi réussi à développer deux nouveaux types de tests pour diagnostiquer le syndrome de Renu, une maladie rare associée aux mutations du gène RNU4-2 qui se manifeste, entre autres, par des retards de développement intellectuel. Ces résultats, publiés dans la revue Nature Genetics, reposent sur l’analyse de près de 24 000 génomes de patients français atteints de maladies rares. Ils permettent d’apporter un diagnostic à de nombreux patients qui étaient jusqu’alors dans l’errance diagnostique, en plus d’améliorer les connaissances sur les causes de ces maladies. Cette étude s’inscrit dans le cadre du plan France Médecine génomique piloté par l’Inserm.
Les troubles du développement intellectuel (TDI) correspondent à la « capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences (trouble de l’intelligence) », selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS)[1]. Cette limitation du fonctionnement adaptatif est visible dans divers secteurs d’aptitudes tels que la communication, les apprentissages scolaires, l’autonomie, la responsabilité individuelle, la vie sociale, le travail, les loisirs, la santé, ou encore la sécurité.
Ces troubles concernent environ 1 % de la population générale, d’après le ministère de la Santé[2]. Ils peuvent être liés à l’environnement ou à la génétique (plus de 1 680 gènes impliqués ont déjà été identifiés)[3], mais dans de nombreux cas, leur cause reste encore inconnue. Pour progresser dans la compréhension de ces maladies complexes, et identifier de nouveaux gènes associés à ces troubles, il était nécessaire de disposer de génomes entiers à étudier.
Grâce au déploiement du Plan France Médecine génomique 2025 piloté par l’Inserm, le séquençage de génomes entiers est maintenant proposé aux patients atteints de maladies rares ou de cancers pour orienter le diagnostic, le conseil génétique ou encore la prise en charge. Depuis son lancement en 2016, près de 100 000 séquençages ont déjà été effectués chez plus de 40 000 patients et leurs proches, fournissant aux scientifiques un vivier de données génétiques.
« Cette pratique a permis de poser un diagnostic pour environ 30 % des personnes concernées, parfois après des années d’impasse diagnostique, explique Frédérique Nowak, coordinatrice du plan France Médecine génomique 2025 à l’Inserm. Mais un autre objectif de ce plan était d’adosser la recherche aux données résultant de ces séquençages. »
Près de 24 000 génomes français
Ce second objectif est déjà atteint, à en croire les résultats d’une nouvelle étude supervisée par une équipe de recherche internationale franco-allemande[4]. À partir des analyses de 23 649 génomes de patients français atteints de maladies rares, auxquels en ont été ajoutés d’autres issus de collaborations internationales, le groupement de scientifiques a pu collecter une très large série de cas, confirmant l’implication majeure de deux gènes dans des troubles sévères du neurodéveloppement. Ces gènes codent pour des petits ARN, des molécules à la structure proche de l’ADN, qui appartiennent au « complexe majeur d’épissage ». Cette machinerie permet de « préparer » les ARN dits messagers, sortes de copies des gènes, avant qu’ils ne soient traduits en protéines.
« Ce travail a permis d’identifier 145 patients porteurs de mutations de novo, c’est-à-dire non transmises par les parents, dans le gène RNU4-2 et dix-huit patients en ce qui concerne le gène RNU5B-1, soit un nombre sans précédent de patients qui présentent une symptomatologie proche, notamment des retards de développement, des troubles du développement intellectuel, des microcéphalies ou encore des épilepsies résistantes aux traitements, indique Julien Thevenon, chercheur Inserm au sein de l’Unité 1029 , l’Institut pour l’avancée des biosciences (Inserm/CNRS/UGA), au CHU de Grenoble et co-dernier auteur de l’étude.
En procédant à des analyses sanguines, les équipes de recherche ont aussi réussi à développer deux nouveaux types de tests pour diagnostiquer le syndrome de Renu, la maladie rare associée aux mutations du gène RNU4-2 qui se manifeste, entre autres, par des retards de développement intellectuel et moteur, ou des troubles du langage.
Ces tests seront utiles en cas de difficulté à poser un diagnostic avec une analyse de l’ADN classique. Le premier, dit « transcriptomique », identifie la quantité et les caractéristiques des acides ribonucléiques (ou ARN) messagers produits lors de copie -ou transcription- d’une séquence génétique. Le second, dit épigénétique, étudie les modifications moléculaires qui surviennent sur l’ADN sans en modifier la séquence. Dans les deux cas, l’objectif est d’observer si ces caractéristiques se rapprochent de celles considérées comme la signature du syndrome de Renu.
La recherche a impliqué un grand nombre de chercheurs français affiliés aux deux laboratoires SeqOIA et AURAGEN, les deux seuls en France autorisés à effectuer les séquençages de génome entier (l’ensemble des chromosomes et des gènes de chaque patient) dans un cadre diagnostique.
« C’est un travail collectif et une bonne organisation de recherche qui doit encourager à renforcer la dynamique du plan France Médecine génomique », estime Caroline Nava, chercheuse au sein de l’Unité 1127, Institut du cerveau « Inserm/Sorbonne Université /CNRS) première autrice de l’étude. « C’est grâce à la puissance du nombre de données ainsi qu’aux collaborations avec des chercheurs du monde entier que nous pouvons effectuer de telles découvertes », abonde Christel Depienne, chercheuse à l’université d’Essen et co-dernière autrice de l’étude.
À la clé : apporter un diagnostic au plus grand nombre et sortir de l’errance diagnostique qui est une véritable épreuve pour les familles ; améliorer le conseil génétique en informant les parents sur le risque d’avoir d’autres enfants avec la même maladie, et enfin promouvoir le développement de thérapeutiques ciblant les mécanismes dysfonctionnels.
[1] https://www.who.int/southeastasia/health-topics/mental-health/key-terms-and-definitions-in-mental-health#intellectual
[2] handicap.gouv.fr/la-strategie-nationale-autisme-et-troubles-du-neurodeveloppement-2018-2022
[3] https://panelapp-aus.org/panels/250/
[4] Cette étude a été supervisée par Christel Depienne, chercheuse au CHU d’Essen en Allemagne, Julien Thevenon, chercheur Inserm à l’Institut pour l’avancée des biosciences et au CHU Grenoble-Alpes et Caroline Nava, chercheuse au sein de l’APHP et de l’Unité 1127, Institut du cerveau « Inserm/Sorbonne Université /CNRS)
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Lâentrée à lâÃcole élémentaire : le début des inégalités en mathématiques entre filles et garçons |
|
|
| |
|
| |

L’entrée à l’École élémentaire : le début des inégalités en mathématiques entre filles et garçons
12 Juin 2025 | Par Inserm (Salle de presse) | Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie | Santé publique
Une étude publiée le 11 juin 2025 dans Nature et menée sur près de 3 millions d’enfants scolarisés en France entre 2018 et 2022, coordonnée par Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, et par le Dr Pauline Martinot, médecin et neuroscientifique dans le cadre d’une thèse financée par l’Inserm, impliquant des scientifiques du CNRS, révèle que filles et garçons ont les mêmes performances en mathématiques à l’entrée au CP, mais qu’un écart se creuse très rapidement après cette entrée dans la scolarité en faveur des garçons.
La rapidité de formation de cet écart suggère que ce n’est pas une lente imprégnation de stéréotypes au fil des années qui en est à l’origine, mais bien l’entrée à l’école élémentaire, qui marque le début d’un enseignement formel des mathématiques. Ce constat devrait aider à mettre en lumière de nouveaux leviers d’action : en identifiant précisément l’enseignement des mathématiques comme un point de bascule dans la construction des inégalités, on aide à spécifier les moyens d’agir pour les prévenir et ainsi réduire durablement les écarts entre filles et garçons dans cette discipline.
Publiée ce mois-ci dans la revue scientifique Nature, cette recherche française constitue une première mondiale par son ampleur et la richesse des données mobilisées.
L’École, un lieu clé où les écarts se creusent
Grâce à une comparaison fine entre les cohortes scolaires – y compris celles affectées par la fermeture des écoles pendant la crise Covid -, les scientifiques montrent que les
écarts entre filles et garçons se creusent dès les premiers mois d’entrée au CP. Cet effet est observé dans tous les départements de notre pays, tous les milieux, et tous les types d’écoles. Il est plus particulièrement prononcé chez les filles issues de familles favorisées.
L’étude montre que ce n’est pas l’âge de l’enfant (donc ni la maturation du système nerveux ni l’accumulation de stéréotypes de genre au fil du temps) qui détermine l’apparition des écarts, mais bien le moment où l’enfant entre dans l’environnement d’apprentissage structuré qu’est l’école élémentaire. L’âge a même un léger effet protecteur vis-à-vis du développement de ces écarts.
L’analyse montre également que les filles sont en avance dans le domaine du langage, mais que ce n’est pas pour cette raison qu’elles délaissent les mathématiques. En effet, même parmi des paires de garçons et filles qui avaient précisément les mêmes résultats partout, y compris en langage, à l’entrée au CP, les écarts apparaissent toujours après 4 mois d’école.
Les scientifiques ont également tiré parti des données acquises pendant la pandémie de Covid-19. Cette année-là, les enfants ont été moins exposés à l’école, et les écarts entre garçons et filles en mathématiques se sont réduits par rapport aux autres années.
Fait notable : les compétences en langage ne présentent pas ces disparités. Les filles sont en avance sur les garçons dans la plupart des tests de langage. Ces différences préexistent à l’entrée à l’école, se réduisent un peu en cours d’année de CP, mais demeurent bien établies en début de CE1 et ont un écart quasi identique selon le contexte socio-économique de la famille de l’enfant.
D’autres recherches suggèrent que l’avantage des filles pour le langage ou la socialisation est présent en maternelle et pourrait être d’origine biologique. Cela souligne, en miroir, la spécificité du rapport filles-garçons aux mathématiques, et la responsabilité collective à y répondre.
Une collaboration française et internationale
Cette étude est le fruit d’une collaboration internationale avec plusieurs instituts de recherche (Inserm, CNRS, CEA, INRIA, Institut des politiques publiques, Paris School of Economics, Université Paris Saclay, Université Paris Cité, Université Grenoble Alpes, Université Aix-Marseille, Université Harvard), menée sous l’impulsion initiale du Conseil scientifique de l’Éducation nationale, en lien avec des chercheurs en sciences cognitives, en mathématiques et intelligence artificielle, en éducation, en économie et en psychologie sociale et du développement.
Elle met en évidence le potentiel de la recherche scientifique appliquée pour éclairer les politiques éducatives et illustre comment la recherche française, en s’appuyant sur des évaluations nationales massives et rigoureuses, peut contribuer à mieux comprendre les mécanismes d’apprentissage et à réduire les inégalités dès le plus jeune âge.
Les évaluations nationales, mises en place depuis sept ans par la Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP), visent à évaluer les acquis et les besoins de chaque élève. Les évaluations sur lesquelles repose cette publication ont été menées chez tous les enfants de France en début de CP, en milieu de CP, et en début de CE1, sur 4 années consécutives (2018-2021). Dans les semaines qui suivent chaque évaluation, tous les enseignants reçoivent les résultats détaillés de chaque élève de leur classe, ce qui leur permet de suivre leurs progrès et éventuellement d’adapter leur enseignement. Chaque enseignant transmet également aux parents les évaluations de leur enfant. Ce n’est que dans un second temps que des statistiques nationales peuvent être extraites et exploitées, comme dans cet article, pour analyser les caractéristiques systémiques de l’éducation nationale française.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
