|
| |
|
|
 |
|
LES MONTAGNES |
|
|
| |
|
| |
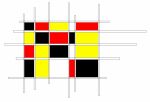
montagne
(latin populaire montanea, féminin du bas latin montaneus, du latin classique montanus, montagneux)
Consulter aussi dans le dictionnaire : montagne
Cet article fait partie du dossier consacré au monde.
Élévation naturelle du sol, caractérisée par une forte dénivellation entre les sommets et le fond des vallées.
1. GÉOLOGIE
1.1. LA FORMATION DES MONTAGNES
LES PREMIÈRES THÉORIES DE L'ORIGINE DES RELIEFS
Depuis l’Antiquité, les théories de l’origine des montagnes se succèdent. Ainsi, quelques savants grecs avaient déjà remarqué des pierres ayant la forme de coquillages, dont la présence laissait supposer que les sommets avaient jadis été recouverts par la mer. Ils avaient également souligné les modes d'érosion en observant les fleuves de boues, qui en dévalaient lors des fortes pluies et qui devaient progressivement les user.
Pour le philosophe français René Descartes, au xviie s., les montagnes datent de l'origine de la Terre et sont nées, lors de son refroidissement, de l'effondrement de compartiments de la croûte qui se sont chevauchés les uns les autres du fait du manque de place causé par le rétrécissement global.
C'est avec Horace Bénédict de Saussure, instigateur de la première ascension réussie du mont Blanc, en 1786, que l'approche scientifique des montagnes progresse. Le xixe s. voit s'affronter deux grandes théories : le neptunisme et le plutonisme. Selon la première, les montagnes se seraient formées au fond des mers, alors que, selon la seconde, elles tireraient leur origine du « feu » ou de la chaleur souterraine, qui injecte des granites à l'état liquide. Au xxe s., et jusqu'au début des années 1970, on enseigne que les montagnes proviennent du resserrement d'une succession de cuvettes marines dans lesquelles se sont déposées les couches et au fond desquelles a pu s'effectuer le métamorphisme ; c’ést le concept de géosynclinal.
LA TECTONIQUE DES PLAQUES
TYPOLOGIE ET MOUVEMENT DES PLAQUES
Depuis les années 1970, la théorie de la tectonique des plaques propose un modèle global de fonctionnement de la Terre (volcanisme aérien, volcanisme sous-marin, séismes et dérive des continents) dans lequel s'inscrivent les différents types d’orogenèse. L’enveloppe rigide de la Terre, ou lithosphère, est divisée en plaques qui naissent et se déplacent à la vitesse de quelques centimètres par an. Il existe deux types de nature de plaques : les fonds océaniques, composés de basaltes, et les continents, composés de granites et de roches associées. Seuls les fonds océaniques naissent et disparaissent. Les continents restent toujours présents à la surface, et constituent la mémoire de l'histoire géologique ; cependant, ils se déplacent au gré des mouvements des plaques et peuvent s'écarter, coulisser ou se rapprocher les uns par rapport aux autres.
Les plaques naissent au niveau des dorsales médio-océaniques par volcanisme sous-marin. Des nouvelles laves arrivent par des fissures, se solidifient et augmentent d'autant la surface des planchers océaniques, qui, progressivement, s'écartent de façon symétrique : on parle d'accrétion. Le volcanisme sous-marin met en place, au contact de l'eau, des laves qui prennent la forme caractéristique de coussins : les pillow-lavas. Les plaques disparaissent par subduction. Dans ce phénomène, une plaque plonge sous une autre plaque suivant un plan de coulissage dont les mouvements de frottement occasionnent des séismes violents et la naissance de magmas de composition intermédiaire entre le basalte et le granite: l'andésite. Dans le phénomène de subduction, c'est pratiquement toujours la plaque océanique qui plonge sous la plaque continentale, car, de nature basaltique, elle est plus dense (densité 3) que la plaque continentale granitique (densité 2,7).
L’OROGÉNÈSE
Les montagnes résultent d'une intense déformation de la croûte terrestre engendrée par la convergence de plaques (ou fragments de plaques) lithosphériques, animées de mouvements horizontaux. Plusieurs phénomènes interviennent dans la formation des reliefs. Tout d'abord, les portions de croûte coincées entre deux plaques qui se rapprochent sont, selon les matériaux et la nature des plaques en présence, comprimées et plissées (Atlas, Zagros) ou débitées en larges écailles, qui se superposent pour donner de grands chevauchements ou des nappes de charriage (Alpes, Himalaya). Par ailleurs, l'épaississement de croûte induit par le plissement entraîne une fusion partielle en profondeur et la montée de magmas qui, en cristallisant, augmentent encore l'épaisseur de la croûte (Andes du Pérou, Sierra Nevada aux États-Unis) et engendrent des mouvements verticaux de rééquilibrage (poussée d'Archimède) à l'origine des hauts reliefs. Enfin, la remontée de laves volcaniques en surface peut également accroître l'altitude des sommets (Cascades, Andes de Colombie).
Les massifs anciens comme le Massif central ou les Vosges ont dû connaître un mode de formation similaire à celui des chaînes récentes du type Himalaya, bien qu'aujourd'hui largement effacé par des centaines de millions d'années d'érosion. Leur structure actuelle correspond à des blocs faillés soulevés, interrompus par les compartiments affaissés de la Limagne ou du fossé d'Alsace. L'étirement de la croûte a permis aussi la remontée locale de laves et le développement de formes volcaniques typiques (chaîne des Puys, volcans du Rift africain). Ainsi, les Pyrénées sont nées du coulissage et du pivotement de l'Espagne – le bloc ibérique –, qui n'occupait pas sa position actuelle il y a 150 millions d'années. Les Alpes ont surgi lors de la collision entre l'Italie – petit compartiment détaché de l'Afrique – et le sud de l'Europe. L'Himalaya correspond à la zone du choc entre l'Inde et l'Asie. La cordillère des Andes jalonne la limite entre un continent, l'Amérique du Sud, et un océan, le Pacifique.
LES INDICES DE L'HISTOIRE DES MONTAGNES
LES ROCHES
Les chaînes de montagnes présentent une grande diversité de roches, réparties en quatre grands types : sédimentaire, métamorphique, plutonique et volcanique.
Dans leur grande majorité, les roches sédimentaires, comme les grès (anciens sables), les argiles, les marnes et les calcaires, datent des époques où les actuels domaines montagneux étaient sous la mer. Les fonds marins subissaient alors diverses conditions de sédimentation en fonction de leur profondeur, de leur éloignement des rivages, de la présence de hauts-fonds intermédiaires, des régimes des courants, des climats, etc. La sédimentation calcaire, parfois d'origine corallienne, a créé des couches constituant aujourd'hui les barres calcaires qui marquent les paysages par des plateaux et des falaises souvent abruptes, comme dans l'ensemble des chaînes subalpines.
Dans le contexte des phénomènes de compression d'une orogenèse, des roches d'origines diverses se trouvent enfouies en profondeur et subissent alors des augmentations de pression et de température. Elles se transforment progressivement par métamorphisme : apparaissent un feuilletage appelé schistosité et de nouveaux minéraux comme les grenats. Les principales roches métamorphiques sont les quartzites, les marbres, les schistes, les amphibolites et les gneiss.
Les granites sont des roches plutoniques fréquentes dans les massifs montagneux, surtout quand ils sont anciens. Ils naissent du refroidissement lent de magmas d'une composition chimique différente de celle des laves habituelles (basaltes, andésites, etc.). En se refroidissant, les éléments cristallisent et les minéraux se forment : d'abord les micas, puis les feldspaths, puis le quartz. Les chaînes de montagnes peuvent présenter deux grands types de granites : ceux datant des orogenèses précédentes et qui ont été rehaussés – c'est le cas le plus fréquent –, et ceux contemporains de la chaîne, beaucoup plus rares car actuellement situés en profondeur et non encore visibles. En montagne, il n'est pas rare de rencontrer des fissures contenant des cristaux de quartz. Ces « fours », comme les appellent les cristalliers, se sont formés, à une profondeur d'une dizaine de kilomètres et à une température d'environ 400 à 450 °C, par circulation de fluides riches en silice qui se déposent autour de la fissure ouverte.
Dans les chaînes de montagnes plissées, on peut observer des roches volcaniques qui, selon leurs origines, peuvent être classées en deux groupes principaux : celles qui correspondent à un volcanisme aérien, ancien ou actuel, lié à des phénomènes de subduction de type andin ou japonais, et celles qui ont appartenu au plancher océanique puis ont été portées en altitude par des charriages et des chevauchements lors des collisions continentales ; on parle alors d'ophiolites ou de complexes ophiolitiques.
LES FOSSILES
La présence de fossiles est un indicateur précieux pour reconstituer l'histoire d'une chaîne. Ils sont généralement marins, et permettent à la fois de dater les couches de terrains sédimentaires et de reconstituer les milieux dans lesquels ils vivaient. On retrouve dans l'Himalaya, jusqu'à 5 000 m d'altitude, des fossiles d'ammonites qui datent de l'ère secondaire. De même, à La Mûre (dans le Dauphiné), des fossiles de fougères livrés par des niveaux associés au charbon ont permis de reconstituer le milieu écologique des forêts marécageuses intramontagneuses qui existaient il y a 320 millions d'années, à la fin de la surrection hercynienne, bien avant l'ouverture de l'océan alpin. Les fossiles peuvent également être des traces ou des figures de courants, comme des rides (ripple-marks) sur le sable d'anciennes plages, parfaitement conservées dans des grès du trias datant de 230 millions d'années.
1.2. LES TYPES DE CHAÎNES
TYPES MORPHOLOGIQUES
Les grandes chaînes de montagnes actuelles peuvent être regroupées selon trois types morphologiques majeurs :
Les Andes sont le type même de la chaîne de subduction, formée au contact d'une plaque océanique qui plonge sous un continent. L'épaisseur de la croûte est maximale (70 km). La montagne est bordée par une série de gradins de failles culminant à plus de 5 000 m au niveau de l'Altiplano.
Dans les chaînes de collision comme l'Himalaya, deux continents s'affrontent : le continent mobile ne pouvant plonger sous l'autre (sa croûte est trop légère), il est affecté par de grands cisaillements qui sont déplacés sur des distances considérables (plusieurs centaines de kilomètres) et sont à l'origine de reliefs dissymétriques imposants. L'avant-pays est affecté de plis ou plis-failles, donnant une morphologie de crêtes, monts et vaux si l'érosion est peu avancée (Siwalik de l'Himalaya), ou de reliefs contraires de combes et vaux perchés en cas de dissection poussée (Préalpes).
Les chaînes intracontinentales (à l'intérieur d'un continent) résultent du contrecoup de collisions plus lointaines. De type plissé, elles se forment au niveau de zones de faiblesse, par serrage de bassins sédimentaires (Haut Atlas marocain) ou par coulissage et compression le long de chaînes décrochantes (Tian Shan).
Si on s'en tient au simple aspect géographique, on peut distinguer trois principaux types de montagnes : les chaînes plissées, les structures massives et les systèmes volcaniques.
La plupart des chaînes de montagnes récentes sont des chaînes plissées, dans les reliefs desquelles on peut distinguer des plissements, des failles, des chevauchements anormaux et des charriages (déplacements horizontaux sur plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres, de secteurs géologiques complets) plus ou moins importants. Les Alpes, l'Himalaya, la chaîne du Zagros (en Iran), l'Atlas marocain ou le Jura montrent de telles structures plissées ; celles-ci témoignent des mécanismes de raccourcissement, dus aux collisions des plaques qui les ont fait naître.
Les structures massives caractérisent plus généralement d'anciennes montagnes, usées, qui ont été de nouveau soulevées lors d'événements tectoniques récents. De grandes failles délimitent des unités plus ou moins importantes dont le relief a été rajeuni. C'est le cas du Massif central ou des Vosges. Les compartiments soulevés forment un horst alors que les zones affaissées dessinent un graben, ou fossé d'effondrement, comme la plaine de la Limagne, entre l'Auvergne et le Forez.
Le troisième type de montagnes correspond au volcanisme. Ainsi, les monts du Kenya (en Afrique équatoriale), les sommets de l'Islande (dans l'Atlantique Nord) ou l'île de la Réunion (dans l'océan Indien) présentent une origine strictement volcanique, par accumulation des laves et des projections. De même, le mont Ararat (à la frontière entre la Turquie et l'Iran) est une montagne volcanique, de 5 000 m d’altitude, isolée dans le paysage.
Cependant, plusieurs types d'origines peuvent s'ajouter les uns aux autres. Les montagnes du Hoggar (au cœur du Sahara) correspondent à un dôme granitique sur lequel sont venues se surimposer des manifestations volcaniques. Dans les Andes, des volcans forment souvent des sommets élevés qui se superposent à l'ensemble de la structure plissée de la chaîne.
TYPES GÉOGRAPHIQUES
Les grandes chaînes de montagnes actuelles se répartissent géographiquement suivant deux grandes lignes principales bien définies à la surface de la Terre :
– Les chaînes péripacifiques sont associées à de fortes activités sismiques et volcaniques : les cordillères américaines, de l'Amérique du Sud à l'Alaska, jalonnent une limite entre continent et océan chaînes de du Pacifique Ouest se répartissent suivant un chapelet d'îles: Kamtchatka, Japon, Indonésie, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande.
– Les chaînes alpines s'étendent du Maroc jusqu'au Sud-Est asiatique. Elles s'inscrivent à l'intérieur des structures continentales et comprennent l'Atlas, les Pyrénées, les Alpes, les chaînes dinariques et turques, le Caucase, les montagnes d'Iran et d'Afghanistan, l'Himalaya et les chaînes de Birmanie.
1.3. PRINCIPALES STRUCTURES GÉOLOGIQUES
Nées pour la plupart de la convergence de deux plaques tectoniques, les chaînes de montagnes montrent des structures qui témoignent des raccourcissements subis par des régions entières.
LES FAILLES
Les contraintes exercées sur les roches peuvent provoquer leur fracturation et le coulissage d'un des compartiments rocheux par rapport à l'autre. On peut distinguer deux principaux types de failles : les failles normales, dont le compartiment situé au-dessus du plan de faille s'est affaissé, et les failles inverses, dont le compartiment situé au-dessus du plan de faille s'est soulevé et est venu chevaucher les terrains sous-jacents. Les failles normales, datant de l'ouverture de l'océan, qui a précédé la formation de la chaîne, traduisent des contraintes d'extension, et les failles inverses, se formant lors des phases de rapprochement et de collision, résultent des contraintes de compression. Ces accidents ne sont généralement pas isolés, mais groupés en réseaux; ceux-ci peuvent délimiter des compartiments de socle dont les uns se soulèvent (horst) alors que les autres s'affaissent (graben). Les massifs cristallins externes des Alpes (Mont-Blanc, Belledonne, Pelvoux, Argentera) ont été soulevés en altitude par un ensemble de failles.
LES PLIS ET LES CHEVAUCHEMENTS
Les plissements sont des déformations souples des roches formées en profondeur (les terrains situés au-dessus ont été ensuite décapés par l'érosion, laissant apparaître des plis dans le paysage actuel) et dessinant des courbes et des ondulations plus ou moins régulières, symétriques ou déversées. La partie creuse du pli se nomme synclinal, la partie bombée anticlinal. L'érosion peut jouer sur les plissements et venir créer des structures particulières, comme les synclinaux perchés. Ce type de relief naît quand les anticlinaux qui étaient de part et d'autre du pli ont été plus fortement érodés que ce dernier. C'est le cas du désert de Platé, à l'ouest du massif du Mont-Blanc (en Haute-Savoie).
Les contraintes latérales, qui font naître les plis, peuvent être si fortes que ceux-ci se déversent, s'étirent et se cassent. Si les contraintes de raccourcissement continuent, la partie supérieure du pli et toute la couche qui suit peuvent se déplacer sur des dizaines de kilomètres. On parle alors de nappes de charriage. Il est parfois difficile de retrouver la zone de départ et les racines d'origine de la nappe. De grandes nappes de charriage caractérisent les structures des Alpes internes : nappes ultra-helvétiques en Suisse, nappe des schistes lustrés à la frontière franco-italienne, nappe du flysch à helminthoïdes dans la région d'Embrun (Hautes-Alpes) et plus au sud. Dans la complexité des mouvements orogéniques, les phénomènes de charriage peuvent parfois s'inverser et venir disposer les roches dans un ordre totalement inverse de celui de leur dépôt. On rencontre de telles structures dans les Alpes, comme à Ceillac (dans le Queyras), où les roches sont disposées à l'envers : les niveaux du crétacé sont à la base de la montagne, les niveaux plus anciens du jurassique sont au-dessus, et ceux du trias constituent les sommets.
Les grands chevauchements correspondent à des compartiments entiers de la chaîne de montagnes et de son socle lithosphérique qui passent par-dessus d'autres terrains sur plusieurs kilomètres d'épaisseur. Ils forment ainsi de véritables écailles de croûte terrestre. De cette façon, le haut Himalaya chevauche le moyen Himalaya, qui lui-même chevauche la plaine du Gange (en Inde).
2. GÉOGRAPHIE
2.1. LES PRINCIPAUX SOMMETS DU MONDE
LES PRINCIPAUX SOMMETS DU MONDE
2.2. L'ÉROSION EN MONTAGNE
Les montagnes sont aux prises, dès qu'elles commencent à s'élever, avec les forces de destruction, qui deviennent de plus en plus mordantes à mesure que l'édifice grandit. En altitude, les violents contrastes de température peuvent disloquer les roches ou accentuer leur porosité, en préparant ainsi l'action du gel ; celui-ci dilate l'eau qui imprègne les vides, et fait éclater les assises, dont les débris roulent sur les pentes en éboulis. L'eau courante intervient à son tour, s'empare des matériaux épars, qui accroissent sa charge, creuse ainsi le sillon d'un torrent qui balafre le flanc de la montagne. Le rôle de la neige et celui de la glace sont aussi importants. La neige glissant des crêtes s'accumule dans les fonds, où elle se transforme en glace ; celle-ci fait reculer les parois des cavités où elle s'amasse, et les aménage en cirques, dont les rebords jointifs s'aiguisent en arêtes, puis en aiguilles. Débordant des cirques, la glace progresse dans les vallées en énormes fleuves qui modèlent les formes du sillon où ils s'engagent ; là aussi, les parois sont redressées, tandis que le fond s'élargit, donnant à la vallée glaciaire la forme d'une « auge ».
Ainsi l'érosion modifie les formes originelles, en fonction de l'altitude, de la nature des roches, de la disposition des assises et du type de climat. Plus le volume saillant est considérable, plus l'érosion est puissante, et plus la montagne sera déchiquetée et évidée. Si la roche offre peu de joints où peut se glisser le gel, elle résistera mieux que celle qui est « gélive » ; des assises dures et solidement liées seront moins aisément entamées par l'eau courante ou par le flot de glace. Certaines roches sont moins sensibles que d'autres à l'érosion chimique. Des plis serrés et disloqués exposent aux attaques des roches variées, et facilitent la désintégration. Enfin, le climat tient un rôle capital. Dans les régions tempérées fraîches, tous les facteurs érosifs sont réunis pour travailler activement ; les variations brusques de température, le gel, la puissance des eaux et des glaces combinent leurs effets pour ciseler la montagne. Les hautes terres des régions désertiques, où l'eau courante est trop rare pour entraîner les abondants produits de la « desquamation », s'ensevelissent peu à peu sous leurs propres débris. Les régions tropicales assorties d'une forte saison humide juxtaposent les chicots rocheux laissés par l'érosion chimique, et de formidables tranchées d'érosion. À peine nés, les grands volcans tropicaux sont griffés de « barrancos », qui érodent leurs flancs.
2.3. LE CLIMAT
TEMPÉRATURES
L'altitude affecte d'abord les températures : à 100 m de montée correspond une diminution moyenne de 0,6 °C : ainsi, à 1 000 m d'altitude, la température est inférieure de 6 °C à celle du niveau de la mer. Toutefois, les versants exposés au soleil (« soulanes » pyrénéennes, « adrets » alpins) sont, à altitude égale, plus chauds que les versants à l'ombre, les « ubacs ». De plus, aux saisons fraîches, lorsque l'air froid, plus lourd, vient s'accumuler en bas, les pentes souffrent moins des gelées que les dépressions qu'elles dominent. La température moyenne annuelle de l'air baisse en fonction de l'altitude ; en contrepartie, le sol reçoit une irradiation plus forte et s'échauffe davantage. Mais, à l'ombre ou la nuit, le sol se refroidit facilement, car l'air, peu dense, permet une déperdition de chaleur plus importante que celle observée en plaine : on peut avoir en montagne une alternance de gel nocturne et de fortes chaleurs diurnes. Ce phénomène est plus intense dans les montagnes équatoriales, où la durée de la nuit est presque égale à celle du jour, et cela toute l'année ; ce n'est pas le cas dans nos régions où, l'été, la période d'éclairement journalier est très longue par rapport à la période obscure.
VENTS
Par ailleurs, la montagne est affectée de vents d'un type particulier, qui peuvent modifier les températures. Lorsqu'un imposant flux d'air dépendant de la circulation atmosphérique générale traverse une chaîne, il est, à la descente, canalisé avec violence dans les vallées ; il s'échauffe, fait monter rapidement les températures et dévore la neige : c'est le chinook des Rocheuses (aux États-Unis), le fœhn des Alpes. En été, le soleil fait s'élever sur les pentes, en fin de matinée, les couches d'air ; il en résulte un appel d'air du bas vers le haut, qui remonte les vallées, parfois avec impétuosité, et qui tempère, sur les versants, les chaleurs estivales ; en revanche, pendant la nuit, l'air redescend les pentes et suit les vallées en brises fraîches.
HUMIDITÉ
Cependant, avec l'abaissement de la température, l'influence capitale de la montagne sur le climat est le renforcement de l'humidité. Les masses d'air que la circulation atmosphérique dirige vers les hautes terres se refroidissent en montant, et, dès lors, condensent leur humidité, qui se résout en pluie et en neige. Aussi la montagne est-elle toujours plus arrosée que les terres basses qui l'avoisinent. Les hautes terres sont de véritables châteaux d'eau ; mais, souvent, les eaux sont « mises en réserve », pendant un temps, sous forme de neige ou de glace. En dehors des latitudes polaires, les glaciers sont aujourd'hui localisés seulement dans les montagnes, et cela jusque dans les régions tropicales, pourvu que l'altitude soit suffisante. Ainsi alimentés, les cours d'eau montagnards sont d'une rare abondance ; les puissants débits sont d'ailleurs soumis à des saccades dès que la neige et la glace concourent à leur alimentation. Ils se réduisent à l'extrême l'hiver, lorsque les précipitations atmosphériques tombent sous forme solide, mais sont grossis au printemps avec la fonte des neiges. Ils restent soutenus l'été si des glaciers sont tapis dans les hauts bassins.
2.4. LA VÉGÉTATION
DE L’IMPORTANCE DU CLIMAT
Le paysage végétal change selon l'altitude, chaque niveau portant un « étage de végétation » (ou « ceinture végétale ») caractéristique. Cette diversité est provoquée essentiellement par les conditions climatiques.
En effet, plus on s'élève, plus l'air se raréfie et moins il retient les radiations solaires. L'importance du rayonnement en montagne accentue donc en altitude les effets de l'exposition, surtout aux latitudes moyennes, bien plus que vers l'équateur où le soleil est presque au zénith : les flancs des vallées au soleil portent des landes à genêts, des pins sylvestres, des chênes, tandis que le versant à l'ombre porte des sapins.
Les précipitations créent, l'hiver, un manteau neigeux qui, dans les Alpes françaises, est d'une durée de quatre mois à 1 000 m, de six à 1 500 m, de sept à 1 800 m et de neuf à 2 400 m, et raccourcit d'autant la période végétative. Mais, suivant les facteurs topographiques, cette durée moyenne varie beaucoup ; ainsi, sur certaines crêtes ventées, la couverture neigeuse peut être faible et courte, alors que, dans certaines dépressions abritées, la neige peut, à moyenne altitude, persister tout l'été et permettre l'installation d'un tapis végétal dont la microflore, chionophile, est adaptée à une vie prolongée sous la couverture de neige (saules nains, soldanelles). Ce tapis neigeux crée une surcharge pondérale qui peut provoquer brisures et arrachements lorsque des paquets de neige glissent. Mais cette couche neigeuse a aussi une action bénéfique sur la végétation, en la protégeant des gelées, qui détruisent les organes non aoûtés s'ils ne sont pas protégés, ce qui explique le nanisme de certains arbustes (rhododendrons), dont seuls les rameaux protégés par la neige peuvent supporter le climat hivernal. Ainsi, les pentes exposées au nord ont une végétation arbustive bien fournie, car le manteau neigeux la met à l'abri des alternances de gel et de dégel, si fréquentes au printemps sur les faces exposées au sud.
Enfin, l'humidité atmosphérique, assez élevée dans l'étage montagnard (1 000 m-1 600 m), crée à ce niveau une zone très fréquente de brouillards et de nuages (mer de nuages) qui, dans les Alpes et les Pyrénées, permet l'installation de forêts bien fournies (hêtres, sapins). Dans les étages subalpin et alpin, au contraire, l'humidité atmosphérique diminue nettement, d'où la grande limpidité de l'air. L'intensité lumineuse, qui y est moins filtrée qu'en basse altitude, est dans l'ultraviolet quatre fois plus intense qu'au bord de la mer ; elle est peut-être un facteur déterminant de certaines particularités morphologiques et physiologiques : faible longueur des entre-nœuds, couleur très vive des espèces de haute altitude. Le rayonnement cosmique, dix fois plus important à 6 000 m qu'au niveau de la mer, pourrait avoir une action déterminante en augmentant fortement le taux des mutations.
Le vent est aussi un facteur d'une importance biologique considérable, car il dessèche les végétaux non protégés par la neige et détruit, par son action brutale, les jeunes bourgeons ou les jeunes pousses, réduisant ainsi la taille de certaines espèces ou donnant à d'autres une forme en « drapeau » (anémomorphose).
LES ÉTAGES DE VÉGÉTATION (MONTAGNES DU BASSIN MÉDITERRANÉEN)
Étagement de la faune et de la flore en montagne (Alpes).
Ces conditions climatiques déterminent, suivant l'altitude, les étages de végétation, parmi lesquels on distingue, en France :
1° un étage collinéen (de 0 à 600-700 m), qui, dans la région méditerranéenne, est caractérisé par la présence de chênes-lièges, de pins d'Alep et, au-dessus, par des peuplements de chênes verts ;
2° un étage montagnard (entre 600-700 m et 1 600 m), qui est surtout le domaine du hêtre, accompagné suivant les régions du pin sylvestre ou, comme en Corse, à la base de cet étage, du pin laricio. Dans les Pyrénées orientales, le sous-bois de la hêtraie est peuplé de myrtilles, de luzules et d'aspérules, qui peuvent évoluer vers la lande (à buis sur sol calcaire ou à genêts sur sol siliceux). Dans la partie centrale des Pyrénées, plus sèche que la partie orientale, la hêtraie fait place aux peuplements de pins sylvestres avec des sous-bois de raisin d'ours (busserole) ; les landes sont peuplées de genêts et de genévriers communs ;
3° un étage subalpin (1 600 m-2 400 m), qui possède surtout des peuplements de pins à crochets formant, dans les Pyrénées, de belles forêts. À cet étage, dans les massifs centraux des Alpes, à climat plus continental, le mélèze remplace le hêtre ; on y trouve également le pin cembrot et l'épicéa, qui, lors de leur migration au cours du quaternaire, n'ont pu atteindre les Pyrénées ; l'aulne vert est encore assez fréquent à ce niveau. Cet étage subalpin est aussi occupé par de grands peuplements d'arbustes : rhododendrons, myrtilles et genévriers nains, ainsi que par des pelouses à fétuques et à Carex sempervirens . De nombreux oiseaux comme les pics ou les tétras vivent à cette altitude ;
4° un étage alpin, absent des massifs externes des Alpes, est surtout défini par l'absence d'arbres et par un appauvrissement très net de la flore. Les pelouses y tiennent donc une grande place ; sur sol acide, elles sont surtout caractérisées par Carex curvula et par Carex firma sur les sols calcaires. Dans les Alpes, la petite renoncule des glaciers est la plante qui atteint la plus forte altitude (4 270 m) ; deux mousses ont été retrouvées à 4 400 m au mont Rose, deux lichens se rencontrent encore à 4 700 m dans le massif du Mont-Blanc. C'est aussi le domaine de prédilection d'animaux caractéristiques tels que les chamois, les bouquetins, les choucas, les marmottes ou les perdrix des neiges, appelées lagopèdes.
Cette schématisation des étages est la même dans toutes les montagnes entourant le bassin méditerranéen, comme les Apennins, les Alpes dinariques, les chaînes de la péninsule balkanique et d'Anatolie, le Caucase et les chaînes d'Afrique du Nord. Mais, pour chaque région, la flore sera particulière, au moins en partie.
LES ÉTAGES DE VÉGÉTATION (AUTRES ÉCOSYSTÈMES)
Ailleurs dans le monde, les étages de végétation n’ont pas les mêmes caractéristiques.
HIMALAYA
La chaîne himalayenne, dans sa partie méridionale, la plus arrosée, porte une végétation extrêmement riche et une très grande variété dans les peuplements, qui s'étagent sur plus de 4 500 m. À la limite de la plaine cultivée, le terai correspond à une jungle marécageuse couverte de roseaux et de hautes herbes ; dans certaines parties sèches se localise une forêt claire avec un riche sous-bois de buissons et de hautes herbes rigides. Au-dessus, dans la zone où les condensations sont les plus importantes, existe une superbe forêt tropicale à bambous (plus de 30 m), aux arbres géants couverts d'épiphytes et de lianes ; vers 1 500 m, on rencontre une forêt où les essences tropicales sont en mélange avec des chênes, des bouleaux, des érables et des ronces. Entre 2 000 et 3 000 m, on trouve de belles forêts d'arbres à feuilles caduques (chênes, châtaigniers, noyers, bouleaux), avec de remarquables peuplements de magnolias ; ces arbres sont également couverts d'épiphytes (orchidées), de mousses et de lichens gorgés d'humidité. Au-dessus de 2 700 m, le sapin argenté est de plus en plus fréquent. À cette altitude apparaissent les rhododendrons, qui vont prédominer dans l'étage subalpin, zone qui, au fur et à mesure que l'on s'élève, devient de plus en plus sèche. Dans la zone alpine (4 000 à 5 000 m), on retrouve encore des rhododendrons ; la steppe alpine culmine vers 5 500 m dans les vallées intérieures.
MONTAGNES ROCHEUSES
Dans les Rocheuses méridionales, la forêt occidentale mésophile est caractérisée, dans son niveau inférieur, par des peuplements de pins (Pinus ponderosa), avec des sous-bois à genévriers et diverses graminées xérophiles jusqu'à 2 400 m. Au-dessus, les précipitations sont de l'ordre de 500 mm et le sapin de Douglas domine progressivement. Vers 3 000 m, on trouve une forêt d'épicéas avec un sous-bois d'airelles ; au-dessus de 3 500 m, l'étage supraforestier est une prairie alpine rase et dense, composée essentiellement de cypéracées (kobresia), avec de nombreuses plantes naines à feuilles en rosette ou en coussin, à grandes fleurs très colorées (gentianes, primevères, saxifrages, myosotis) présentant les caractéristiques de la flore alpine.
MEXIQUE
Au Mexique, dans les basses plaines du golfe, jusqu'à 800 m, on est en présence d'un étage tropical humide où se rencontrent des ficus, des palmiers, des dendropanax, avec des épiphytes ; au-dessus, l'étage semi-tropical, jusqu'à 2 000 m, est caractérisé par des feuillus (chênes verts, arbousiers) ; entre 2 000 et 4 000 m se situe un étage froid où l'on peut distinguer, de la base au sommet, un sous-étage à pins, chênes et cyprès, un deuxième à Abies religiosa très humide, et enfin un troisième peuplé de pins qui, vers 4 000 m, sont de moins en moins abondants, et de genévriers ; les hauts sommets sont couverts de prairies à graminées, lupins et eryngiums ; les neiges éternelles commencent à 4 500 m.
CORDILLÈRE DES ANDES
Dans le nord de l'Amérique du Sud, le pied des montagnes est couvert par la forêt ombrophile, à laquelle fait suite une forêt humide subtropicale, qui se termine à 2 500 m. Au-dessus, la ceja est une forêt rabougrie très dégradée. À partir de 3 300 m et sur une dénivellation de 1 000 m, on rencontre une formation humide, le páramo, dominée par les graminées, avec des broméliacées et des composées. Les hauts sommets correspondent à un étage alpin et sont caractérisés par des plantes en coussins (azorella), qui peuvent vivre encore à 5 100 m. Dans les Andes, vers le 38e degré de latitude, apparaît la forêt d'araucarias (Araucaria imbricata), à laquelle font suite, entre le 39e et le 40e degré, de 700 à 1 100 m, la forêt de hêtres à feuilles pérennes (Nothofagus pumila) et un sous-bois de bambous ; plus au sud, au 50e degré, on trouve le Nothofagus antarctica, dont les derniers éléments culminent vers 900 m.
AFRIQUE ÉQUATORIALE
En Afrique équatoriale, en particulier dans le Ruwenzori, on trouve jusqu'à 1 000-1 200 m une formation hygrophile, obscure et à nombreuses lianes et épiphytes ; au-dessus, vers 1 600-1 700 m, succède à cette forêt une sorte de parc-savane qui précède, vers 2 000 m, une savane à très hautes graminées ; entre 2 200 et 3 000 m, on retrouve une forêt de montagne à podocarpus, fougères arborescentes et bambous ; vers 3 500 m, la température s'abaisse fortement et la nébulosité augmente ; on découvre là une brousse à bruyères arborescentes et à fougères, couverte de lichens pendant des branches ; des sphaignes y forment un épais matelas spongieux ; entre 3 500 m et 4 000 m se localise, sous un climat plus sec que l'on peut comparer à celui de l'étage subalpin de nos montagnes, une étrange formation, unique au monde, de seneçons arborescents, de lobelias géants, accompagnés d'éricacées et d'immortelles. Enfin, à partir de 4 000 m, l'étage alpin terminal est caractérisé par une prairie rase, où vivent des espèces peu éloignées de celles de l'Europe (fétuques, paturins, renoncules, gentianes, primevères, achillées, hélichrysums, etc.). Au-dessus de 4 800 m, il n'y a plus que les neiges éternelles et les glaciers.
ASIE DU SUD-EST
En Asie du Sud-Est, aux Philippines et en Indonésie, jusqu'à 1 200 m, on est en présence de la forêt ombrophile très dense, et, au-delà, d'une forêt de feuillus à feuilles épaisses (lauracées, myrtacées, magnoliacées), des palmiers lianoïdes, des fougères arborescentes et de nombreux peuplements de bambous. Au-dessus de 2 500 m apparaît une forêt basse, aux arbres tordus et nains, à laquelle succèdent d'épaisses broussailles aux petites feuilles et un maquis à rhododendrons qui correspond à l'étage subalpin. Plus haut se situe un étage alpin avec primevères, gentianes, potentilles...
2.5. LA MONTAGNE ET L'HOMME
Toutes les activités de montagne sont affectées par la pente, surtout l'agriculture, qui doit s'accommoder de versants raides, où il faut parfois étager les champs en terrasses, remonter la terre qui a glissé. Dans certains pays, faute de chemins, tout doit être exécuté à bras, travaux et transports. Par ailleurs, les glissements de terrain, les éboulements et les chutes de pierre constituent un danger fréquent ; lorsqu’ils se combinent avec de violentes averses ou de brutales fusion de neige, ils accroissent les ravages des eaux : les ravins griffent le sol, les lits des torrents charrient d'énormes masses de matériaux et, dans les vallées, l'inondation peut provoquer des ravages. Enfin, la neige cloître les hommes et leurs bêtes dans les demeures, déchaîne des avalanches.
Pourtant, la montagne possède de nombreux attraits. Grâce à ses replis, elle constitue notamment un refuge, dont les difficultés d'accès rebutent l'assaillant. En outre, elle possède un air vif et salubre (qui attire les populations), des alpages (qui permettent la transhumance du bétail), de belles forêts, des eaux abondantes (dont l'énergie est exploitée pour des activités industrielles) et recèle des filons métallifères. C’est pourquoi très rares sont les montagnes restées dépeuplées ; il en est même où les hommes sont plus nombreux que dans les dépressions voisines, comme en Kabylie, dominant la vallée de la Soummam, ou au Liban, au-dessus de la Beqaa.
LA VIE EN MONTAGNE
Le relief entraîne de grandes dépenses d'énergie. Il disperse aussi les étendues exploitables en emplacements presque toujours restreints et souvent difficilement accessibles. Enfin, la saison au cours de laquelle peuvent s'effectuer les travaux est brève.
Les paysans des hautes terres ont donc vécu en véritables nomades, parcourant sans cesse les divers étages de leur terroir, grimpant aux alpages et redescendant aux champs, possédant souvent plusieurs demeures à des paliers différents, où l'on s'installe pour quelques semaines, telles les « remues » de Savoie. Se posait le problème de la longue saison morte, où il fallait subsister sans rien produire ; ils l'ont résolu par l'émigration temporaire.
Cet équilibre séculaire s'est rompu depuis le milieu du xixe s., dans les montagnes des pays tempérés. Pénétrés par des voies ferrées et des routes, ces massifs se sont trouvés aux prises avec le monde moderne, tout en ne disposant que de méthodes surannées. L'émigration saisonnière vers les terres basses a disparu depuis que le colportage n'est plus rentable et que les machines agricoles dispensent de recourir à la main-d'œuvre montagnarde ; dès lors, les hautes régions se sont trouvées surpeuplées, car leur médiocre agriculture était hors d'état d'assurer à elle seule la subsistance d'une population trop nombreuse. L'émigration définitive a pris le relais des départs temporaires.
L'hydroélectricité, puis le tourisme ont partiellement compensé cette évolution. Depuis 1869, on tire parti de la force des torrents ; la montagne s'est garnie de centrales qui fournissent une énergie considérable, et une partie de cette puissance a pu être utilisée sur place, dans des usines de transformation où s'emploie la main-d'œuvre locale. Mais ces industries ne peuvent s'installer que dans quelques vallées privilégiées, bien pourvues de moyens de transport. Le tourisme est venu à la rescousse, et des foules de plus en plus nombreuses envahissent la montagne, été comme hiver. Houille blanche, industrialisation et tourisme, s'ils ont limité globalement le dépeuplement (c'est particulièrement vrai dans les Alpes françaises du Nord), ont surtout contribué à concentrer cette population sur des sites privilégiés (développement spectaculaire des villes comme Grenoble et Annecy en France, ou Innsbruck, en Autriche), souvent d'ailleurs à la périphérie ou presque des massifs. Demeure le problème du maintien d'une population à vocation au moins partiellement agricole, permettant la sauvegarde du milieu naturel, que menace d'ailleurs parfois le développement « sauvage » du tourisme de masse. La création de parcs ou réserves, nationaux et régionaux, répond à ce souci.
L'ENJEU TOURISTIQUE
L’ATTRAIT DE LA MONTAGNE
C'est sans doute à Jean-Jacques Rousseau que l'on doit les premiers textes célébrant le côté merveilleux de la nature en montagne. À la fin du xviiie s., Horace Bénédict de Saussure, savant genevois, écrit Voyages dans les Alpes. Quelques années plus tard, les premiers voyageurs anglais font leur apparition dans la vallée de Chamonix afin de découvrir le mont Blanc. Cependant, au xixe s., les touristes sont encore rares, et seuls quelques alpinistes osent s'aventurer en haute montagne. À la fin du xixe et au début du xxe s., on construit les premiers grands hôtels à Chamonix et à Zermatt (en Suisse). C'est aussi de cette époque que datent les premiers chemins de fer à crémaillère. Le tramway du Montenvers permet d'accéder à la mer de Glace, tandis que le plus élevé des Alpes est celui de la Jungfrau (en Suisse) ; il monte, sous terre, dans la face nord de l'Eiger au-dessus d'Interlaken, jusqu'à 3 500 m d’altitude.
LE DÉVELOPPEMENT DES SPORTS D’HIVER
Le grand essor touristique dans les Alpes date des années 1950 et 1960 pour deux raisons principales : la généralisation des congés payés et l'augmentation du niveau de vie, d'une part; le développement des sports d'hiver, avec un engouement généralisé pour le ski, d'autre part. Les années 1970 ont vu la construction des grandes stations de ski intégrées, comme Tignes, Flaine ou Les Arcs, alors que d'autres stations, comme Chamonix ou Zermatt, datant de la fin du xixe s. dernier, se sont transformées progressivement pour s'adapter à l'évolution de la fréquentation touristique. Depuis 1970, l'« or blanc » est devenu une véritable manne pour l'activité économique des montagnes, créant des emplois dans le bâtiment, les travaux publics, la maintenance des exploitations, l'hôtellerie et le commerce. Les Alpes ne sont pas les seules à bénéficier de l'attrait touristique : les montagnes Rocheuses (aux États-Unis) connaissent aussi un afflux de visiteurs, notamment étrangers, en particulier dans les grands parcs nationaux.
DE NOUVELLES ACTIVITÉS
Cependant, depuis le début du xxie s., on assiste à un ralentissement des sports d'hiver. D'autres formes de loisirs prennent le relais : nouvelles activités sportives (parapente, canyoning, hydrospeed), tourisme sportif, marche en montagne, découverte de la nature, activités nautiques sur les lacs de barrage en basse altitude, etc. En outre, depuis les années 1980, le trekking s'est développé également dans les montagnes lointaines : cette activité consiste à randonner à pied, accompagné par des guides locaux, sur les chemins de l'Himalaya, des Andes ou d'ailleurs, à la découverte de paysages grandioses et de populations vivant encore avec des coutumes et selon des rythmes ancestraux.
LES RISQUES NATURELS
Par la vigueur des reliefs, la verticalité des pentes et l'activité tectonique profonde, les montagnes sont un terrain de prédilection pour les avalanches, chutes de pierres, catastrophes glaciaires, coulées boueuses, éboulements des faces, inondations, séismes et autres risques naturels.
Quand le manteau neigeux devient trop épais et trop lourd, il se fissure dans sa partie haute, se détache de sa zone d'accrochage et emporte dans sa chute une masse de neige plus ou moins importante. Malgré les prévisions météorologiques et la surveillance de l'état de la neige, les avalanches restent un danger important. Elles provoquent, en moyenne, la mort de 100 personnes par an dans les Alpes françaises.
En haute montagne, les fissures sont imbibées d'eau. Les alternances de gel et de dégel déstructurent progressivement les roches. Il suffit alors d'une forte période de sécheresse ou, à l'inverse, d'une très grande pluviosité pour déstabiliser des pans entiers de falaise. En 1970, au Pérou, l'éboulement du Huascarán a déplacé une masse de 10 millions de mètres cubes de roches ; on estime que certains rochers de plusieurs centaines de tonnes se sont déplacés avec une vitesse de pointe de plus de 300 km/h. Même à petite échelle, les éboulements rocheux qui affectent les parois constituent un véritable péril, en particulier pour les alpinistes.
Les glaciers présentent parfois aussi un danger pour les habitants situés en aval. Des poches d'eau peuvent se développer sous leur langue, grossir, rester captives quelques années puis rompre brusquement, comme celle du glacier de Tré-la-Tête, qui, au début du xxe s., a provoqué la destruction d'une partie de la ville de Saint-Gervais-les-Bains (en Haute-Savoie).
La forme étroite et encaissée des vallées de certaines régions peut donner aux cours d'eau un pouvoir très dévastateur en cas de fortes pluies. De très nombreuses maisons sont ainsi emportées en période de mousson dans l'Himalaya. Une catastrophe de ce type a eu lieu en France en juin 1957, dans la vallée du Queyras, balayée par le gonflement du Guil : des centaines de maisons ont détruites, les villages et les terres agricoles ravagés.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
liberté de la presse |
|
|
| |
|
| |

liberté de la presse
Consulter aussi dans le dictionnaire : presse
Cet article fait partie du dossier consacré aux droits de l'homme et du dossier consacré à l'information.
Liberté de créer un journal, de publier ses opinions dans un journal ou dans un livre.
DROIT
La liberté de la presse est l’une des principales libertés publiques. C’est une condition nécessaire à l'exercice de la démocratie. Elle participe du droit d'expression et de critique dont disposent tous les citoyens vivant dans les pays démocratiques. Mais l'obtention de ce droit a demandé de longs combats. Aujourd'hui encore, cette liberté ne concerne qu'une minorité de pays. Cependant, même dans les pays démocratiques, la liberté de la presse doit composer avec les réalités économiques.
1. L'HISTOIRE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
La liberté de la presse n'a pas été conquise en un jour. S'il revient à l'Europe de l'avoir inventée, elle s'est développée comme un concept universel. Mais hors de l'Europe, c'est principalement en Amérique du Nord qu'elle a pu être établie. Par extension, la liberté de la presse concerne l'ensemble des médias.
1.1. LES PREMIERS TEXTES DE LOI SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
Depuis l'invention du livre, les médias sont au centre du combat pour l'exercice de la vie démocratique. Car les médias sont la condition de la démocratie en permettant la libre confrontation des idées. La revendication de la liberté de la presse est donc une revendication de tous les esprits libres à partir du xviie siècle. Mais il faudra attendre plus d'un siècle pour que cette revendication soit inscrite dans les textes.
La Suède est le premier pays au monde à instituer le droit de la presse dès 1766 ; l'interdiction de toute limitation du droit de publication fait partie de la Constitution du pays.
En 1776, l'État de Virginie se place dans la logique de la Suède : la section 12 du Virginia's Bill of Rights, la Loi fondamentale de l'État, indique qu'aucun gouvernement ne peut empêcher l'expression de la liberté de la presse. La Constitution des États-Unis reprend à son compte ce principe. Le premier amendement de la Constitution américaine voté en 1791 stipule que « le Congrès ne fera aucune loi restreignant la liberté de parole ou de la presse ».
1.2. LA CONQUÊTE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE EN FRANCE
Voltaire
Les philosophes et écrivains des Lumières (→ Voltaire et Beaumarchais, notamment) ont défendu le caractère universel du droit d'expression. Si la Révolution française a promulgué les premiers textes fixant la liberté de la presse, il faudra attendre la IIIe République pour que la loi impose un régime de liberté.
LA DÉCLARATION DE 1789
Le premier journal d'opposition, le Journal des états généraux, naît avant même le début de la Révolution. Il sera interdit le surlendemain. Mais les premières années de la Révolution ouvrent une période de grande liberté pour la presse. Plus d'un millier de journaux voient le jour entre 1789 et 1794. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule que « tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement ».
LA LOI DU 29 JUILLET 1881
À partir de 1794 et durant toute la période de l'Empire (1804-1814 ; 1852-1870) et de la Restauration (1814-1830), la presse est muselée. Les journaux sont de moins en moins nombreux : en 1811, il n'en reste que quatre à Paris, qui sont tous placés sous l'étroit contrôle de l'État. Pourtant, la presse a joué un rôle important dans les mouvements de contestation de la monarchie.
La mise en place, en 1870, d'un régime démocratique, la IIIe République, va rapidement déboucher sur l'établissement d'une loi qui fonde la liberté de la presse en France. Toujours en vigueur aujourd’hui, la loi du 29 juillet 1881 stipule dans son article 1 que « l'imprimerie et la librairie sont libres ».
Il existe toutefois des limites légales à la liberté de la presse ; certaines concernent la sauvegarde de l’ordre public (la publication de messages incitant au racisme et à la xénophobie est par exemple interdite), d’autres la protection des mineurs et de la dignité humaine (messages à caractère violent ou pornographique). Le droit français sanctionne également l’injure et la diffamation.
2. LA LIBERTÉ DE LA PRESSE AUJOURD'HUI
La liberté de la presse n'est pas un phénomène universel. Là où elle est formellement instaurée, ce droit d'expression et de publication est parfois en contradiction avec la logique économique. En outre, cette liberté ne peut s'affirmer sans la contrepartie d'une responsabilité.
2.1. UNE LIBERTÉ MINORITAIRE
La liberté de la presse ne s'exerce réellement que dans un nombre limité de pays (il s'agit principalement des pays d'Europe occidentale, d'une partie de ceux de l'Europe de l'Est, de l'Amérique du Nord, de l'Océanie, d'Israël et de certains pays d'Afrique et d'Asie). Des facteurs économiques (prix du papier et de l'impression par exemple) peuvent limiter le pouvoir de la presse. Surtout, les enjeux politiques sont très importants : parce qu’elle peut constituer un contre-pouvoir essentiel, la liberté de la presse est en effet limitée dans les pays autoritaires (censure, violence à l’égard des journalistes). Même si la liberté de la presse existe en droit, les journalistes subissent de telles pressions, qui vont parfois jusqu'à l'assassinat, qu'il est presque impossible pour les médias d'exercer leur droit de critique et d'investigation. Selon les chiffres de l’association internationale Reporters sans frontières (RSF), qui s’est donnée pour mission de surveiller l’état de la liberté de la presse dans le monde, au moins 66 journalistes ont été tués dans le monde en 2014. Chaque année, RSF publie un « classement mondial de la liberté de la presse » ; parmi les pays les plus répressifs en 2008 figurent par exemple la Corée du Nord, le Turkménistan, la Birmanie, Cuba et l’Iran – la France est placée en 35e position.
2.2. UNE LIBERTÉ SOUS CONDITION
Dans les pays démocratiques, la liberté de la presse reste un enjeu. La logique économique peut aller à l'encontre de la liberté de publier. En outre, plus les médias ont de l'influence, et plus leur responsabilité est forte.
LE POIDS DE LA CONTRAINTE ÉCONOMIQUE
La concentration des médias est une tendance toujours plus forte dans les pays développés. Les grands groupes de communication cherchent à se renforcer en rachetant toujours plus de journaux, de radios ou de télévisions. Dans cette logique, l'information est une donnée économique dont la valeur se mesure le plus souvent par son niveau d'audience, au risque d'empêcher le développement d'une information différente et pluraliste qui ne serait pas nécessairement rentable.
LA RESPONSABILITÉ DES MÉDIAS
Les médias, en particulier la télévision, ont un impact sans équivalent sur la population. La puissance de l'image, l'émotion qu'elle créée, peut conduire à privilégier le spectaculaire sur la mission d'information (→ communication).
Pour en savoir plus, voir l'article presse.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
LAOS |
|
|
| |
|
| |

Laos
GÉOGRAPHIE
Couvert par la forêt (surtout) et la savane, le Laos est un pays enclavé, étiré entre le Viêt Nam et la Thaïlande. Il est formé de plateaux et de montagnes recevant des pluies en été (mousson). Ces régions sont traversées par le Mékong, qui a édifié quelques plaines alluviales, où se cultive le riz (base de l'alimentation). Le Laos dispose d'importantes ressources minières. L’hydroélectricité, destinée notamment à l’exportation, constitue un atout majeur (barrage Nam Theun). Le tourisme se développe. Le Viêt Nam et la Chine investissent dans le pays.
1. LE MILIEU NATUREL
Le Laos, surnommé le « pays du million d'éléphants », possède un relief montagneux. Le haut Laos est un pays élevé drainé par le Mékong supérieur et son affluent le Nam Hou, seules voies de pénétration relativement faciles dans cette région accidentée, où le plateau gréseux et granitique du Trân Ninh atteint 2 817 m au mont Bia (point culminant du Laos). Mais le Trân Ninh est aussi accidenté de plaines d'effondrement, telle la plaine des Jarres, qui s'ouvre vers le sud. Le moyen et le bas Laos, sur le versant ouest de la cordillère Annamitique, sont formés de plateaux calcaires fortement karstifiés (Kebang, Khammouane) ou gréseux, souvent recouverts de basalte plioquaternaire (Kasseng, Boloven).
Le Laos est soumis à la mousson qui apporte des pluies abondantes (de 1 500 à 3 000 mm) de mai à septembre, alors que l'hiver est sec et frais (10 °C en janvier à Vientiane). Leur irrégularité selon les années provoque de fréquentes inondations ou sécheresses. La végétation primaire a disparu par la pratique du ray (culture sur brûlis) ; lui ont succédé une savane sur les sommets, une forêt secondaire dense sur les versants ou une forêt claire à diptérocarpacées sur les sols pauvres latéritiques. Le Mékong, peu utile en raison de ses rapides et de son débit irrégulier, attire cependant dans sa vallée l'essentiel des hommes.
2. LA POPULATION
Sous-peuplé (24 habitants par km2), surtout dans les zones montagneuses, le Laos comprend quatre grands groupes ethnolinguistiques. Les Laos, apparentés aux Thaïs de Thaïlande et venus de Chine du Sud dès le ve s., occupent la vallée du Mékong et les plaines. Ils représentent environ 50 % de la population. Les Austro-Asiatiques, montagnards appelés Khas (« sauvages », « esclaves ») par les Laos, sont les plus anciens habitants du pays (35 % de la population) ; ils pratiquent la culture sur brûlis, comme les Yaos et les Miaos (10 % de la population), venus de Chine ou du Viêt Nam au xixe s. Les importantes minorités urbaines vietnamiennes et chinoises ont connu l'exode après 1975.
Le bouddhisme est la religion dominante du Laos, mais l'animisme y est également très répandu, surtout parmi les montagnards. Faiblement urbanisée, la population est rassemblée, pour les deux tiers, dans les vallées et les plaines, qui ne représentent pourtant que un tiers du territoire. Son taux d'accroissement annuel (2,3 %) est comparable à celui des pays voisins, bien que ses taux de natalité et de mortalité infantile (due à la malnutrition) soient plus élevés. Historiquement habituée aux déplacements de populations – déportation des vaincus sur le territoire des vainqueurs –, la population du Laos a subi, entre 1960 et 1980, d'importants mouvements d'émigration liés à la guerre du Viêt Nam et à l'instauration du régime communiste.
3. L'ÉCONOMIE
L'agriculture occupe 80 % des actifs et représente 53 % du P.I.B. La riziculture, pratiquée de manière extensive et peu compétitive (2,1 millions de tonnes par an), en est le secteur dominant. Ressource traditionnelle, l'élevage de bœufs et de porcs avait régressé, mais il connaît depuis quelques années un nouvel essor. D'autre part, la cueillette de la cardamome et des gommes ainsi que la culture du café et du coton pourraient permettre de limiter la culture du pavot. La forêt (47 % du territoire) fournit de grosses recettes d'exportation, mais souffre d'un abattage excessif.
Les ressources minières (étain, fer de Xieng Khouang, cuivre, houille, manganèse, or, émeraudes, saphirs, gypse) restent difficiles d'accès, mais commencent à intéresser les investisseurs. Quant à l'énorme potentiel hydroélectrique, il est encore sous-exploité, malgré de nombreux projets, même si l'électricité, achetée par la Thaïlande, constitue la principale exportation. Malgré le développement d'une industrie manufacturière d'exportation (confection), le Laos reste un pays pauvre, avec un revenu annuel par habitant en parité de pouvoir d'achat de l'ordre de 1 700 dollars. Toujours tributaire de l'aide extérieure, il est relativement endetté.
4. LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES
L'économie a souffert de politiques de développement trop précipitées quand, de 1975 à 1979, la production a été collectivisée contre la volonté de la population. La baisse de la production du riz a d'abord amené l'État laotien, entre 1979 et 1986, à un assouplissement de la collectivisation. Puis, à partir de 1986, le « nouveau mécanisme économique » libéralise et modernise progressivement l'économie socialiste, favorisant la croissance du secteur privé. Les résultats sont positifs – entre 1986 et 1995, le P.N.B. est multiplié par trois, les échanges extérieurs par quatre –, mais doivent être nuancés : le secteur rizicole reste peu performant, les communications intérieures, difficiles, le déficit commercial et la dette extérieure, en augmentation constante. Membre de l'ASEAN depuis juillet 1997, le Laos entend dépasser son rôle traditionnel d'État tampon entre le Viêt Nam et la Thaïlande, afin de devenir un carrefour pour les pays d'Asie du Sud-Est continentale et le sud de la Chine, la circulation étant actuellement facilitée par la construction de plusieurs ponts sur le Mékong. Mais cette inscription dans l'économie régionale n'a pas que des avantages, comme l'a rappelé la crise asiatique de 1997, qui a durement touché le Laos, fortement dépendant du commerce avec la Thaïlande.
HISTOIRE
1. LES ANCIENS ROYAUMES
1.1. DES ORIGINES AU XIIIe SIÈCLE
La péninsule indochinoise à la période angkorienne
La plus grande partie du territoire occupé aujourd'hui par le Laos appartient jusqu'au xiiie siècle au royaume du Cambodge, qui y introduit la civilisation indo-khmère. À la fin du xiiie siècle, le royaume thaï de Sukhothai étend sa domination vers l'est jusqu'à Luang Prabang et Vientiane (ou Vieng Chan).
1.2. LE ROYAUME DE LAN XANG (XIVe-XIXe SIÈCLES)
FA NGUM (1353-1373)
La formation d'un État laotien indépendant, le royaume de Lan Xang (« Million d'éléphants »), est favorisée par l'affaiblissement du Sukhothai au milieu du xive siècle. Elle est due au prince Fa Ngum, fils d'un chef thaï du haut Mékong qui a trouvé refuge à la cour d'Angkor, où il a épousé une princesse khmère. Entre 1340 et 1350, Fa Ngum prend le commandement d'une armée khmère et se fait sacrer roi à Luang Prabang (1353), puis revient occuper Vientiane. Il étend ses possessions jusqu'au Yunnan et au nord-est du Siam, et favorise l'introduction du bouddhisme cinghalais.
PHYA SAM SEN THAI (1373-1416)
Son fils, qui lui succède en 1373 et qui dote le pays d'une puissance militaire, est connu sous le nom de Phya Sam Sen Thai (« le Seigneur des trois cent mille Thaïs »), le recensement qu'il organise en 1376 ayant permis de chiffrer la population du royaume. Sa mort (1416) est suivie d'une période d'instabilité, dont profite l'empereur d'Annam Lê Thanh Tong, qui prend Luang Prabang (1479).
POTHISARAT (1520-VERS 1548
En 1520, Pothisarat accède au trône. Il relève le pays de ses ruines, étend son influence sur le Lan Na (1548), d'où il ramène le bouddha d'émeraude et qui est installé à Vientiane, nouvelle capitale en 1563. Il guerroie contre Ayuthia, capitale du Siam. Sa disparition (vers 1548) est suivie d'une attaque des Birmans, qui prennent Vientiane (1574) et imposent leur suzeraineté.
SETTHATHIRATH (VERS1548-1571)
Le roi Setthathirath n'a pas réussi à protéger le pays, en dépit de son alliance avec le Siam ; sous son règne, le bouddha d'émeraude est enchâssé dans le temple du That Luang (1566). La mort prématurée de Setthathirath permet aux Birmans d'occuper le pays, tandis que se poursuit une longue période d'anarchie, qui prendra fin avec l'arrivée sur le trône de Souligna Vongsa (Suliyavongsa).
SOULIGNA VONGSA (1637-1694)
Ce souverain, qui règne cinquante-sept ans, rétablit la paix dans le royaume et assure de bonnes relations avec l'Annam ; il épouse une princesse vietnamienne, et les deux pays fixent leur frontière. Sous son long règne, le Laos reçoit la visite d'Européens, parmi lesquels le commerçant hollandais Gerrit Van Wuysthoff (1641) et le jésuite italien Leria (1641-1647). La mort de Souligna Vongsa (1694) entraîne entre ses descendants une querelle qui va mettre fin à l'unité et à l'indépendance du Laos pour plus de deux siècles.
LES ROYAUMES DE VIENTIANE, DE LUANG PRABANG ET DE CHAMPASSAK
Ainsi voient le jour au début du xviiie siècle les royaumes de Vientiane, de Luang Prabang et de Champassak. Ce dernier passera vite sous la suzeraineté siamoise. Celui de Luang Prabang, affaibli par ses rivalités avec Vientiane, est envahi par les Birmans (1753) au cours de leur campagne contre le Siam, puis mis à sac une seconde fois (1771). Le royaume signe un traité d'alliance avec le Siam trois ans plus tard, puis est contraint de reconnaître la suzeraineté de Bangkok (1778), réaffirmée en 1836.
Allié de la Birmanie (1753), le royaume de Vientiane est envahi par les Siamois en 1778 ; le pays et la capitale sont pillés, le bouddha d'émeraude est ramené à Bangkok. Vientiane passe à son tour sous la suzeraineté siamoise. Le roi Anou, qui règne de 1805 à 1828, et qui a été placé sur le trône par les Siamois, tente de secouer cette tutelle. Il obtient d'abord de Bangkok pour son fils le trône de Champassak, où il vient d'écraser une révolte des tribus khas (1819). En 1826, croyant le Siam menacé par la guerre anglo-birmane, il marche sur Korat et Bangkok. Il est arrêté par le général Bodin, qui contre-attaque et s'empare de Vientiane (1827). La ville est pillée, ses habitants déportés ; le royaume devient province siamoise. Anou se réfugie à la cour de Huê, dont il a reconnu la suzeraineté depuis 1806 ; il tente de reprendre le pouvoir, puis décide de se rendre en Chine. En chemin, un prince local le livre aux Siamois, qui l'emprisonnent à Bangkok, où il mourra (1835).
Pendant cette période, l'empire d'Annam, en état d'hostilité permanente avec le Siam, étend son influence sur le Nord-Est du Laos. Vers 1840, arrivent au Laos, venant de Chine, les premiers montagnards miaos (ou hmongs). Ils sont suivis, une vingtaine d'années plus tard, par les Hos, pirates chinois issus de la révolte des Taiping.
2. LA COLONISATION FRANÇAISE
En 1861, le roi Tiantha Koumane accueille à Luang Prabang le Français Henri Mouhot, qui a retrouvé, l'année précédente, les temples d'Angkor. L'expédition de Doudart de Lagrée, chargée de remonter le Mékong, arrive à son tour à Luang Prabang en 1867. Monté sur le trône peu après, Oun Kham doit accepter l'intervention militaire du Siam, qui cherche à annexer son royaume et à prévenir l'établissement de l'influence française. Après l'instauration du protectorat français sur l'Annam (1883), le Siam envoie de nouvelles troupes, qui poussent jusqu'au Tonkin (1885). Les protestations de Huê, qui demande à la France de sauvegarder ses droits au Laos, aboutissent à la nomination d'un vice-consul à Luang Prabang ; Auguste Pavie mettra plus d'un an à rejoindre son poste en raison de l'hostilité siamoise. Il aide Oun Kham à défendre sa capitale contre les Pavillons-Noirs de Deo Van Tri ; le roi demande alors le protectorat de la France. Celle-ci amènera le Siam à renoncer à la rive gauche du Mékong et à reconnaître le protectorat français, par les traités de 1893, 1902 et 1904. En 1895, le nouveau roi, Zakarine, investi par la France, signe avec elle une convention de protectorat. Il meurt en 1904 ; son fils, Sisavang Vong, régnera jusqu'en 1959.
Le roi de Luang Prabang, seule monarchie qui a survécu à la tutelle siamoise, prend un certain ascendant sur le pays divisé ; mais il faudra attendre la convention de 1941 pour qu'il étende son autorité sur le pays, à l'exception du Champassak. En 1899, le gouverneur général de l'Indochine, Paul Doumer, unifie le pays sous l'administration d'un résident supérieur établi à Vientiane. Mais le pays restera le parent pauvre de l'Indochine française.
Après la défaite française de 1940, Bangkok tente de reprendre le contrôle de son ancien vassal. La guerre (1940-1941) ne tourne pas à son avantage mais la médiation japonaise, qui aboutit au traité de Tokyo du 9 mai 1941, force la France à rétrocéder les territoires situés à l'ouest du Mékong. Après le coup de force japonais du 9 mars 1945, Tokyo pousse Sisavang Vong à proclamer l'indépendance (8 avril). Le vice-roi, le prince Pethsarath, leader d'un mouvement d'indépendance nationale, le Lao Issara (Laos libre), réaffirme l'indépendance du royaume après la capitulation japonaise et annonce (septembre) l'unification du pays sous un « gouvernement libre et indépendant ». Le roi doit abdiquer en novembre. Le gouvernement, qui comprend un frère de Pethsarath, Souvanna Phouma, et son demi-frère, Souphanouvong, lié au Viêt-minh et ministre de la Défense, proclame l'État du Laos (Pathet Lao). Mais les troupes françaises reprennent Vientiane dès le 24 avril 1946, chassent les nationalistes et remettent le roi sur le trône.
Le Laos devient un État autonome (1946), érigé en monarchie constitutionnelle (1947), puis indépendant dans le cadre de l'Union française (convention du 19 juillet 1949). Une partie des nationalistes, avec Souvanna Phouma, s'est ralliée ; ce dernier devient Premier ministre après les élections de 1951. Les plus radicaux, conduits par Souphanouvong, Kaysone Phomvihane et Phoumi Vongvichit, poursuivent la lutte et forment un gouvernement provisoire de résistance après le Ier Congrès du Pathet Lao (août 1950). Ils obtiennent le soutien militaire du Viêt-minh (1951), dont les troupes entrent au Laos (1953). Les accords de Genève (21 juillet 1954) reconnaissent le contrôle du Pathet Lao sur les provinces de Phong Saly et de Sam Neua, en attendant son intégration dans un État neutre. Le Viêt-minh évacue le pays.
3. UNE NEUTRALITÉ MENACÉE
Dès la signature des accords de Genève, les États-Unis renforcent considérablement leur influence à Vientiane ; celle des militaires thaïlandais s'accroît également. Washington s'oppose à la réunification, prévue par les accords et développe son assistance.
En 1956, le Pathet Lao crée un Front patriotique (Neo Lao Hak Sat) et demande la formation d'un gouvernement de coalition. Celui-ci voit le jour en novembre 1957 sous la présidence de Souvanna Phouma et avec Souphanouvong comme ministre du Plan. Aux élections partielles de mai 1958, le Pathet Lao et ses alliés remportent 13 sièges sur 21. Un équilibre semble réalisé dans le royaume.
Les États-Unis, qui ont une importante mission militaire au Laos, soutiennent la formation de deux organisations liées aux militaires, le Rassemblement du peuple lao (RPL) et le Comité de défense des intérêts nationaux (CDIN), le premier dirigé par Kathay et Phoui Sananikone, le second par Phoumi Nosavan. Souvanna Phouma est contraint de démissionner (juillet 1958) ; Phoui le remplace à la tête d'un gouvernement faisant place au CDIN et excluant le Pathet Lao, dont les chefs sont placés en résidence surveillée. Des relations sont établies avec Saïgon et Taïwan, tandis que Vientiane et Hanoi s'accusent mutuellement de violations de frontière. En octobre 1959, le roi Sisavang Vong meurt et son fils Savang Vatthana le remplace. En décembre, Phoumi Nosavan, à la tête de l'armée, prend le pouvoir et mène une politique violemment anticommuniste ; Souphanouvong et ses partisans parviennent à s'évader (mai 1960).
Le 9 août 1960, les parachutistes du capitaine Kong Lê font un coup d'État neutraliste et remettent le pouvoir à Souvanna Phouma. Les États-Unis suspendent leur aide, la Thaïlande ferme la frontière, tandis que l'URSS met en place un pont aérien. La droite se réorganise dans le Sud et reprend le pouvoir en décembre. Souvanna Phouma s'enfuit à Phnom Penh, Boun Oum est nommé Premier ministre. La guerre reprend. La médiation des grandes puissances aboutit à l'ouverture de la conférence des Quatorze à Genève après l'instauration d'un cessez-le-feu (11 mai 1961) ; le 22 juin, les princes représentant les trois factions, Souvanna Phouma (neutraliste). Souphanouvong (Pathet Lao) et Boun Oum (droite), se mettent d'accord à Zurich pour former un gouvernement d'union nationale, qui sera mis en place en juin 1962, avec à sa tête Souvanna Phouma. Les seconds accords de Genève sont signés le 23 juillet 1962 ; l'indépendance, l'intégrité et la neutralité du royaume sont reconnues.
4. LE LAOS DANS LA GUERRE DU VIÊT NAM ...
Pour lire la suite, consulter le LIEN
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
L'ÃCRITURE |
|
|
| |
|
| |
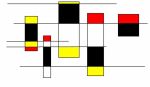
écriture
(latin scriptura)
Consulter aussi dans le dictionnaire : écriture
Cet article fait partie du dossier consacré à la Mésopotamie.
Système de signes graphiques servant à noter un message oral afin de pouvoir le conserver et/ou le transmettre.
HISTOIRE
Toutes les civilisations qui ont donné naissance à une forme d'écriture ont forgé une version mythique de ses origines ; elles en ont attribué l'invention aux rois ou aux dieux. Mais les premières manifestations de chaque écriture témoignent d'une émergence lente et de longs tâtonnements. Dans ces documents, les hommes ont enregistré : des listes d'impôts et des recensements ; des traités et des lois, des correspondances entre souverains ou États ; des biographies de personnages importants ; des textes religieux et divinatoires. Ainsi l'écriture a-t-elle d'abord servi à noter les textes du pouvoir, économique, politique ou religieux. Par ailleurs, les premiers systèmes d'écriture étaient compliqués. Leur apprentissage était long et réservé à une élite sociale voulant naturellement défendre ce statut privilégié et qui ne pouvait guère être favorable à des simplifications tendant à faciliter l'accès à l'écriture, instrument de leur pouvoir.
À partir du IIIe millénaire avant J.-C., toutes les grandes cultures du Proche-Orient ont inventé ou emprunté un système d'écriture. Les systèmes les plus connus, et qui ont bénéficié de la plus grande extension dans le monde antique, demeurent ceux de l'écriture hiéroglyphique égyptienne et de l'écriture cunéiforme, propre à la Mésopotamie. L'écriture égyptienne est utilisée dans la vallée du Nil, jusqu'au Soudan, sur la côte cananéenne et dans le Sinaï. Mais, pendant près d'un millénaire, l'écriture cunéiforme est, avec la langue sémitique (l'assyro-babylonien) qu'elle sert à noter, le premier moyen de communication international de l'histoire. L'Élam (au sud-ouest de l'Iran), les mondes hittite (en Anatolie) et hourrite (en Syrie du Nord), le monde cananéen (en Phénicie et en Palestine) ont utilisé la langue et l'écriture mésopotamienne pour leurs échanges diplomatiques et commerciaux, mais aussi pour rédiger et diffuser leurs propres œuvres littéraires et religieuses. Pour leur correspondance diplomatique, les pharaons du Nouvel Empire avaient eux-mêmes des scribes experts dans la lecture des textes cunéiformes.
À la même époque, d'autres systèmes d'écriture sont apparus, mais leur extension est limitée : en Anatolie, le monde hittite utilise une écriture hiéroglyphique qui ne doit rien à l'Égypte. Dans le monde égéen, les scribes crétois inventent une écriture hiéroglyphique, puis linéaire, de 80 signes environ, reprise par les Mycéniens.
Au Ier millénaire, l'apparition de l'alphabet marque une histoire décisive dans l'histoire de l'écriture. Depuis des siècles, l'Égypte dispose, au sein de son écriture nationale, du moyen de noter les consonnes. Au xive siècle avant J.-C., les scribes d'Ougarit gravent sur des tablettes d'argile des signes cunéiformes simplifiés et peu nombreux, puisqu'ils ne sont que 30, correspondant à la notation de 27 consonnes et de 3 valeurs vocaliques. Mais les uns et les autres ne font pas école. Ce n'est qu'après le xie siècle que le système d'écriture alphabétique se généralise à partir de la côte phénicienne. Une révolution sociale accompagne cette innovation radicale : les scribes, longuement formés dans les écoles du palais et des temples, voient leur rôle et leur importance diminuer.
LE SYSTÈME CUNÉIFORME
Le premier système d'écriture connu apparaît dans la seconde moitié du IVe millénaire avant notre ère, en basse Mésopotamie, pour transcrire le sumérien. Dans l'ancienne Mésopotamie, les premiers signes d'écriture sont apparus pour répondre à des besoins très concrets : dénombrer des biens, distribuer des rations, etc. Comme tous les systèmes d'écriture, celui-ci apparaît donc d'abord sous forme de caractères pictographiques, dessins schématisés représentant un objet ou une action. Le génie de la civilisation sumérienne a été, en quelques siècles, de passer du simple pictogramme à la représentation d'une idée ou d'un son : le signe qui reproduit à l'origine l'apparence de la flèche (ti en sumérien) prend la valeur phonétique ti et la signification abstraite de « la vie », en même temps que sa graphie se stylise et, en s'amplifiant, ne garde plus rien du dessin primitif.
LES PICTOGRAMMES DE L'ÉCRITURE CUNÉIFORME
Trouvées sur le site d'Ourouk IV, de petites tablettes d'argile portent, tracés avec la pointe d'un roseau, des pictogrammes à lignes courbes, au nombre d'un millier, chaque caractère représentant, avec une schématisation plus ou moins grande et sans référence à une forme linguistique, un objet ou un être vivant. L'ensemble de ces signes, qui dépasse le millier, évolue ensuite sur deux plans. Sur le plan technique, les pictogrammes connaissent d'abord une rotation de 90° vers la gauche (sans doute parce que la commodité de la manipulation a entraîné une modification dans l'orientation de la tablette tenue en main par le scribe) ; ultérieurement, ces signes ne sont plus tracés à la pointe sur l'argile, mais imprimés, dans la même matière, à l'aide d'un roseau biseauté, ce qui produit une empreinte triangulaire en forme de « clou » ou de « coin », cuneus en latin, d'où le nom de cunéiforme donné à cette écriture.
LE SENS DES PICTOGRAMMES CUNÉIFORMES
Sur le plan logique, l'évolution est plus difficile à cerner. On observe cependant, dès l'époque primitive, un certain nombre de procédés notables. Ainsi, beaucoup de ces signes couvrent une somme variable d'acceptions : l'étoile peut tour à tour évoquer, outre un astre, « ce qui est en haut », le « ciel » et même un « être divin ». Par ailleurs, les sumériens ne se sont pas contenté de représenter un objet ou un être par un dessin figuratif : ils ont également noté des notions abstraites au moyen de symboles. C'est ainsi que deux traits sont parallèles ou croisés selon qu'ils désignent un ami ou un ennemi.
Le sens peut aussi procéder de la combinaison de deux éléments graphiques. Par exemple, en combinant le signe de la femme et celui du massif montagneux, on obtient le sens d'« étrangère », « esclave ».
Tous ces signes, appelés pictogrammes par référence à leur tracé, sont donc aussi des idéogrammes, terme qui insiste sur leur rôle sémantique (leur sens) et indique de surcroît leur insertion dans un système. L'écriture cunéiforme dépasse ensuite ce stade purement idéographique. Un signe dessiné peut aussi évoquer le nom d'une chose, et non plus seulement la chose elle-même. On recourt alors au procédé du rébus, fondé sur le principe de l'homophonie (qui ont le même son). Ce procédé permet de noter tous les mots et ainsi des messages plus élaborés.
L'ÉCRITURE DES AKKADIENS
Cependant, les Sumériens considèrent les capacités phonétiques des signes, nouvellement découvertes, comme de simples appoints à l'idéographie originelle, et font alterner arbitrairement les deux registres, idéographique et phonographique. Lorsque les Akkadiens empruntent ce système vers − 2300, ils l'adaptent à leur propre langue, qui est sémitique, et font un plus grand usage du phonétisme, car, à la différence du sumérien, dont les vocables peuvent se figurer par des idéogrammes toujours identiques, flanqués d'affixes qui déterminent leur rôle grammatical, l'akkadien renferme déclinaisons et conjugaisons.
L'ÉVOLUTION DU SUMÉRO-AKKADIEN
L'écriture suméro-akkadienne ne cesse d'évoluer et connaît notamment une expansion importante au IIe millénaire. Le cunéiforme est adopté par des peuples de l'Orient qui l’adaptent à la phonétique de leur langue : Éblaïtes, Susiens, Élamites, etc. Vers − 1500, les Hittites adoptent les cunéiformes babyloniens pour noter leur langue, qui est indo-européenne, associant leurs idéogrammes à ceux venus de Mésopotamie, qu'ils prononcent en hittite. L'ougaritique, connu grâce aux fouilles de Ras Shamra (l'antique Ougarit), dans l'actuelle Syrie, est un alphabet à technique cunéiforme ; il note plusieurs langues et révèle que, à partir de − 1400 environ, l'écriture en cunéiformes est devenue une sorte de forme « véhiculaire », simplifiée, servant aux échanges internationaux. Au Ier millénaire encore, le royaume d'Ourartou (situé à l'est de l'Anatolie) emprunte les caractères cunéiformes (vers − 800) et ne les modifie que légèrement. Enfin, pendant une période assez brève (vie-ive s. avant notre ère), on utilise un alphabet à technique cunéiforme pour noter le vieux perse. Au Ier millénaire, devant les progrès de l'alphabet et de la langue des Araméens (araméen), l'akkadien devient une langue morte ; le cunéiforme ne se maintient que dans un petit nombre de villes saintes de basse Mésopotamie, où il est utilisé par des Chaldéens, prêtres et devins, jusqu'au ier s. après J.-C., avant de sombrer dans l'oubli.
DU HIÉROGLYPHE AU DÉMOTIQUE
Hiéroglyphes
Tout d'abord hiéroglyphique, l'écriture égyptienne évolue en se simplifiant vers une écriture plus maniable, et d'un usage quotidien. Le hiéroglyphe est une unité graphique utilisée dans certaines écritures de l'Antiquité, comme l'égyptien. Les premiers témoignages « hiéroglyphiques » suivent de quelques siècles les plus anciennes tablettes sumériennes écrites en caractères cunéiformes. Le mot « hiéroglyphe », créé par les anciens Grecs, fait état du caractère « sacré » (hieros) et « gravé » (gluphein) de l'écriture égyptienne monumentale, mais n'est réservé à aucun système d'écriture particulier. On désigne par le même terme les écritures crétoises du minoen moyen (entre 2100 et 1580 avant J.-C.), que l'on rapproche ainsi des signes égyptiens, mais qui demeurent indéchiffrées.
LES HIÉROGLYPHES ÉGYPTIENS
La langue égyptienne est une langue chamito-sémitique dont la forme écrite n'est pas vocalisée. Vers 3000 avant J.-C., l'Égypte possède l'essentiel du système d'écriture qu'elle va utiliser pendant trois millénaires et dont les signes hiéroglyphiques offrent la manifestation la plus spectaculaire. Quelque 700 signes sont ainsi créés, beaucoup identifiables parce que ce sont des dessins représentant des animaux, un œil, le soleil, un outil, etc.
Cette écriture est d'abord pictographique (un signe, dessiné, représente une chose ou une action). Mais dès l'origine, l'écriture égyptienne eut recours, à côté des signes-mots (idéogrammes), à des signes ayant une valeur phonétique (phonogrammes), où un signe représente un son. Le dessin du canard représente l'animal lui-même, mais canard se disant sa, le même signe peut évoquer le son sa, qui sert aussi à désigner le mot « fils ». Pour éviter au lecteur confusions ou hésitations, le scribe a soin de jalonner son texte de repères : signalisation pour désigner l'emploi du signe comme idéogramme (signe-chose, représentant plus ou moins le sens du mot) ou phonogramme, et compléments phonétiques qui indiquent la valeur syllabique. Il existe également des idéogrammes déterminatifs, qui ne se lisent pas, mais qui indiquent à quelle catégorie appartient le mot. Les signes peuvent être écrits de gauche à droite ou de droite à gauche.
On distingue trois types d'écriture égyptienne : l'écriture cursive ou hiératique, tracée sur papyrus, l'écriture démotique, plus simplifiée que l'écriture hiératique, et l'écriture hiéroglyphique proprement dite, c'est-à-dire celle des monuments, antérieure à 2500 avant J.-C. Ces hiéroglyphes, gravés à l'origine dans la pierre, en relief ou en creux, peuvent être disposés verticalement ou horizontalement, comme ils peuvent se lire de droite à gauche ou de gauche à droite, le sens de la lecture étant indiqué par la direction du regard des êtres humains et des animaux, toujours tourné vers le début du texte.
L'écriture hiéroglyphique apparaît toute constituée dès les débuts de l'histoire (vers 3200 avant J.-C.) ; la dernière inscription en hiéroglyphes, trouvée à Philae, date de 394 après J.-C.
LE SYSTÈME DE L'ÉCRITURE ÉGYPTIENNE
Les idéogrammes peuvent être des représentations directes ou indirectes, grâce à divers procédés logiques :
– la représentation directe de l'objet que l'ont veut noter ;
– la représentation par synecdoque ou métonymie, c'est-à-dire en notant la partie pour le tout, l'effet pour la cause, ou inversement : ainsi, la tête de bœuf représente cet animal ; deux yeux humains, l'action de voir ;
– la représentation par métaphore : on note, par exemple, la « sublimité » par un épervier, car son vol est élevé ; la « contemplation » ou la « vision », par l'œil de l'épervier, parce qu'on attribuait à cet oiseau la faculté de fixer ses regards sur le disque du Soleil ;
– représentation par « énigme » – le terme est de Champollion – ; on emploie, pour exprimer une idée, l'image d'un objet physique n'ayant qu'un rapport lointain avec l'objet même de l'idée à noter : ainsi, une plume d'autruche signifie la « justice », parce que, disait-on, toutes les plumes des ailes de cet oiseau sont parfaitement égales ; un rameau de palmier représente l'« année », parce que cet arbre était supposé avoir autant de rameaux par an que l'année compte de mois, etc.
L'ÉVOLUTION DE L'ÉCRITURE ÉGYPTIENNE
L'évolution des hiéroglyphes vers le phonétisme
À partir des idéogrammes originels, l'écriture égyptienne a évolué vers un phonétisme plus marqué que celui du cunéiforme. Selon le principe du rébus là aussi, on a utilisé, pour noter telle notion abstraite difficile à figurer, l'idéogramme d'un objet dont le nom a une prononciation identique ou très proche. Par exemple, le scarabée, khéper, a servi à noter la notion qui se disait également khéper, le « devenir ».
Poussé plus loin, le recours au phonétisme mène à l'acronymie. Un acronyme est en l'occurrence une sorte de sigle formé de toute consonne initiale de syllabe. Apparaissent ainsi des acronymes trilitères et bilitères (nfr, « cœur » ; gm, « ibis »), ainsi que des acronymes unilitères (r, « bouche »), qui constituent une espèce d'alphabet consonantique de plus de vingt éléments.
Mais le fait de noter exclusivement les consonnes entraîne beaucoup trop d'homonymies. Pour y remédier, on utilise certains hiéroglyphes comme déterminatifs sémantiques destinés à guider l'interprétation sémantique des mots écrits phonétiquement. Par exemple, le signe du « Soleil », associé à la « massue », hd, et au « cobra », dj, qui jouent un rôle phonétique, mène à la lecture hedj, « briller ».C'est dans la catégorie des déterminatifs qu'entre le cartouche, encadrement ovale signalant un nom de souverain. Quelle que soit sa logique, cette écriture est d'un apprentissage et d'une lecture difficiles, et se prête peu à une graphie rapide.
L'écriture hiératique
Sur le plan technique, si la gravure dans la pierre s'accommode de ces formes précises, l'utilisation du roseau ou du pinceau sur du papyrus ou de la peau entraîne une écriture plus souple. Les hiéroglyphes sont simplifiés pour aboutir à deux formes cursives : l'écriture hiératique (usitée par les prêtres) et l'écriture démotique (servant à la rédaction de lettres et de textes courants). Tracée sur papyrus à l'aide d'un roseau à la pointe écrasée, trempée dans l'encre noire ou rouge, l'écriture hiératique est établie par simplification et stylisation des signes hiéroglyphiques. Avec ses ligatures, ses abréviations, elle sert aux besoins de la vie quotidienne : justice, administration, correspondance privée, inventaires mais aussi littérature, textes religieux, scientifiques, etc.
Le démotique
Vers 700 avant J.-C., une nouvelle cursive, plus simplifiée, remplace l'écriture hiératique. Les Grecs lui donnent le nom de « démotique », c'est-à-dire « (écriture) populaire », car elle est d'un usage courant et permet de noter les nouvelles formes de la langue parlée. Utilisée elle aussi sur papyrus ou sur ostraca (tessons de poterie), cette écriture démotique suffit à tous les usages pendant plus de 1000 ans, exception faite des textes gravés sur les monuments, qui demeurent l'affaire de l'hiéroglyphe, et des textes religieux sur papyrus pour lesquels on garde l'emploi de l'écriture hiératique.
Sur le plan fonctionnel, les Égyptiens, tout comme les Sumériens, n'ont pas exploité pleinement leurs acquis et se sont arrêtés sur le chemin qui aurait pu les mener à une écriture alphabétique. Demeuré longtemps indéchiffrable, le système d’écriture égyptien fut décomposé et analysé par Champollion (1822) grâce à la découverte de la pierre de Rosette, qui portait le même texte en hiéroglyphe, en démotique et en grec.
LES ÉCRITURES ANCIENNES DÉCHIFFRÉES
Alliant érudition, passion et intuition, les chercheurs du xixe s. déchiffrent les écritures des civilisations mésopotamiennes et égyptiennes.
Dans leurs travaux, ils durent résoudre deux problèmes : celui de l'écriture proprement dite, d'une part ; celui de la langue pour laquelle un système d'écriture était employé, d'autre part. Le document indispensable fut donc celui qui utilisait au moins deux systèmes d'écriture (ou davantage) dont l'un était déjà connu : la pierre de Rosette, rédigé en 2 langues et trois systèmes d’écritures (hiéroglyphe, démotique et grec) permit de déchiffrer les hiéroglyphes, grâce à la connaissance du grec ancien. Les savants durent ensuite faire l'hypothèse que telle ou telle langue avait été utilisée pour rédiger un texte donné ; Jean-François Champollion postula ainsi que la langue égyptienne antique a survécu dans la langue copte, elle-même conservée dans la liturgie de l'église chrétienne d'Égypte. De même le déchiffreur de l’écriture cunéiforme, sir Henry Creswicke Rawlinson, une fois les textes en élamite et vieux-perse de Béhistoun mis au point, fit l'hypothèse, avec d'autres chercheurs, que le texte restant était du babylonien, et qu'il s'agissait d'une langue sémitique dont les structures pouvaient être retrouvées à partir de l'arabe et de l'hébreu.
LES DÉCHIFFREURS
1754 : l'abbé Barthélemy propose une lecture définitive des textes phéniciens et palmyriens.
1799 (2 août) : mise au jour de la pierre de Rosette, dans le delta du Nil, portant copie d'un décret de Ptolémée V Épiphane (196 avant J.-C.) rédigé en trois écritures, hiéroglyphique, hiératique et grecque.
1822 : Lettre à Monsieur Dacier, de J.-F. Champollion, où ce dernier expose le principe de l'écriture égyptienne.
1824 : parution du Précis du système hiéroglyphique rédigé par Champollion.
À partir de 1835 : l'Anglais H. C. Rawlinson copie, à Béhistoun, en Iran, une inscription célébrant les exploits de Darius Ier (516 avant J.-C.) rédigée selon trois systèmes d'écriture cunéiforme, en vieux-perse, en élamite et en babylonien (akkadien), langues jusqu'alors inconnues.
1845 : le texte en vieux-perse est déchiffré par Rawlinson.
1853 : le texte en élamite est déchiffré par E. Norris.
1857 : un même texte babylonien est confié à quatre savants qui en proposent des traductions identiques.
1858 : Jules Oppert publie son Expédition scientifique en Mésopotamie, qui contribue au déchiffrement du cunéiforme.
1905 : F. Thureau-Dangin établit l'originalité de l'écriture et du système linguistique des Sumériens.
1917 : le Tchèque Hrozny établit que les textes hittites, écrits en caractères cunéiformes, servent à noter une langue indo-européenne, désormais déchiffrée.
1945 : découverte d'une stèle bilingue à Karatépé, en Cilicie ; la version phénicienne du texte permet de déchiffrer un texte louwite (proche du hittite) noté en écriture hiéroglyphique.
1953 : les Anglais M. Ventris et J. Chadwick établissent que les textes rédigés en écriture dite « linéaire B » sont du grec archaïque (mycénien) ; le linéaire B est une écriture syllabique comprenant environ 90 signes.
LA « LANGUE GRAPHIQUE » DES CHINOIS
Après les écritures sumérienne et égyptienne, l'écriture chinoise est la troisième écriture importante à avoir découpé les messages en mots. Mais elle n'a pas évolué comme les deux autres, car, à la différence de tous les systèmes d'écriture, qui sont parvenus, à des degrés divers, à exprimer la pensée par la transcription du langage oral, l'écriture chinoise note une langue conçue en vue de l'expression écrite exclusivement, et appelée pour cette raison « langue graphique ».
L'ÉVOLUTION DES IDÉOGRAMMES CHINOIS
Les premiers témoignages de l’écriture chonoise datent du milieu du IIe millénaire avant J.-C. : ce sont des inscriptions divinatoires, gravées sur des carapaces de tortues ou des omoplates de bœufs. Les devins y gravaient les questions de leurs « clients » puis portaient contre ce support un fer chauffé à blanc et interprétaient les craquelures ainsi produites. Ce type d’écriture a évolué à travers le temps et les différents supports : inscriptions sur des vases de bronze rituels aux alentours du ixe s. ; écriture sigillaire, gravée dans la pierre ou l'ivoire, au milieu du Ier millénaire ; caractères « classiques », peints au pinceau, à partir du iie s. avant J.-C. Ces derniers signes ont traversé deux millénaires ; en 1957, une réforme en a simplifié un certain nombre.
LE FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRITURE CHINOISE
Écriture chinoise
Sur le plan fonctionnel, les pictogrammes originels ont évolué vers un système d'écriture où les éléments sont dérivés les uns des autres. Soit le caractère de l'arbre (mu) : on peut en cocher la partie basse pour noter « racine » (ben), ou la partie haute pour « bout, extrémité » (mo) ; on peut aussi lui adjoindre un deuxième arbre pour noter « forêt » (lin), un troisième pour noter « grande forêt », et ultérieurement « nombreux », « sombre » (sen).
Un dérivé peut servir à son tour de base de dérivation. Ainsi, le pictogramme de la « servante », de l'« esclave », figurant une femme et une main droite (symbole du mari et du maître), est associé au signe du cœur, siège des sentiments, pour signifier la « rage », la « fureur », éprouvée par l'esclave.
Cette langue graphique use également d'indicateurs phonétiques. Ainsi, le caractère de la femme, flanqué de l'indicateur « cheval » (mâ), note « la femme qui se prononce comme le cheval » (au ton près), c'est-à-dire la « mère » (m"a) ; si l'on associe « cheval » avec « bouche », on note la particule interrogative (ma) ; avec deux « bouches », le verbe « injurier ».
Inversement, le caractère chinois peut être lu grâce au déterminatif sémantique. Ces déterminatifs, ou clés (au nombre de 540 au iie s. après J.-C., réduits à 214 au xviie s., et portés à 227, avec des modifications diverses, en 1976), sont des concepts destinés à orienter l'esprit du lecteur vers telle ou telle catégorie sémantique. Le même signe signifiera « rivière » s'il est précédé de la clé « eau », et « interroger » s'il est précédé de la clé « parole ».
Le système chinois repose donc sur le découpage de l'énoncé en mots. Il semble que, de l'autre côté du Pacifique, et au xvie s. de notre ère seulement, à la veille de la conquête espagnole, les glyphes précolombiens (que nous déchiffrons très partiellement à ce jour, malgré des progrès dans la lecture des glyphes mayas) présentent des similitudes avec cette écriture. Mais ils ne se sont pas entièrement dégagés de la simple pictographie.
L'AVENTURE DURABLE DE L'ALPHABET
LA NAISSANCE DE L'ALPHABET
L'invention de l'alphabet (dont le nom est forgé par les Grecs sur leurs deux premières lettres alpha et bêta) se situe au IIe millénaire avant notre ère en Phénicie. Deux peuples y jouent un rôle important, les Cananéens et, à partir du xiie s. avant J.-C., les Araméens ; ils parlent chacun une langue sémitique propre et utilisent l'akkadien, écrit en cunéiformes, comme langue véhiculaire. Dans les langues sémitiques, chacun des « mots » est formé d'une racine consonantique qui « porte » le sens, tandis que les voyelles et certaines modifications consonantiques précisent le sens et indiquent la fonction grammaticale. Cette structure n'est sans doute pas étrangère à l'évolution de ces langues vers le principe alphabétique, et plus précisément vers l'alphabet consonantique, à partir du système cunéiforme.
L'ALPHABET OUGARITIQUE
Le premier alphabet dont on ait pu donner une interprétation précise est l'alphabet ougaritique, apparu au moins quatorze siècles avant notre ère. Différent du cunéiforme mésopotamien, qui notait des idées (cunéiformes idéographiques), puis des syllabes (cunéiformes syllabiques), il note des sons isolés, en l'occurrence des consonnes, au nombre de vingt-huit. Il a probablement emprunté la technique des cunéiformes aux Akkadiens, en pratiquant l'acrophonie (phénomène par lequel les idéogrammes d'une écriture ancienne deviennent des signes phonétiques correspondant à l'initiale du nom de l'objet qu'ils désignaient. Ainsi, en sumérien, le caractère cunéiforme signifiant étoile, et qui se lisait ana, finit par devenir le signe de la syllabe an) et en simplifiant certains caractères. La véritable innovation est celle des scribes d'Ougarit : gravés dans l'argile, comme les signes mésopotamiens, les caractères d'apparence cunéiforme sont en fait des lettres, déjà rangées dans l'ordre des futurs alphabets. C'est en cette écriture que les trésors de la littérature religieuse d'Ougarit, c'est-à-dire la littérature religieuse du monde cananéen lui-même, nous sont parvenus.
L'ALPHABET DE BYBLOS
Alors que l'« alphabet » ougaritique demeure réservé à cette cité, l'alphabet sémitique dit « ancien » est l'ancêtre direct de notre alphabet. Sa première manifestation en est, au xie s., le texte gravé sur le sarcophage d'Ahiram, roi de Byblos : 22 signes à valeur uniquement de consonnes. Cet alphabet apparaît donc à Byblos (aujourd'hui Djebaïl, au Liban), lieu d'échanges entre l'Égypte et le monde cananéen. Ce système est utilisé successivement par les Araméens, les Hébreux et les Phéniciens. Commerçants et navigateurs, ces derniers le diffusent au cours de leurs voyages, notamment vers l'Occident, vers Chypre et l'Égée, où les Grecs s'en inspirent pour la création de leur propre alphabet. Car ce sont les Grecs qui, au xie s. avant J.-C., emploient, pour la première fois au monde, un système qui note aussi bien les voyelles que les consonnes, constituant ainsi le premier véritable alphabet.
Pour les deux alphabets d'Ougarit et de Byblos, entre lesquels il ne devrait pas y avoir de continuité globale, il est frappant que l'ordre des lettres soit le même et corresponde à peu près à celui des alphabets ultérieurs. Cet ordre, dont l'origine reste mystérieuse, serait très ancien.
LA FORME ET LE NOM DES LETTRES
Mais quel critère a déterminé le choix de tel graphisme pour noter tel son ? D'où viennent les noms des lettres ? L'hypothèse retenue répond à ces deux questions à la fois : une lettre devait fonctionner à l'origine comme un pictogramme (A figurait une tête de bœuf) ; on a utilisé ce pictogramme pour noter le son initial du nom qui désignait telle chose ou tel être dans la langue (A utilisé pour noter « a », issu par acrophonie d'aleph, nom du bœuf en sémitique) ; enfin, on a donné à la lettre alphabétique nouvelle le nom de la chose que figurait le pictogramme originel (aleph est le nom de la lettre A). C'est sur cette hypothèse que s'est fondé l'égyptologue Alan Henderson Gardiner dans ses travaux sur les inscriptions dites « protosinaïtiques » découvertes dans le Sinaï. Elles sont antérieures au xve s. avant J.-C., présentent quelque signes pictographiques et notent une langue apparentée au cananéen. Les conclusions de Gardiner ne portent que sur quelques « lettres » de ce protoalphabet, mais elles semblent convaincantes et devraient permettre de repousser de cinq à sept siècles la naissance du système alphabétique.
LA CHAÎNE DES PREMIERS ALPHABETS
Des convergences dans la forme, le nom et la valeur phonétique des lettres établissent, entre les alphabets, une parenté incontestable. Pour l'araméen et le grec, celle-ci est collatérale : ils ont pour ancêtre commun le phénicien. De l'alphabet araméen dérivent l'hébraïque (iiie ou iie s. avant J.-C.) et probablement l'arabe (avant le vie s. après J.-C.), avec ses diverses adaptations, qui notent le persan ou l'ourdou, par exemple ; à moins qu'il ne faille distinguer une filière arabique qui aurait une parenté collatérale avec le phénicien. Du grec découle la grande majorité des alphabets actuels : étrusque (ve s. avant J.-C.), italiques puis latin (à partir du ve s. avant J.-C.), copte (iie-iiie s. après J.-C.), gotique (ive s.), arménien (ve s.), glagolitique et cyrillique (ixe s.). La propagation du christianisme joua un rôle majeur dans cette filiation : c'est pour les besoins de leur apostolat que des évangélisateurs, s'inspirant des alphabets grec ou latin dans lesquels ils lisaient les Écritures, constituèrent des alphabets adaptés aux langues des païens.
Quant aux alphabets asiatiques, au nombre d'au moins deux cents, on pense qu'ils remontent tous à l'écriture brahmi. La devanagari, par exemple, a servi à noter le sanskrit et note aujourd'hui le hindi. D’aucuns supposent que l'écriture brahmi aurait été elle-même créée d'après un modèle araméen. Selon cette hypothèse, tous les alphabets du monde proviendraient donc de la même source proche-orientale.
L'ALPHABET AUJOURD’HUI
Avec la grande extension de l'alphabet, la fonction de l'écrit a évolué. À la conservation de la parole, ou, sur une autre échelle, de la mémoire des hommes, s'est ajoutée l'éducation, l'œuvre de culture, souvent synonyme d'« alphabétisation ». Il existe bel et bien une civilisation de l'alphabet, accomplissement de celle de l'écriture, où un autodafé de documents écrits est considéré comme un acte de barbarie. Depuis le siècle dernier, une étape importante s'est amorcée avec la diffusion de l'alphabet latin hors de l'Europe occidentale, surtout pour noter des parlers encore non écrits, en Afrique ou dans l'ex-Union soviétique. En Turquie, par exemple, la réforme de 1928 (utilisation de l’alphabet latin, légèrement enrichi de diacritiques et d’une lettre supplémentaire) a permis de rapprocher le pays de la civilisation occidentale.
LINGUISTIQUE
L'écriture est un code de communication secondaire par rapport au langage articulé. Mais, contrairement à celui-ci, qui se déroule dans le temps, l'écriture possède un support spatial qui lui permet d'être conservée. La forme de l'écriture dépend d'ailleurs de la nature de ce support : elle peut être gravée sur la pierre, les tablettes d'argile ou de cire, peinte ou tracée sur le papyrus, le parchemin ou le papier, imprimée ou enfin affichée.
Selon la nature de ce qui est fixé sur le support, on distingue trois grands types d'écriture, dont l'apparition se succède en gros sur le plan historique, et qui peuvent être considérés comme des progrès successifs dans la mesure où le code utilisé est de plus en plus performant : les écritures synthétiques (dites aussi mythographiques), où le signe est la traduction d'une phrase ou d'un énoncé complet ; les écritures analytiques, où le signe dénote un morphème ; les écritures phonétiques (ou phonématiques), où le signe dénote un phonème ou une suite de phonèmes (syllabe).
LES ÉCRITURES SYNTHÉTIQUES
On peut classer dans les écritures synthétiques toutes sortes de manifestations d'une volonté de communication spatiale. Certains, d'ailleurs, préfèrent parler en ce cas de « pré-écriture », dans la mesure où ces procédés sont une transcription de la pensée et non du langage articulé. Quoi qu'il en soit, le spécialiste de la préhistoire André Leroi-Gourhan note des exemples de telles manifestations dès le moustérien évolué (50 000 ans avant notre ère) sous la forme d'incisions régulièrement espacées sur des os ou des pierres. À ce type de communication appartiennent les représentations symboliques grâce à des objets, dont un exemple classique, rapporté par Hérodote, est le message des Scythes à Darios ; il consistait en cinq flèches d'une part, une souris, une grenouille et un oiseau d'autre part, formes suggérées à l'ennemi pour échapper aux flèches. Ce genre de communication se retrouve un peu partout dans le monde dans les sociétés dites primitives. On peut ainsi signaler les systèmes de notation par nœuds sur des cordelettes (quipus des archives royales des Incas), mais la forme la plus courante d'écriture synthétique est la pictographie, c'est-à-dire l'utilisation de dessins figuratifs (pictogrammes), dont chacun équivaut à une phrase (« je pars en canot », « j'ai tué un animal », « je rentre chez moi », etc.) : c'est le système utilisé par les Inuits d'Alaska, les Iroquois et les Algonquins (wampums) ou encore par les Dakotas. Les limites de ces modes d'expression apparaissent évidentes : ils ne couvrent que des secteurs limités de l'expérience, ils ne constituent pas, comme le langage, une combinatoire.
LES ÉCRITURES ANALYTIQUES
Dans les écritures analytiques (dites aussi, paradoxalement, « idéographiques »), le signe ne représente pas une idée mais un élément linguistique (mot ou morphème), ce n'est plus une simple suggestion, c'est une notation. En réalité, le manque d'économie de ce système (il y aurait un signe pour chaque signifié) fait qu'il n'existe pas à l'état pur : toutes les écritures dites idéographiques comportent, à côté des signes-choses (idéogrammes), une quantité importante de signes à valeur phonétique, qu'il s'agisse des cunéiformes suméro-akkadiens, des hiéroglyphes égyptiens ou de l'écriture chinoise. Par exemple, en chinois, on peut distinguer, en gros, cinq types d'idéogrammes : les caractères représentant des objets, et qui sont, à l'origine, d'anciens pictogrammes (le soleil, la lune, un cheval, un arbre, etc.) ; les caractères évoquant des notions abstraites (monter, descendre, haut, bas) ; les caractères qui sont des agrégats logiques, formés par le procédé du rébus, en associant deux signes déjà signifiants (une femme sous un toit pourra dénoter la paix) ; les caractères utilisés pour noter des homophones : tel caractère désignant à l'origine un objet donné sera utilisé pour noter un mot de même prononciation mais de sens complètement différent ; les caractères qui sont des composés phonétiques, constitués, à gauche, d'un élément qui indique la catégorie sémantique (clef) et, à droite, d'un élément indiquant la prononciation (ce dernier type de caractère constitue jusqu'à 90 % des entrées d'un dictionnaire chinois). Cependant, l'écriture chinoise, malgré ses recours au phonétisme, n'est pas liée à la prononciation : elle peut être lue par les locuteurs des différents dialectes chinois, entre lesquels il n'y a pas d'intercompréhension orale ; elle sert, d'autre part, à noter des langues complètement différentes comme le lolo, l’ancien coréen (qui a depuis créé son propre alphabet, le hangul) ou le japonais, où les idéogrammes chinois coexistent avec une notation syllabique.
LES ÉCRITURES PHONÉTIQUES
Les écritures dites « phonétiques » témoignent d'une prise de conscience plus poussée de la nature de la langue parlée : les signes y ont perdu tout contenu sémantique (même si, à l'origine, les lettres sont d'anciens idéogrammes), ils ne sont plus que la représentation d'un son ou d'un groupe de sons. Trois cas peuvent se présenter, selon que le système note les syllabes, les consonnes seules ou les voyelles et les consonnes. Les syllabaires ne constituent pas toujours historiquement un stade antérieur à celui des alphabets. S'il est vrai que les plus anciens syllabaires connus (en particulier le cypriote) précèdent l'invention de l'alphabet (consonantique) par les Phéniciens, d'autres sont, au contraire, des adaptations d'alphabets : c'est le cas de la brahmi, ancêtre de toutes les écritures indiennes actuelles, qui procède de l'alphabet araméen, ou du syllabaire éthiopien, qui a subi des influences sémitiques et grecques.
Quant à la naissance de l'alphabet grec, elle a été marquée, semble-t-il, aussi bien par le modèle phénicien que par celui des syllabaires cypriote et crétois (linéaires A et B). Les systèmes syllabiques se caractérisent par leur côté relativement peu économique, puisqu'il faut, en principe, autant de signes qu'il y a de possibilités de combinaison voyelle-consonne. D'autre part, ils présentent l'inconvénient de ne pouvoir noter simplement que les syllabes ouvertes (C+V) ; en cas de syllabe fermée (C+V+C) ou de groupement consonantique (C+C+V), l'un des signes contiendra un élément vocalique absent de la prononciation.
Les alphabets consonantiques, dont le phénicien est historiquement le premier exemple, ne conviennent bien qu'à des langues ayant la structure particulière des langues sémitiques : la racine des mots y possède une structure consonantique qui est porteuse de leur sens, la vocalisation pouvant être devinée par l'ordre très rigoureux des mots dans la phrase, qui indique leur catégorie grammaticale et, par là même, leur fonction. L'alphabet araméen a servi de modèle à toute une série d'alphabets (arabe, hébreu, syriaque, etc.), ainsi qu'à des syllabaires (brahmi) ; l'alphabet arabe a servi et sert à noter des langues non sémitiques, non sans quelques difficultés (il a ainsi été abandonné pour le turc).
Alphabet grec
L'alphabet grec est historiquement le premier exemple d'une écriture notant à la fois et séparément les consonnes et les voyelles. Il a servi de modèle à toutes les écritures du même type qui existent actuellement : alphabets latin, cyrillique, arménien, géorgien, etc.
PÉDAGOGIE
L'apprentissage de l'écriture fait appel à une maîtrise de la fonction symbolique ainsi qu'à une maîtrise motrice de l'espace et du temps. Il s'effectue soit par l'étude progressive et linéaire des lettres, servant à former les mots (méthode analytique), soit par la compréhension directe des mots dans le contexte de la phrase, dont on décomposera seulement après les lettres (méthode globale d’Ovide Decroly). Mais ce sont de plus en plus des méthodes mixtes qui sont utilisées, intégrant parfois expression corporelle et exercices de motricité.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
