|
| |
|
|
 |
|
1905, l'année où Einstein bouleverse la physique moderne |
|
|
| |
|
| |

1905, l'année où Einstein bouleverse la physique moderne
Par Azar Khalatbari le 08.02.2015 à 14h00, mis à jour le 25.11.2015 à 12h22
En quatre articles, le jeune physicien de 26 ans émet des théories surprenantes qui vont révolutionner notre compréhension de l’Univers. Retour sur cette "année miraculeuse"…
CRÉDIT : AFP
PENSEE. Il y a 110 ans tout juste, un très jeune chercheur – même pas 26 ans – allait révolutionner en un an seulement, notre compréhension de l’Univers et ce pour des décennies ! De sorte qu’encore aujourd’hui les physiciens sont chaque jour épatés par le brio de ses démonstrations, la justesse de ses prédictions, et les épistémologues n’en finissent pas d’étudier le cheminement de sa pensée. Son nom : Albert Einstein… L’essentiel se passe en cette année 1905 – qui a été par la suite baptisée "année miraculeuse". L’ensemble de cet ouragan de pensée est présenté ci-dessous au cours d’une conférence TED, en 5 mn chrono…
Après des études de maths et de physique, l’élève Einstein préfère le labo aux cours théoriques et obtient un emploi à l’Office des brevets suisse… grâce à l’aide d’un des amis de son père. Six jours par semaine il y travaille mais le septième jour est souvent consacré à sa passion : discuter avec quelques amis, refaire le monde à sa manière c’est-à-dire le comprendre d’abord, et consigner les quelques idées qui naissent lors de ces discussions dans des articles qu’il envoie sans trop y croire à des publications scientifiques. Ce travail n’est pas très remarqué.
1-La lumière est à la fois onde et particule
Mais en mars 1905, le vent tourne : Einstein propose quatre articles qui vont coup sur coup révolutionner la physique ! Le premier avance une hypothèse étonnante. Alors que depuis quelques décennies, les physiciens ont admis que la lumière est une onde, Einstein propose que la lumière soit considérée comme une particule. Cela permet, affirme-t-il, d’expliquer un phénomène encore mystérieux –l’effet photoélectrique, le fait que lorsqu’un matériau reçoit de la lumière, il perd un électron, une des particules de matière que renferment les atomes. La communauté scientifique mettra vingt ans avant de comprendre fondamentalement cette idée. En avance sur son temps, le travail d’Einstein n’a pas été apprécié à sa juste valeur. Aujourd’hui, la dualité de la lumière – le fait qu’elle puisse être considérée à la fois comme onde et particule – est la base même de la physique quantique.
2-La matière est faite d’atomes
Deux mois plus tard, en mai 1905, Einstein soumet un second article et s’attaque à une des questions les plus brûlantes de la physique de l’époque : est-ce que les atomes existent vraiment ? A l’époque, en effet, la plupart des chercheurs admettait que la matière était constituée d’un ensemble d’éléments indivisibles… mais nombreux étaient ceux qui se demandaient si ces minuscules bouts de matière étaient une vue de l’esprit, une hypothèse commode ou… une réalité à l’image des objets macroscopiques de la physique que l’on peut toucher et sentir ? Dans ce second article, Einstein l’affirme sans aucun doute : oui les atomes existent et il propose même une expérience pour appuyer son affirmation : le mouvement désordonné d’une poignée de particules dans l’eau – que l’on appelle mouvement brownien, comme par exemple une poignée de pollen que l’on éparpille dans un verre d’eau, peut être précisément prédit si l’on suppose que la matière est faite d’atomes. En effet, ces particules que nous observons rentrent en collision avec des milliards d’atomes invisibles du liquide et rebondissent sur eux à chaque fois, comme lorsque deux boules de billard s’entrechoquent. Très vite, des calculs ont été effectués et les mouvements de pollen – devenu prévisibles – ont prouvé l’existence des atomes.
3-La vitesse de la lumière est constante
En quelques mois, les physiciens allaient de surprise en surprise : ce très jeune scientifique, travaillant au rythme d’un jour par semaine, avait déjà à son actif deux conclusions essentielles. Mais Einstein n’allait pas s’arrêter en si bon chemin… Il restait encore 6 mois à cette année miraculeuse de 1905. Le troisième article paru en juin. Il concernait une incompatibilité entre deux principes physiques – d’une part, la loi du mouvement qui remontait à Galilée considérait que le mouvement absolu ne pouvait exister : en effet le mouvement d’un objet dépend de la position de l’observateur. Par exemple, lorsqu’un train passe sans s’arrêter le long d’un quai, ceux qui attendent sur le quai voient passer le train à 100 km/heure, alors que le voyageur installé dans le wagon, ne ressent aucun mouvement. Ce n’est que s’il regarde le paysage qui défile, qu’il se rend compte du mouvement du train. Si un autre voyageur se déplace dans le train à une vitesse de 6 km/h – une marche rapide – l’observateur sur le quai le voit se déplacer à une vitesse de 106 km/h (c’est ce que l’on appelle la règle d’addition des vitesses), tandis que le voyageur assis lui attribue une vitesse de 6 km/h. Le mouvement ne peut être défini que par rapport à un référentiel. Ce principe avait fait ses preuves à maintes reprises!
Mais, parallèlement, la théorie électromagnétique, qui décrit les déplacements de charges électriques et magnétiques, stipule que ces charges se déplacent toujours à la même vitesse et ce, quelle que soit la position de l’observateur. Alors laquelle des deux dit vrai ? Ce genre de dichotomie énerve les physiciens au plus haut point tant ils considèrent que leur discipline est universelle, une et inséparable. Mais un jour en mai, une idée géniale germe dans l’esprit d’Einstein : il y a une seule manière d’éliminer cette contradiction, c’est de supposer que la vitesse de la lumière est constante, quel que soit le référentiel considéré ! Un principe qu’il suppose, comme un coup de bluff – en utilisant des « expériences de pensées » – ces expériences que l’on peut imaginer et non réaliser concrètement. Admettons qu’un train se déplace à la vitesse de la lumière, le voyageur qui marche dans le train ira – aux yeux de l’observateur sur le quai – toujours à la vitesse de la lumière et non pas à la vitesse de la lumière plus 6 km/h !
Cette incroyable idée a des retombées gigantesques : elle sera à la base de la « relativité restreinte », et elle a aujourd’hui de nombreuses applications, depuis la conception des accélérateurs de particules jusqu’aux GPS.
4- La masse et l’énergie sont équivalentes
C’est en septembre que le quatrième article fut envoyé. Pendant tout l’été Einstein a réfléchi aux conséquences de la relativité restreinte et annonce ce qui lui semble une conséquence directe: la masse et l’énergie, ces deux entités qui semblent si différentes – l’une matérielle, l’autre non – sont en fait équivalentes. Un petit fragment de masse représente même une quantité immense d’énergie car, pour passer de l’une à l’autre il faut tout bonnement appliquer la formule E=Mc2. (c étant la vitesse de la lumière dans le vide, soit 300 000 km/s)
La formule deviendra célèbre – elle est l’équation la plus connue de toute la physique – Aujourd’hui sans cesse utilisée en physique des particules et atomique, mais Einstein ne sera reconnu qu’en 1919. Cette année-là, lors d’une éclipse solaire, les prédictions de sa théorie de la relativité générale furent vérifiées par l’expérience. Le Nobel de physique n’arrivera qu’en 1921… couronnant ses tous premiers travaux sur l’effet photoélectrique.
Mais revenons en 1905, la folle année où fut annoncé l’essentielle de la physique moderne : la lumière est à la fois onde et particule, les atomes existent bel et bien, la vitesse de la lumière est finie, la masse et l’énergie sont équivalentes !
Cette année-là, le prix Nobel fut attribué à l’allemand Philipp Lenard, pour la découverte des rayons cathodiques, ces faisceaux d’électrons que l’on observe dans les tubes à vide. Lenard deviendra plus tard, pendant le régime nazi, un des défenseurs de la science « aryenne », la « deutsche physic ». Antisémite et nationaliste, il s’opposera à Einstein, pacifiste et pro-européen. Il qualifiera Einstein de représentant de la physique juive et l’accusera de vouloir dominer l’ensemble de la physique.
Pour en savoir plus : le Hors-Série de Sciences et Avenir
DOCUMENT sciences et avenir.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
La particule découverte cet été ressemble de plus en plus au boson de Higgs |
|
|
| |
|
| |

La particule découverte cet été ressemble de plus en plus au boson de Higgs
Par Sciences et Avenir le 08.03.2013 à 10h54, mis à jour le 08.03.2013 à 10h54
La nouvelle particule découverte au CERN l'été dernier ressemble de plus en plus au boson de Higgs selon les derniers résultats présentés mercredi 6 mars en Italie par les équipes de chercheurs.
La nouvelle particule découverte au Cern l'été dernier ressemble de plus en plus au boson de Higgs, ce chaînon manquant de la physique des particules, selon les derniers résultats présentés mercredi en Italie par les équipes de chercheurs.
(C) AFP
Une analyse plus approfondie est cependant encore nécessaire avant que les physiciens puissent l'identifier définitivement comme tel, a indiqué l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) dans un communiqué.
L'identification de la fameuse particule passe par une analyse détaillée de ses propriétés et de la façon dont elle interagit avec d'autres particules. Depuis l'annonce spectaculaire de juillet dernier, beaucoup plus de données ont été analysées, et ces propriétés apparaissent de plus en plus clairement.
Les physiciens des expériences Atlas et CMS du Grand collisionneur de hadrons (LHC), à l'origine de la découverte, ont ainsi présenté leurs derniers résultats mercredi à La Thuile, dans les Alpes italiennes, lors des "Rencontres de Moriond", la première conférence de physique majeure de l'année.
La propriété clé qui permettra de dire s'il s'agit bel et bien du Higgs est appelée "spin". Le "Modèle Standard", définissant la structure fondamentale de la matière, impose que le spin du boson de Higgs soit nul.
"Toutes les analyses effectuées jusqu'à présent indiquent clairement un spin égal à zéro, mais elles ne peuvent pas encore exclure complètement la possibilité que la particule ait un spin égal à deux", a indiqué le CERN. Auquel cas il s'agirait d'autre chose que le boson de Higgs.
"Tant que nous n’aurons pas déterminé avec certitude le spin de la particule, on continuera de parler d’une particule de type Higgs", a expliqué Sergio Bertolucci, directeur de la recherche du CERN. "Nous ne pourrons la qualifier de Higgs que lorsque nous saurons qu’elle a un spin nul", a-t-il poursuivi.
Les Rencontres de Moriond ont débuté samedi et se poursuivront jusqu'au 16 mars.
Sciences et Avenir avec AFP, 8/3/13
À LIRE AUSSI. Le CERN annonce l'existence du boson de Higgs
ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE (CERN)
5 réactions
* marcantoinejeulliau 09.03.2013 à 20h13 A la pénultième question : qu'est-ce que le mouvement d'un objet dans l'espace ? la science physique peut aujourd'hui répondre par ‘'l'absolu‘', mais pour cela il lui faut accepter de parler de plusieurs expériences reproductibles par tout un chacun, expériences qui permettent de dépasser Einstein et consorts et d'intégrer les découvertes associées aux théories relativistes et quantique en en permettant une réinterprétation synthétique unificatrice. Ainsi deux photons gamma peuvent être vu comme des vagues solitaire d'éther, autrement dit comme des SOLITONS en forme d'anneaux dont les trajectoires spatiales habituellement rectilignes donnent dans l'instant formes aux particules de matière (électron) et antimatière (positon) EN SE BOUCLANT SUR ELLES-MÊMES après interactions, un peu ‘'comme les cordes‘' fermées de la fameuse théorie. Ce qui, dans le modèle standard, a été appelé une transition de phase. Dans ce paradigme synthétique et scientifique du monde physique, les forces dites fondamentales s'imposent finalement et très simplement non comme véhiculées par des particules, mais bien comme des réponses, comme des réactions physiques de l'environnement -de ce substrat spatial qui leur a donné naissance, les porte et en permet la propagation- aux ‘'présences en actes‘' des particules dites de matière. Bonne nuit.
* marcantoinejeulliau 09.03.2013 à 16h31 suite 2 ... ... (ou hystérésis …) sillages encore décrits dans le modèle standard en employant les termes ‘'gluons‘' pour colle à quarks …
* marcantoinejeulliau 09.03.2013 à 16h21 BonTout, suite. Cela dit -et si c'est bien le cas- alors la copie du modèle dit standard de cette physique est à revoir … et cela depuis Galilée. Il est en effet admis depuis Einstein qu'une fois émis dans un espace-temps vide de champ de force un photon de lumière suit une trajectoire dite ‘'rectiligne‘' dans l'espace dit ‘'vide‘' … Et cela, que n'a pas vu ledit père des relativités mathématiques, permet de démontrer expérimentalement -et donc d'affirmer dans l'esprit scientifique de ce temps- que le mouvement n'est pas ‘'comme rien‘' comme l'avait écrit Galilée, mais qu'il est observable dans le tout, qu'il ‘'EST ABSOLU‘', autrement dit qu'il se produit et est observable dans un espace ‘'plein‘' de quelque chose, dans un substrat éthéré … quel que soit le nom que l'on voudra bien lui donner : éther, champ de X ou autre champ emplissant tout l'espace et qui porte depuis toujours et encore tous les photons de l'Univers, des photons gamma qui peuvent –en voyant leurs trajectoires se boucler sur elles-mêmes après interaction- donner naissance aux électrons de notre matière ordinaire et aux positrons de l'antimatière. Et cela sans faire appel aux calculs ayant permis de supputer l'existence des bosons dit de Higgs. De même que les quarks peuvent être décrits comme des quanta d'énergie analogues à des photons pris dans leurs propres sillages (ou hystérésis …) s
* corpuscule 09.03.2013 à 16h13 Le boson de Higgs est un phénomène physique certes, parfaitement justifier sur le plan théorique, mais la question reste manifestement soulevée concernant sa nature exacte au sein du modèle standard des particules élémentaires. Ce ne sont pas les expériences lourdes qui vont pouvoir l'extirper du fond de la pression exercée par la masse de notre galaxie, la solution résiderait tout simplement dans l'analyse de la fameuse dualité onde corpuscule, le boson de Higgs n'est pas une particule élémentaire proprement dite, il serait un état physique ondulatoire propre à la fonction d'onde bosonique. L'identité du boson de Higgs est d'ordre topologique pure, son spin est absorbé par sa super symétrie axiale où ses propriétés cinétiques sont en quelque sorte paralysées par son confinement à sa propre image en miroir. Ce phénomène ne peut être clarifié que par l'établissement d'un diagramme panoramique au déploiement de l'arbre généalogique de toute la gamme des ingrédients de base de la matière dans leurs versions corpusculaires, autrement dit, dans un système matriciel, multidimensionnel, complet au sens mathématique large du terme. EDDAAL.A
* marcantoinejeulliau 09.03.2013 à 11h49 BonTout , En s'alliant à la philosophie et à l'art pour devenir la première ‘'trilogie‘' des SCIENCES, et comme jamais à la mathématique pour virtuellement aboutir à la quadrature du cercle*, LA PHYSIQUE en cette méthode tend de plus en plus à confirmer que tout ce qui existe (espace, temps, énergie, forces, matière, information, langages, langues … etc.) est MANIFESTATIONS d'un substratum quantifiable et unique emplissant tout l'espace-temps. Substrat du genre traditionnel éther devenu nouveau champ de Higgs et dont l'EXPRESSION au moment dit du bigbang n'a fait qu'EVOLUER de la simplissime et ‘'réelle‘' forme en ‘'?‘' d'un SOLITON Champs-Ondulatoire-Quantum-Information vers la vie et la pensée organisées lors d'interactions complexifiantes. (CQFD…) * : ‘'C ‘' étant la vitesse de la lumière, ‘'n?‘' le nombre de Loschmidt nous trouvons : C? = n? … ! ? A suivre …
DOCUMENT sciences et avenir.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
LES MATÃRIAUX |
|
|
| |
|
| |
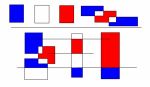
Les matériaux
Depuis l’âge de pierre, les matériaux font partie du quotidien et de l’histoire de l’Homme. Au fil du temps, ils sont devenus plus résistants, plus intelligents pour conférer aux objets qui nous entourent de nouvelles fonctionnalités. Découvrez les grandes familles de matériaux, la démarche scientifique associée à la conception d’un nouveau matériau et les enjeux des matériaux dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de la santé et des technologies de l’information et de la communication.
QU’EST-CE QU’UN MATÉRIAU ?
Un matériau est une matière d’origine naturelle ou artificielle que l’Homme utilise et/ou conçoit pour fabriquer des objets, construire des bâtiments ou des machines.
* Les matériaux sont différenciés selon leur provenance (issus d’êtres vivants par exemple) et leurs propriétés, qu’elles soient mécaniques (flexibilité ou rigidité…), chimiques (perméabilité ou imperméabilité à l’eau…) ou encore physiques (conductivité de l’électricité ou de la chaleur…).
Ils sont généralement classés en différentes grandes familles :
*
* Les matériaux métalliques qui regroupent les métaux : fer, cuivre, bronze et les alliages métalliques : acier inoxydable
* Les matériaux organiques qui sont issus d’êtres vivants, plantes ou animaux (bois, coton, papier…)
* Les matériaux minéraux ou inorganiques : roche, céramique, verre.
* Les matériaux plastiques, qui, en général proviennent de combustibles dits fossiles se trouvant dans le sol, comme le pétrole par exemple.
* Les matériaux composites qui combinent plusieurs matériaux de famille différente pour obtenir de multiples propriétés (exemple : fibre de carbone).
*
Les matériaux composent tous les objets qui nous entourent. Le choix des matériaux qui constituent un objet dépend des besoins et propriétés voulues pour l’objet. La combinaison de certains matériaux permet de combiner plusieurs propriétés. Ainsi, le béton armé, constitué de béton et d’acier, permet de réaliser des constructions qui pourront supporter d’importantes charges (caractéristique du béton) mais aussi des efforts de traction (caractéristique de l’acier).
Notions clés
*
* Il existe différentes familles de matériaux : métalliques, organiques, minéraux, plastiques et composites.
* La conception de nouveaux matériaux répond à différents enjeux. En santé, ils sont utilisés pour suivre, diagnostiquer ou soigner les patients. Dans le domaine de l'énergie, ils permettent de récupérer, stocker et générer plus d’énergie. Dans le domaine des technologies de l’information, ils permettent une meilleure communication des objets entre eux.
* Enfin, les matériaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable en prenant en compte, dès leur conception, leur recyclage mais aussi en économisant de la matière et de l’énergie.
L’HOMME CRÉATEUR DE MATÉRIAUX DEPUIS L’ÂGE DE PIERRE
Depuis toujours, les matériaux ont joué un rôle clé dans la société humaine. Dès l’âge de pierre, l’Homme taille le silex pour créer ses premiers outils. Lorsque le cuivre et le bronze sont découverts, de nouveaux usages naissent et viennent changer les modes de vie. Au fur et à mesure des découvertes et conception de nouveaux matériaux, l’Homme fait évoluer ses outils, ses constructions, ses modes de vie, et ses besoins.
COMMENT SE CONÇOIVENT LES MATÉRIAUX ?
Du laboratoire à l’industrie
La recherche et le développement dans le domaine des nouveaux matériaux sont importants car ils conditionnent en grande partie les avancées scientifiques et les innovations technologiques de demain. Les matériaux sont souvent la clé de l’essor d’une technologie. Par exemple, la démocratisation des téléphones et ordinateurs portables a été permise en partie grâce aux efforts de recherche et développement menés sur les matériaux des batteries de recharge de ces appareils.
Pour concevoir un nouveau matériau, les ingénieurs et chercheurs vont d’abord commencer à dresser le « portrait-robot » type du matériau à partir de l'analyse des besoins et des attentes des industriels et consommateurs finaux. Ils conçoivent ainsi un cahier des charges avec les propriétés voulues pour le matériau : ce dernier doit-il être résistant ? Doit-il supporter des hautes températures ? Doit-il conduire l’électricité ?... Outre les propriétés recherchées pour le matériau, les scientifiques doivent considérer d’autres facteurs tels que le budget de conception et de réalisation du matériau, les matières premières à utiliser et leur disponibilité, l’impact de la fabrication du matériau sur l’environnement et penser au devenir du matériau en fin de vie.
*
Après avoir défini le cahier des charges, les scientifiques vont chercher à réaliser le matériau par différentes voies (procédés de synthèse chimique, procédés de cuisson, procédé de fabrication additive…). Cette démarche nécessite au préalable un travail théorique d’analyse des connaissances scientifiques et techniques actuelles, complété par des modélisations et simulations numériques du matériau. Ces modèles numériques, réalisés à l’aide d’ordinateurs ou de supercalculateurs, permettent de prévoir en amont les propriétés et le comportement sur le long terme du matériau. Durant les différentes phases de conception et de réalisation du matériau, des expériences de caractérisation physique et chimique sont effectuées pour vérifier l’adéquation entre la théorie, les modèles prédits numériquement et la réalité physique.
Enfin, lorsque le matériau est fabriqué à l’échelle du laboratoire, il reste encore quelques étapes avant une mise en œuvre industrielle. Celle-ci doit en effet intégrer de nouvelles contraintes liées à une fabrication en série tout en conservant les performances du matériau.
fabrication additive Zoom sur... La fabrication additive : des matériaux imprimés en 3D
La fabrication additive consiste à créer un objet couche par couche, à partir d’un modèle réalisé par ordinateur. Elle s’oppose aux méthodes traditionnelles, dites « soustractives », qui permettent de façonner une pièce dans un bloc de matière.
*
* Pourquoi la fabrication additive suscite-t-elle autant d’intérêt ? Le premier avantage de ce mode de fabrication, à partir d’imprimantes 3D, est la liberté de conception géométrique. A cet avantage, s’ajoute celui des propriétés physico-chimiques. Les pièces étant conçues couche par couche, il est possible d’attribuer à l’une d’elle certaines propriétés et d’autres à sa voisine. Enfin, les technologies d’impression 3D pourraient permettre, en théorie, d’économiser les ressources en matières premières, dans la mesure où elles évitent la génération de chutes de matériaux, inévitables lorsqu’une pièce est usinée de façon soustractive à partir d’un plus gros bloc.
* Pour aller plus loin sur le sujet de la fabrication additive, lire le décryptage "Comment la fabrication additive peut-elle accompagner nos grandes transitions ?"
*
* LES ENJEUX DES NOUVEAUX MATÉRIAUX
Fabriquer des matériaux plus respectueux de l’environnement et recycler les matériaux
L’enjeu commun à toutes les recherches actuelles menées sur les matériaux est le développement durable. L’objectif est d’intégrer, dès le départ, dans les étapes de fabrication du matériau une optimisation de l’efficacité et du coût énergétique des procédés, une économie et un recyclage des matières premières, une réduction des déchets ultimes et de l’impact sur la santé de l’Homme et sur l’environnement. L’objectif est également de créer des matériaux recyclables voire, dans certains cas, biodégradables.
Cet enjeu est représenté par la stratégie des « 3 R » :
*
* Réduire, dès la production, la quantité de ressources susceptibles de finir en déchets (par exemple, limiter les emballages…).
* Réutiliser les produits usagés constitués de matériaux pour leur donner une deuxième vie. (Par exemple, collecte des téléphones portables qui sont ensuite reconditionnés et revendus).
* Recycler les matériaux en mettant en œuvre une filière de retraitement avec un tri sélectif des matériaux afin de les transformer en nouvelles matières premières qui pourront être réutilisées pour fabriquer de nouveaux matériaux.
* Le saviez-vous ?
En plus d’être respectueux de l’environnement, certains matériaux ont été créés pour dépolluer l’environnement. Ainsi, certains matériaux disposant de membranes poreuses permettent la dépollution des eaux.
La chimie verte, inspirée du concept de développement durable, peut aider à concevoir des matériaux plus facilement recyclables. Ainsi, les scientifiques cherchent désormais à limiter la production de matériaux issus du pétrole, en utilisant des matériaux biosourcés, à partir d’autres matières premières que des hydrocarbures, tout en conservant les propriétés des plastiques. Par exemple, des plastiques, produits à partir de molécules issues de l’huile de ricin ou encore de déchets viticoles, composent des parechocs.
Les enjeux des matériaux pour la santé
En matière de santé, les nouveaux matériaux peuvent être utilisés sous forme de pansements ou de textiles chirurgicaux. Ils peuvent également avoir pour finalité d’être utilisés à l’intérieur du corps. Dans ce cas, ils doivent être tolérés par l’organisme mais aussi résister sur le long terme à un milieu chimiquement évolutif.
Ces matériaux supportés par l’organisme sont appelés les biomatériaux. L’enjeu principal de la recherche pour ces matériaux est d’obtenir une bonne adaptation de l’organisme à l’introduction du biomatériau (implant, prothèse, …) et une réponse appropriée en vue des fonctions déficientes à restaurer. Par exemple, des matériaux à mémoire de forme peuvent être utilisés (matériaux qui ont la capacité de mémoriser une forme initiale même après une déformation) pour la composition des stents, appareils médicaux qui permettent d’éviter aux artères de se boucher à cause des caillots de sang.
*
Les enjeux des matériaux pour l’énergie
Au cœur du processus d’innovation des systèmes énergétiques, les matériaux du futur devront répondre à des spécifications toujours plus exigeantes en termes de sûreté, d’économie d’élaboration, de résistance, de durabilité, d’impact environnemental et de capacité de recyclage.
*
Module photovoltaïque avant/après délamination par CO2 supercritique. Ce procédé permet de séparer les différentes couches de matériau en vue de leur recyclage. La photographie illustre le gonflement des phases polymères après moussage en CO2 supercritique. © Y. Caudic / CEA
*
Dans le domaine du nucléaire où les installations sont conçues pour du très long terme (plusieurs dizaines d’années d’exploitation), certains composants tels que la cuve du réacteur ne peuvent pas être remplacés. Il s’avère donc nécessaire de développer une science prédictive du comportement des matériaux sur des temps longs.
*
Concernant les matériaux dédiés aux nouvelles technologies pour l’énergie, plusieurs axes d’amélioration sont explorés. Les matériaux de demain pour le photovoltaïque devront entre autres permettre d’augmenter le rendement des cellules photovoltaïques tout en abaissant leur coût.
*
Les enjeux des matériaux pour les nouvelles technologies de l’information et de la communication
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) se développent rapidement depuis la fin des années 90. Toujours plus petits, performants et intelligents, les composants de ces technologies nécessitent des nouveaux matériaux aux propriétés multiples et complémentaires.
*
L’enjeu est de miniaturiser les dispositifs tout en augmentant leurs performances et en multipliant les fonctions. Les structures complexes sont généralement réalisées à partir de motifs à l’échelle du nanomètre (1 nanomètre est égal à un milliardième de mètre, 1 000 fois plus fin qu’un cheveu) qui permettent d’associer des matériaux de nature différente pour allier leurs propriétés physiques.
*
Ces nouvelles avancées permettent aussi la création de matériaux comme des textiles connectés pour surveiller en temps réel les performances sportives ou bien des textiles intelligents qui peuvent transmettre des données et réagir en fonction des informations reçues. Par exemple, certains textiles réagissent à l’absence de lumière et s’illuminent.
DOCUMENT cea LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
La radioprotection |
|
|
| |
|
| |

L'HOMME ET LES RAYONNEMENTS
La radioprotection
Pour protéger la population et les travailleurs, des mesures ont été fixées à l’échelle internationale et nationale.
Publié le 1 juillet 2014
LES RÈGLES DE RADIOPROTECTION
La radioprotection est un ensemble de mesures destinées à assurer la protection sanitaire de la population et des travailleurs.
Trois règles de protection contre toutes les sources de rayonnements sont :
* s’éloigner de la source de rayonnements, car leur intensité diminue avec la distance ;
*
* mettre un ou plusieurs écrans entre la source de rayonnements et les personnes (par exemple, dans les industries nucléaires, de multiples écrans protègent les travailleurs. Ce sont des murs de béton, des parois en plomb et des verres spéciaux chargés en plomb) ;
*
* diminuer au maximum la durée de l’exposition aux rayonnements.
Ces mesures de radioprotection peuvent être comparées à celles que l’on prend contre les ultraviolets : utilisation d’une crème solaire qui agit comme un écran et limitation de l’exposition au Soleil.
Le “dosimètre” permet de mesurer la quantité de rayonnements auquel le travailleur est soumis.
© CEA/A. Gonin
Pour les sources radioactives émettant des rayonnements, deux autres recommandations sont à ajouter aux précédentes :
* attendre, quand cela est possible, la décroissance naturelle radioactive des éléments ;
*
* utiliser la dilution lorsque l’on a affaire à des gaz radioactifs.
Par exemple, les installations nucléaires ne sont pas démantelées aussitôt après leur arrêt, de façon à attendre une diminution de l’activité des zones. Dans les mines d’uranium souterraines, une ventilation très efficace permet de maintenir une faible concentration de radon dans l’air que respirent les mineurs.
Les travailleurs pouvant être soumis à des rayonnements ionisants lors de leur activité (industries nucléaires, médecins, radiologues…) portent dosimètres, gants, ceintures, bague qui mesurent la quantité de rayonnements auxquels ils ont été soumis. Ces dispositifs permettent de s’assurer que la personne n’a pas reçu une dose supérieure à la norme tolérée ou d’en mesurer la localisation et l’importance.
Plusieurs commissions indépendantes ont amené les autorités à fixer des normes réglementaires pour les limites de doses.
LES NORMES INTERNATIONALES DE RADIOPROTECTION
La prise de conscience du danger potentiel d’une exposition excessive aux rayonnements ionisants a amené les autorités à fixer des normes réglementaires pour les limites de doses. Ces limites correspondent à un risque supplémentaire minime par rapport au risque naturel, qui le rend donc acceptable.
* Depuis 1928, la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) rassemble des médecins, physiciens, biologistes… de tous pays. Cette autorité scientifique indépendante émet des avis précieux en matière de radioprotection, pour les réglementations propres à chaque État.
*
* L’UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) réunit des scientifiques représentant 27 nations. Il a été créé en 1955 au sein de l’ONU pour rassembler le maximum de données sur les niveaux d’exposition dus aux diverses sources de rayonnements ionisants et leurs conséquences biologiques, sanitaires et environnementales. Il établit un bilan régulier de ces données, mais également une évaluation des effets en étudiant les résultats expérimentaux, l’estimation des doses, les données humaines.
*
* Au niveau européen, l’Union européenne reprend ces avis dans ses propres normes ou directives.
Les normes légales de radioprotection donnent :
* une limite de dose efficace de 1 mSv/an pour la population et de 20 mSv/an en moyenne sur 5 ans pour les personnes directement affectées aux travaux sous rayonnements ionisants (industrie nucléaire, radiologie médicale) ;
*
* une limite de dose équivalente (organe) de 150 mSv pour le cristallin (œil) et 500 mSv pour la peau et les mains.
Le législateur divise par 20 les doses admissibles des travailleurs pour la population car il considère que celle-ci comporte des sujets de tous âges, de tous états de santé et qui ne sont pas si bien suivis médicalement…
AU NIVEAU NATIONAL
En France, c’est l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), autorité administrative indépendante, créée en 2006, qui a en charge le contrôle de la sûreté et de la radioprotection. L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), appui technique de l’ASN, est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la Défense, de l’Environnement, de l’Industrie, de la Recherche et de la Santé. Il a été créé en février 2002 par la réunion de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) et de l’Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI).
L’IRSN réalise des recherches, des expertises et des travaux dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la protection contre les rayonnements ionisants, du contrôle et de la protection des matières nucléaires, et de la protection contre les actes de malveillance.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
