|
| |
|
|
 |
|
Imagerie biomédicale à résolution microscopique : la révolution des ultrasons |
|
|
| |
|
| |

Imagerie biomédicale à résolution microscopique : la révolution des ultrasons
27 Nov 2015 | Par Inserm (Salle de presse) | Technologie pour la sante
Une équipe de l’Institut Langevin (ESPCI, CNRS, Inserm) dirigée par Mickaël Tanter, directeur de recherche Inserm à l’ESPCI, vient de franchir une étape déterminante vers l’imagerie médicale très haute résolution utilisant des ondes ultrasonores. Les chercheurs sont parvenus à rendre compte de l’activité vasculaire du cerveau d’un rat in vivo et de manière non invasive, avec une résolution bien meilleure que n’importe quelle technique existante. Loin de l’échographe standard, la technique s’inspire plutôt de la super résolution optique (FPALM) qui avait été récompensée du Prix Nobel de Chimie 2014. Leurs travaux, publiés dans la prestigieuse revue Nature, constituent une véritable révolution pour l’imagerie biomédicale, en offrant la première technique d’imagerie microscopique permettant de voir en profondeur dans les tissus. Les applications potentielles sont immenses, de la détection précoce de tumeurs cancéreuses à d’autres pathologies cardiovasculaires et neurologiques.

Accéder aux détails microscopiques de la matière vivante représente encore aujourd’hui un défi difficile à relever. Quelle que soit la technique utilisée, les chercheurs se heurtent à un obstacle de taille : plus la longueur d’onde est petite, plus l’absorption et la diffusion des ondes dans les tissus sont importantes, diminuant le pouvoir de pénétration du signal. Il faut donc choisir entre pouvoir de pénétration et résolution de l’image. Pourtant depuis une vingtaine d’années des progrès considérables ont été réalisés en imagerie par ultrasons particulièrement adaptée à l’imagerie préclinique et clinique, dont l’équipe de Mickaël Tanter est une des pionnières. Ces scientifiques ont mis au point un échographe ultra-rapide, qui équipe déjà de nombreux hôpitaux dans le monde. Mais cette fois, ils ont poussé la technique encore plus loin, atteignant une résolution spatiale inégalée en imagerie médicale : celle du micromètre (1 millième de millimètre).
Tout commence en 2009, lorsque Mickaël Tanter donne une conférence sur l’imagerie par ultrasons aux États-Unis et assiste à la présentation d’une nouvelle technique de microscopie optique à fluorescence avec une résolution meilleure que la limite de diffraction, barrière pourtant supposée infranchissable. L’invention de cette technique optique vaudra d’ailleurs à ses inventeurs le Prix Nobel de Chimie en 2014. Le chercheur français comprend que le concept des opticiens et chimistes américains, limité à une imagerie de surface, pourrait être transposé dans le monde des ondes ultrasonores en utilisant un des échographes ultrarapides de son laboratoire. Dès son retour en France, il propose à son collègue Olivier Couture, chercheur CNRS dans son équipe, de s’en inspirer pour développer leur propre technique à base d’ultrasons.
Les chercheurs décident alors d’utiliser un agent de contraste, ici des microbulles de 3 µm de diamètre déjà employées dans le domaine médical. Après plusieurs années de recherche en collaboration avec une équipe de neurobiologie (ESPCI/CNRS) dirigée par Zsolt Lenkei, directeur de Recherche Inserm, ils parviennent à injecter ces multitudes de microbulles dans une veine d’un rat. La cadence ultrarapide d’acquisition de 5000 images par seconde permet d’extraire de manière très précise le signal individuel provenant de chaque microbulle du bruit de l’ensemble des signaux rétrodiffusés. Leurs positions uniques peuvent alors être localisées individuellement par ultrasons avec une précision micrométrique lors de leur passage dans le cerveau.
En retraçant la position exacte de chaque bulle à chaque instant, les chercheurs ont réussi à reconstituer une cartographie complète du système vasculaire cérébral du rat vivant en quelques dizaines de secondes. Les détails sont tels qu’ils peuvent dissocier des vaisseaux sanguins séparés de quelques micromètres, alors que la résolution était jusqu’ici de l’ordre du millimètre et limitée par la diffraction.
Plus encore, la vitesse d’écoulement du sang est également mesurée très précisément à chaque instant avec une très grande dynamique allant de quelques dizaines de centimètres par seconde dans les gros vaisseaux jusqu’à moins d’1mm/s dans les plus petits vaisseaux du système vasculaire.
Des applications directes
Le gain en résolution est énorme, d’un facteur 20 en moyenne, d’autant plus que la technique est non invasive et rapide ce qui est très important pour le confort du patient. « Nous pensons être à l’aube d’une nouvelle révolution dans le domaine de l’imagerie médicale, confie Mickaël Tanter. En quelques dizaines de secondes, nous pouvons déjà recueillir des millions de signatures de nos microbulles et atteindre des résolutions microscopiques à plusieurs centimètres de profondeur. Nous pensons pouvoir encore accélérer cette technique pour réaliser ces images en une à deux secondes ouvrant ainsi la voie à l’imagerie fonctionnelle en super-résolution».
La technique sera prochainement évaluée sur l’homme, en particulier pour visualiser la micro-vascularisation hépatique chez des patients atteints de tumeurs du foie, ou encore pour l’imagerie trans-crânienne très haute résolution du réseau vasculaire cérébral chez l’adulte. Les applications potentielles sont très nombreuses, y compris la détection précoce de cancers dont la micro-vascularisation est à ce jour impossible à détecter. En fait n’importe quel organe pourra être imagé en 3D à l’échelle microscopique, via un appareil très peu volumineux.
Alors que la plupart des techniques actuelles de microscopie s’appuient sur des approches optiques limitées à une imagerie en surface, ce sont finalement les ultrasons qui viennent résoudre pour la première fois la question de l’imagerie microscopique en profondeur dans les organes.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Maladie dâAlzheimer : des variations génétiques rares augmentent de façon importante le risque de développer la pathologie |
|
|
| |
|
| |

Maladie d’Alzheimer : des variations génétiques rares augmentent de façon importante le risque de développer la pathologie
21 Nov 2022 | Par Inserm (Salle de presse) | Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie
Un consortium international rapporte deux nouveaux gènes dont certaines mutations rares augmentent fortement le risque de développer la maladie d’Alzheimer. Ces travaux ont été pilotés par deux équipes françaises dirigées par Gaël Nicolas et Jean-Charles Lambert et par une équipe néerlandaise. Ils offrent une meilleure compréhension des mécanismes génétiques de la maladie d’Alzheimer et ouvrent de nouveaux axes de recherche avec des modèles in vitro et in vivo plus pertinents. Ces résultats pourraient également être susceptibles d’aboutir à de nouvelles stratégies en recherche thérapeutique. Ces résultats sont publiés en novembre 2022 dans la revue Nature Genetics.
La maladie d’Alzheimer est la plus fréquente des maladies neurodégénératives, touchant environ 1 200 000 personnes en France, dont 4 % avant l’âge de 65 ans. Il s’agit d’une pathologie multifactorielle complexe causée par l’interaction de multiples facteurs de prédisposition génétiques et non génétiques. Parce que la composante génétique est particulièrement importante dans cette pathologie, la caractériser est un enjeu majeur de la recherche pour mieux connaître les mécanismes et pouvoir proposer des stratégies thérapeutiques pertinentes.
Si nos connaissances sur l’implication de variants génétiques communs (fréquence supérieure à 1 % dans la population générale) ont énormément progressé ces dernières années avec la découverte de 75 régions chromosomiques/gènes associées au risque de développer la maladie, le rôle des variants rares voire très rares a été insuffisamment étudié. Ceux-ci pourraient pourtant occuper une place importante dans la prédisposition génétique de la maladie, de par leurs effets biologiques directs et leur grande diversité.
Deux nouveaux gènes identifiés
C’est dans ce contexte qu’un consortium international, piloté par deux équipes françaises dirigées par Gaël Nicolas à Rouen et Jean-Charles Lambert à Lille ainsi qu’une équipe néerlandaise du CHU d’Amsterdam VUMC dirigée par Henne Holstege, a identifié deux nouveaux gènes, dont certaines mutations rares augmentent fortement le risque de développer la maladie d’Alzheimer. Les chercheurs de l’Inserm, de l’Institut Pasteur de Lille, du CHU de Lille, de l’Université de Lille, de l’Université de Rouen Normandie et du Centre National de Référence Malades Alzheimer Jeunes du CHU de Rouen ont, avec leurs collègues européens et américains, mené une étude de séquençage à haut-débit sur 16,032 patients et 16,522 témoins. Cette approche de séquençage permet de connaitre de façon la plus précise possible la plupart des variations génétiques portées par un individu.
En étudiant spécifiquement les régions de l’ADN qui codent pour les protéines de notre organisme (les exons), les chercheurs ont pu établir une cartographie des variations rares délétères qui modifient potentiellement les fonctions biologiques de ces protéines. Ils ont notamment pu valider l’implication de variants rares dans les gènes SORL1, TREM2 et ABCA7 mais aussi identifier deux nouveaux gènes majeurs, ATP8B4 et ABCA1, tandis qu’un dernier, ADAM10, reste à confirmer.
Certaines variations génétiques rares dans ces gènes sont associées à une augmentation importante du risque de développer la maladie, cet impact étant encore plus marqué dans les formes précoces de la maladie.
Mieux comprendre les mécanismes de la maladie
En raison de leurs impacts, ces variants rares vont permettre de mieux comprendre les mécanismes de la maladie. En effet, deux phénomènes pathologiques ont déjà bien été documentés : l’accumulation de peptides béta-amyloïdes et la modification et accumulation de la protéine Tau chez les malades.
Or, certains des gènes découverts dans cette étude sont impliqués dans la production ou l’agrégation des peptides béta-amyloïdes, confirmant leur rôle central dans le développement de la maladie. Par ailleurs, ce travail conforte le rôle important des cellules microgliales, dont une fonction majeure est de nettoyer le cerveau, rôle déjà mis au jour par des découvertes génétiques précédentes.
Ces résultats, basés sur la plus grande étude mondiale de données de séquençage à l’heure actuelle, permettent de faire un pas important dans la compréhension des facteurs génétiques de la maladie d’Alzheimer. Ils offrent une meilleure compréhension des mécanismes biologiques impliqués et permettent d‘ouvrir de nouveaux axes de recherche sur des modèles in vitro et in vivo plus pertinents ciblant ces nouveaux gènes. En poursuivant ces travaux, les scientifiques pourraient également être susceptibles d’aboutir à de nouvelles stratégies en recherche thérapeutique à l’avenir.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Mieux comprendre le développement de la tête humaine grâce à sa toute première cartographie 3D chez lâembryon |
|
|
| |
|
| |

Mieux comprendre le développement de la tête humaine grâce à sa toute première cartographie 3D chez l’embryon
08 Déc 2023 | Par Inserm (Salle de presse) | Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie

Image 3D obtenue en microscope à feuillet de lumière d’une glande lacrymale d’embryon humain de 12 semaines transparisé. Les différents éléments de la glande ont été colorisés à l’aide d’un logiciel de réalité virtuelle. © Raphael Blain/Alain Chédotal, Institut de la Vision (Inserm/CNRS/Sorbonne Université)
Améliorer nos connaissances du développement des structures complexes qui composent la tête humaine et ainsi mieux comprendre les anomalies congénitales causant des malformations : c’est le défi auquel une équipe de chercheuses et chercheurs de l’Inserm, du CNRS et de Sorbonne Université à l’Institut de la vision, de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et des Hospices civils de Lyon est en passe de répondre. Grâce à une technique innovante permettant de rendre les structures crâniennes transparentes puis de prendre des photos 3D des cellules qui les composent, cette équipe de recherche a pu établir la toute première carte tridimensionnelle de la tête humaine embryonnaire. Ces résultats, à paraître dans Cell, ont déjà permis de mieux comprendre comment se forment certaines structures complexes de la tête, comme les glandes lacrymales et salivaires ou les artères de la tête et du cou. Ils ouvrent la voie à de nouveaux outils d’étude du développement embryonnaire.
La tête est la structure la plus complexe du corps humain. Outre les muscles et la peau qui la protègent, et le cerveau qu’elle abrite dans le crâne, elle contient notamment des vaisseaux, des nerfs ainsi que des glandes endocrines (qui sécrètent des hormones directement dans la circulation sanguine), comme l’hypophyse, et exocrines (qui sécrètent des substances vers le milieu extérieur), comme les glandes salivaires, qui produisent la salive, ou les glandes lacrymales, qui sécrètent les larmes.
Les connaissances actuelles sur le développement de la tête humaine et des structures complexes qui la composent sont rudimentaires et proviennent d’études réalisées pour la plupart dans la première moitié du xxe siècle, à l’aide de simples coupes histologiques. Ainsi, bien que des malformations de la tête existent chez environ un tiers des bébés présentant des anomalies congénitales, les mécanismes qui contrôlent le développement de la tête humaine sont encore mal compris.
Une équipe de recherche dirigée par Alain Chédotal, directeur de recherche Inserm à l’Institut de la vision (Inserm/CNRS/Sorbonne Université) et professeur au laboratoire MéLiS des Mécanismes en sciences intégratives du vivant (Inserm/CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/Hospices civils de Lyon), et par Yorick Gitton, chargé de recherche CNRS également à l’Institut de la vision, a utilisé une méthode de microscopie innovante pour apporter un nouvel éclairage sur le développement de la tête humaine.
La technologie mise en œuvre avait précédemment été utilisée chez l’embryon par l’équipe pour étudier le développement d’autres organes humains[1]. Elle est appelée transparisation car elle permet de rendre les organes transparents à la lumière. L’échantillon transparisé est ensuite imagé en 3D à l’aide d’un microscope spécial qui scanne avec une fine feuille de lumière laser. Ceci permet de localiser in situ les cellules qui constituent les tissus embryonnaires.
Les chercheuses et chercheurs sont parvenus à appliquer cette technique à des embryons à différents stades de développement, issus de la biobanque de tissus humains constituée dans le cadre du programme HuDeCA (Human Developmental Cell Atlas) coordonné par l’Inserm[2]. Grâce aux clichés obtenus, ils sont ainsi parvenus à dresser la première carte tridimensionnelle de la tête humaine embryonnaire[3].
Dans un second temps, l’équipe de recherche a utilisé la réalité virtuelle pour analyser les images 3D et « naviguer » ainsi virtuellement dans les embryons.
« Cela nous a permis de découvrir des caractéristiques jusqu’alors inconnues du développement des muscles, des nerfs et des vaisseaux sanguins crâniens, du crâne et des glandes exocrines crâniennes, indique Alain Chédotal. Par exemple, les tout premiers stades de développement des glandes salivaires et lacrymales n’avaient jamais pu être étudiés chez l’être humain. Nos travaux nous ont permis de commencer à visualiser et à mieux comprendre les mécanismes à l’origine de la mise en place de ces structures extrêmement complexes anatomiquement », ajoute-t-il.

Image 3D obtenue en microscope à feuillet de lumière d’un œil d’embryon humain transparisé de 12 semaines. Les 6 muscles oculomoteurs responsables des mouvements des yeux et les 3 nerfs moteurs (en blanc, vert et rouge), ont été colorisés à l’aide d’un logiciel de réalité virtuelle. ©Raphael Blain/Alain Chédotal, Institut de la Vision (Inserm/CNRS/Sorbonne Université)
Les scientifiques ont également mis en place une interface web (Hudeca.com) permettant non seulement d’accéder aux images obtenues dans ces travaux, mais également à des modèles pour l’impression 3D et à des reconstructions 3D interactives d’embryons humains. Cette plateforme fournit ainsi de précieuses ressources qui pourront également contribuer à la formation des étudiants en médecine.
Dans de prochains travaux, l’équipe de recherche va tenter de cartographier toutes les cellules de certains organes, comme la rétine.
« À ce stade, c’est un peu comme si nous avions cartographié les continents et les pays mais qu’il nous restait à positionner les villes et les habitants », explique Alain Chédotal, dont l’équipe va aussi collaborer avec des médecins pour appliquer la technologie à des prélèvements pathologiques.
« Les nouvelles connaissances sur l’embryologie humaine apportées par ces travaux, ainsi que les nouveaux outils qui y sont développés, ont des implications importantes pour la compréhension des malformations cranio-faciales et des troubles neurologiques, ainsi que pour l’amélioration des stratégies diagnostiques et thérapeutiques », conclut le chercheur.
[1] Voir à ce sujet notre communiqué de presse du 23 mars 2017 : https://presse.inserm.fr/lembryon-humain-comme-vous-ne-lavez-jamais-vu/27807/
[2] Lancé en 2019, le programme transversal HuDeCa porté par l’Inserm a pour objectif de construire le premier atlas des cellules de l’embryon et du fœtus humain. Il ambitionne également la structuration de la recherche en embryologie humaine au niveau français et le développement des bases de données. À plus long terme, ce programme devrait servir de fondement à la compréhension de l’origine des maladies chroniques ou des malformations congénitales.
[3] À l’exception spécifique du cerveau, qui n’est pas une structure étudiée dans ces travaux.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Meilleure compréhension de la maladie dâAlzheimer : une étude confirme lâintérêt de la caféine comme piste de traitement |
|
|
| |
|
| |
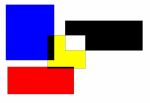
Meilleure compréhension de la maladie d’Alzheimer : une étude confirme l’intérêt de la caféine comme piste de traitement
05 Juil 2024 | Par Inserm (Salle de presse) | Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie

Image illustrant l’augmentation neuronale du récepteur A2A (en rouge) dans l’hippocampe de souris. On observe en bleu les noyaux de cellules (marqueur DAPI). © Émilie Faivre
En France, 900 000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre maladie apparentée. Le risque de développer la maladie d’Alzheimer dépend de facteurs génétiques et environnementaux. Parmi ces derniers, différentes études épidémiologiques suggèrent qu’une consommation régulière et modérée de caféine ralentit le déclin cognitif lié au vieillissement et le risque de développer la maladie d’Alzheimer. Dans une nouvelle étude[1], des chercheurs et des chercheuses de l’Inserm, du CHU de Lille et de l’Université de Lille, au sein du centre de recherche Lille Neuroscience et cognition, ont fait un pas de plus dans la compréhension des mécanismes qui sous-tendent le développement de la maladie d’Alzheimer. Ils viennent de mettre en évidence que l’augmentation pathologique de certains récepteurs dans les neurones au moment du développement de la maladie favorise la perte des synapses, et de fait, le développement précoce des troubles de la mémoire dans un modèle animal de la maladie. Leurs résultats permettent aussi de confirmer l’intérêt de conduire des essais cliniques pour mesurer les effets de la caféine sur le cerveau de patients à un stade précoce de la pathologie. Ils sont publiés dans la revue Brain.
La maladie d’Alzheimer est caractérisée par des troubles de la mémoire, des fonctions exécutives et de l’orientation dans le temps et dans l’espace. Elle résulte d’une lente dégénérescence des neurones, débutant au niveau de l’hippocampe (une structure cérébrale essentielle pour la mémoire) puis s’étendant au reste du cerveau. Les patients atteints par cette pathologie présentent deux types de lésions microscopiques au niveau de leur cerveau : les plaques séniles (ou plaques amyloïdes) et les dégénérescences neurofibrillaires (ou pathologie Tau), participant au dysfonctionnement des neurones et à leur disparition[2].
Des travaux avaient déjà montré que l’expression de certains récepteurs, appelés A2A, étaient retrouvés augmentés dans le cerveau de patients atteints de la maladie d’Alzheimer au niveau de l’hippocampe. Cependant, l’impact de la dérégulation de ces récepteurs sur le développement de la maladie et des troubles cognitifs associés demeurait méconnu jusqu’ici. Dans une nouvelle étude, une équipe de recherche dirigée par le chercheur Inserm David Blum s’est intéressée à cette question.
Les scientifiques ont réussi à reproduire une augmentation précoce[3] de l’expression des récepteurs adénosinergiques A2A, telle qu’observée dans le cerveau des patients, dans un modèle murin de la maladie d’Alzheimer qui développe des plaques amyloïdes. L’objectif était d’évaluer les conséquences de cette augmentation sur la maladie et de décrire les mécanismes en jeu.
Les résultats de leur recherche montrent que l’augmentation en récepteurs A2A favorise la perte des synapses[4] dans l’hippocampe des « souris Alzheimer ». Ceci a pour effet le déclenchement précoce des troubles de la mémoire chez les animaux. Les scientifiques ont ensuite montré qu’un dysfonctionnement de certaines cellules du cerveau, les cellules microgliales, en partie responsables de l’inflammation cérébrale observée dans la maladie, pourraient être impliquées dans la perte des synapses, en réponse à une augmentation en récepteurs A2A.
Des mécanismes similaires avaient déjà précédemment été décrits par l’équipe, cette fois-ci dans un autre modèle de la maladie développant les lésions Tau[5].
« Ces résultats suggèrent que l’augmentation d’expression des récepteurs A2A modifie la relation entre les neurones et les cellules microgliales. Cette altération pourrait être à l’origine d’une escalade d’effets entraînant le développement des troubles de la mémoire observés », explique Émilie Faivre, co-dernière autrice de l’étude, chercheuse au sein centre de recherche Lille Neuroscience et Cognition (Inserm/Université de Lille/CHU de Lille).
La caféine : une piste de traitement intéressante pour prévenir précocement le déclin cognitif ?
Plusieurs études ont déjà suggéré qu’une consommation régulière et modérée de caféine (ce qui correspond à une consommation de 2 à 4 tasses de café par jour) pouvait ralentir le déclin cognitif lié au vieillissement et le risque de développer la maladie d’Alzheimer.
En 2016, la même équipe de recherche avait décrit un des mécanismes par lequel la caféine pouvait avoir cette action bénéfique chez l’animal, réduisant les troubles cognitifs associés à la maladie d’Alzheimer. Les scientifiques avaient alors montré que les effets de la caféine étaient liés à sa capacité de bloquer l’activité des récepteurs adénosinergiques A2A, ces mêmes récepteurs dont l’expression se trouvent anormalement augmentée dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer[6].
« En décrivant, dans notre nouvelle étude, le mécanisme par lequel l’augmentation pathologique de l’expression des récepteurs A2A entraîne une cascade d’effets conduisant à une aggravation des troubles de la mémoire, nous confirmons l’intérêt de pistes thérapeutiques qui pourraient agir sur cette cible. Nous mettons donc encore une fois en avant l’intérêt de tester la caféine dans le cadre d’un essai clinique sur des patients atteints de formes précoces de la maladie. En effet, on peut imaginer qu’en bloquant ces récepteurs A2A, dont l’activité est augmentée chez le patient, cette molécule puisse prévenir le développement des troubles de la mémoire voire d’autres symptômes cognitifs et comportementaux », poursuit David Blum, directeur de recherche à l’Inserm, co-dernier auteur de l’étude.
Un essai clinique de phase 3[7], porté par le CHU de Lille, est actuellement en cours. Son objectif est d’évaluer l’effet de la caféine sur les fonctions cognitives de patients atteints de formes précoces à modérées de la maladie d’Alzheimer.
[1]Ces travaux ont fait l’objet d’un soutien de la Fondation Alzheimer, de la FRM, de l’ANR, du CoEN (LICEND), de l’Inserm, de l’Université de Lille, du CHU de Lille et du labEx Distalz (Development of Innovative Strategies for a Transdisciplinary Approach to Alzheimer’s Disease) dans le cadre des investissements d’avenir.
[2] Lire le dossier sur la maladie d’Alzheimer et consulter la BD Inserm qui explique de façon graphique les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans le développement de la maladie.
[3] A un stade au cours duquel normalement les animaux ne souffrent pas encore de troubles de la mémoire.
[4] Zones qui permettent la transmission des informations entre les neurones.
[5] Exacerbation of C1q dysregulation, synaptic loss and memory deficits in tau pathology linked to neuronal adenosine A2A receptor, Brain, Volume 142, Issue 11, November 2019, Pages 3636–3654, https://doi.org/10.1093/brain/awz288
[6] Lire le communiqué de presse
[7] L’essai clinique CAFCA de phase 3 est conduit par le neurologue Thibaud Lebouvier, en lien avec le laboratoire LilNCog et le Centre Mémoire du CHU de Lille. https://www.cafca-alzheimer.fr/
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
