|
| |
|
|
 |
|
Comment détecte-t-on le danger ? |
|
|
| |
|
| |
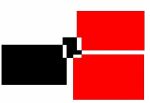
Comment détecte-t-on le danger ?
| 23 MARS 2018 - 11H16 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Les êtres vivants sont capables d’intégrer et d’identifier les informations sensorielles pertinentes telles que les odeurs, les sons ou la lumière afin de réguler leurs réponses comportementales en présence d’un danger potentiel. C’est ce qu’on appelle la discrimination contextuelle. Des chercheurs de l’Inserm basés au Neurocentre Magendie de Bordeaux, viennent de découvrir quels sont les neurones impliqués dans ce phénomène et où ils se situent. Une bonne nouvelle pour les personnes souffrant de stress post traumatique chez qui cette discrimination contextuelle est déréglée. Ces travaux sont publiés dans la revue Neuron
Vivre des expériences traumatisantes comme une catastrophe naturelle, une attaque terroriste, ou un combat militaire, sont des événements qui peuvent mener au développement de troubles psychiatriques, comme l’état de stress post-traumatique (PTSD). Quand ces personnes se trouvent confrontées à un environnement semblable à celui dans lequel l’évènement traumatisant est arrivé, elles revivent avec la même intensité les stress du trauma original. Chez ces patients, les troubles anxieux sont associés à une généralisation contextuelle. Ils sont effectivement devenus incapables d’intégrer et d’identifier les informations sensorielles pertinentes issues de leurs cinq sens- captées dans l’environnement- afin de réguler les réponses comportementales. Les circuits neuronaux impliqués dans ce phénomène sont inconnus.
Une équipe de chercheurs dirigée par le Dr. Cyril Herry vient d’identifier pour la première fois chez la souris une population de neurones impliqués dans la discrimination contextuelle. Ces neurones sont situés dans le cortex préfrontal médial.
Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé notamment des approches optogénétiques (voir encadré) qui permettent d’activer ou d’inhiber l’activité de populations de neurones afin de déterminer leur implication dans un comportement particulier. Afin d’évaluer les circuits neuronaux jouant un rôle dans la discrimination contextuelle, les chercheurs ont exposé des souris à un contexte composé de différents éléments sensoriels (lumière, odeur, son) dans lequel elles ont reçu un ou plusieurs chocs électriques légers afin de rendre ce contexte aversif.
Dans une deuxième étape, les souris étaient exposées au même contexte mais sans les éléments sensoriels pertinents (odeur, son, lumière) leur faisant croire à un contexte non aversif. Grâce à des enregistrements en temps réel de l’activité des neurones du cortex préfrontal médian et leur manipulation optogénétique, les chercheurs ont pu identifier une population de neurones spécifiquement activée pendant la discrimination contextuelle.
Ces travaux démontrent que l’activité neuronale dans cette zone particulière du cerveau, qu’est le cortex préfrontal médian, est un élément clé de la discrimination contextuelle. Les chercheurs ont en outre démontré que ce groupe de neurones projette spécifiquement sur le tronc cérébral, une zone du cerveau directement impliquée dans la régulation motrice des comportements émotionnels.
” Ces travaux qui améliorent notre compréhension de l’activité neuronale menant à la discrimination contextuelle pourrait contribuer au développement de traitements et de thérapies pour les personnes souffrant de troubles anxieux” estime le Dr. Cyril Herry, directeur de recherche à l’Inserm et investigateur de ce travail.”
L’optogénétique consiste à introduire dans les neurones des protéines photosensibles naturelles, comme la channelrhodopsine, extraite d’une algue qui est une protéine sensible à la lumière bleue ou l’archaerhodopsine sensible à la lumière verte ou jaune. Lorsque la lumière bleue est introduite dans le cerveau de la souris par une fibre optique, l’activation de la channelrhodopsine génère un courant dépolarisant : cela revient à activer les neurones. En revanche, si l’archaerhodopsine est activée par une lumière verte ou jaune, cela génère un courant hyperpolarisant et les neurones sont inhibés. Ces protéines photosensibles exprimées au niveau de la membrane neuronale sont donc capables d’activer ou d’inhiber l’influx nerveux à volonté. Cela permet aux chercheurs d’identifier des réseaux neuronaux impliqués dans une tâche particulière et d’en définir le rôle causal.
DOCUMENT inserm.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Exposition prénatale aux perturbateurs endocriniens et troubles du comportement des enfants |
|
|
| |
|
| |
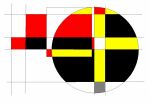
Exposition prénatale aux perturbateurs endocriniens et troubles du comportement des enfants
COMMUNIQUÉ | 29 SEPT. 2017 - 10H22 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
SANTÉ PUBLIQUE
Une étude épidémiologique menée par l’Inserm[1] sur les familles de la cohorte EDEN (500 garçons nés entre 2003 et 2006 et leurs mères) montre que l’exposition pendant la grossesse à certains phénols et phtalates est associée à des troubles du comportement des garçons entre 3 et 5 ans. Les composés les plus préoccupants à cet égard sont le bisphénol A, le triclosan et le di-n-butyl phtalate, ou DBP. Les résultats viennent d’être publiés dans la revue Environmental Health Perspectives.
Le bisphénol A a été interdit de tous les contenants alimentaires en France en janvier 2015, une date ultérieure à la réalisation de cette étude. Le triclosan est un agent antibactérien retrouvé dans certains dentifrices et savons ; le DBP est utilisé comme plastifiant dans les plastiques de type PVC, certaines colles, vernis à ongles et laques pour les cheveux. Triclosan et DBP sont réglementés selon la logique d’une valeur limite dans certaines familles de produits, tout en étant interdits dans d’autres (le DBP est par exemple interdit d’usage dans les cosmétiques et le triclosan dans les habits dans l’UE). Des études toxicologiques in vitro et chez l’animal ont mis en évidence que ces composés étaient des perturbateurs endocriniens et pouvaient interagir avec des systèmes hormonaux impliqués dans le développement normal du système nerveux central. Les mécanismes précis qui pourraient expliquer un effet des perturbateurs endocriniens sur le neurodéveloppement et le comportement pourraient passer par une altération du fonctionnement des hormones thyroïdiennes, des hormones stéroïdiennes, comme l’œstrogène, ou d’autres hormones, comme l’ocytocine ou la vasopressine, des hormones sécrétées par l’hypothalamus.
Face à ces premières conclusions chez l’animal, les chercheurs ont souhaité étudier l’association entre les expositions aux perturbateurs endocriniens pendant la grossesse et le comportement ultérieur des enfants.
L’étude a porté sur 529 petits garçons de la cohorte mère-enfant EDEN, mise en place par l’Inserm. Les femmes enceintes participant à cette cohorte ont été recrutées entre 2003 et 2006 dans les CHU de Nancy et Poitiers. Aux troisième et cinquième anniversaires de l’enfant, ces mamans ont rempli un questionnaire standardisé évaluant certains aspects du comportement de leur enfant tel que l’hyperactivité, les troubles émotionnels et les troubles relationnels. Ce questionnaire standardisé, utilisé depuis une vingtaine d’années, intitulé « Questionnaire des forces et difficultés » de l’enfant, permet d’établir un score dans différentes dimensions du comportement tels que les symptômes émotionnels, les problèmes de relation avec les pairs, les problèmes de conduite, d’hyperactivité et d’inattention. Un échantillon d’urine prélevé durant la grossesse a permis le dosage de biomarqueurs caractéristique de l’exposition aux phénols et aux phtalates dans le Laboratoire de Santé Environnementale des CDC d’Atlanta, qui est en charge des campagnes de biosurveillance américaines.
De 70 à 100% des femmes de la cohorte Eden, recrutées durant leur grossesse entre 2003 et 2006, étaient alors exposées à des niveaux détectables de différentes substances. Les niveaux urinaires étaient de l’ordre de 1 à 3 µg par litre pour le bisphénol A, de 10 à 100 µg par litre pour le triclosan, et de 50 à 200 pour le méthylparabène. Les résultats suggèrent que l’exposition maternelle à certains phénols et phtalates est associée à des troubles du comportement des petits garçons.
L’exposition au bisphénol A était associé à une augmentation des troubles relationnels à 3 ans et des comportements de type hyperactif à 5 ans. Les chercheurs notent que ce travail confirme ainsi que les effets du bisphénol A sur le comportement observés chez l’animal de laboratoire se retrouvent chez l’humain à des expositions faibles, probablement inférieures à celles préconisées par l’autorité européenne de sécurité alimentaire, l’EFSA.
Le métabolite du DBP était lui associé à davantage de troubles émotionnels et relationnels, incluant les comportements de repli, à 3 ans, mais pas à 5 pour les troubles émotionnels. Des associations entre ces composés et le comportement avaient déjà été mis en évidence dans des études précédentes chez de jeunes garçons et chez l’animal. Ainsi, dans une étude réalisée à partir de femmes et d’enfants new-yorkais, une augmentation des comportements de repli chez les enfants de 3 ans avec des niveaux croissants du métabolite du DBP avaient été rapportés en 2012.
Les résultats de cette étude ont aussi montré une association entre le triclosan et une augmentation des troubles émotionnels à 3 et 5 ans. Il s’agit de la première étude évaluant les effets de ce composé sur le comportement, pour lequel l’équipe d’épidémiologie environnementale de Grenoble avait déjà mis en évidence une diminution du périmètre crânien à la naissance, dans cette même population. Au niveau moléculaire, le triclosan est capable d’interagir avec l’axe thyroïdien qui, pendant la grossesse, est impliqué dans le développement du cerveau du fœtus.
L’effectif de l’étude, qui est une des plus vaste sur la question, ne permettait pas d’étudier directement la survenue de pathologies du comportement comme les troubles du spectre autistique, ce qui impliquerait de suivre des dizaines de milliers d’enfants.
Les équipes de recherche vont désormais s’attacher à répliquer ces résultats au sein de la cohorte mère-enfant SEPAGES en cours dans la région Grenobloise, coordonnée par l’Inserm et soutenue par l’European Research Council. Dans cette dernière, de nombreux échantillons d’urine par participant sont recueillis durant la grossesse et les premières années de vie de l’enfant. Cette approche permettra de limiter les erreurs de mesure de l’exposition et d’identifier de potentielles périodes de sensibilité aux phénols et phtalates sur différents événements de santé tels que la croissance, le comportement ou la santé respiratoire. Cela permettra aussi d’étudier l’effet éventuel de ces substances chez les petites filles, qui n’avaient pu être considérées ici. Il est possible que leur sensibilité aux perturbateurs endocriniens diffère de celle des garçons.
[1] Un consortium de recherche associant des équipes de recherche Inserm, les CHU de Nancy et Poitiers, le Center for Disease Controls and Prevention (CDC, Atlanta, USA), et coordonné par l’équipe d’épidémiologie environnementale de l’Institut pour l’Avancée des Biosciences (Inserm/CNRS/Université Grenoble Alpes).
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
ALZHEIMER |
|
|
| |
|
| |

Alzheimer (maladie d’)
Sous titre
Une maladie neurodégénérative complexe mais de mieux en mieux comprise
La maladie d’Alzheimer résulte d’une lente dégénérescence des neurones, débutant au niveau de l’hippocampe (une structure cérébrale essentielle pour la mémoire) puis s’étendant au reste du cerveau. Elle est caractérisée par des troubles de la mémoire récente, des fonctions exécutives
fonctions exécutives
Ensemble de processus cognitifs (raisonnement, planification, résolution de problèmes…) qui nous permettent de nous adapter au contexte, aux situations nouvelles.
et de l’orientation dans le temps et l’espace. Le malade perd progressivement ses facultés cognitives et son autonomie.
On ne sait pas encore guérir cette maladie, mais notre connaissance de ses facteurs de risque et de ses mécanismes évolue de façon spectaculaire depuis quelques années.
Dossier réalisé en collaboration avec David Blum (directeur de recherche Inserm, équipe Alzheimer et tauopathies, Centre de recherche Jean Pierre Aubert, unité 1172 Inserm/Université de Lille), Luc Buée (directeur du Centre de recherches Jean-Pierre Aubert) et Florence Pasquier (PU-PH en neurologie, responsable CMRR et directrice du Centre d’excellence maladies neurodégénératives de Lille LiCEND)
Comprendre la maladie d’Alzheimer
Rare avant 65 ans, la maladie d’Alzheimer se manifeste d’abord par des pertes de mémoires, suivies au cours des années par des troubles cognitifs plus généraux et handicapants.
Parmi les cas survenant chez les moins de 65 ans, 10% concernent des personnes atteintes de formes familiales héréditaires rares de la maladie. Après cet âge, la fréquence de la maladie s’élève à 2 à 4% de la population générale. Elle augmente rapidement pour atteindre 15% de la population à 80 ans. Ainsi, environ 900 000 personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer aujourd'hui en France. Elles devraient être 1,3 million en 2020, compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie.
Les femmes âgées semblent plus exposées puisque, sur 25 malades, 10 sont des hommes et 15 des femmes, mais cette différence pourrait être liée aux écarts d’espérance de vie.
De la perte de mémoire à la dépendance
* Le trouble de la mémoire est le plus fréquent et le plus perceptible des symptômes associés à la maladie d'Alzheimer.
* Des troubles des fonctions exécutives (programmation, séquence de réalisation d’un but… ) sont également très évocateurs : par exemple ne plus savoir comment se servir de son téléphone ou comment préparer une recette jusque-là bien connue.
* Les problèmes d’orientation dans le temps et dans l’espace sont également révélateurs : les personnes qui développent la maladie se perdent sur un trajet habituel ou ne savent plus se situer dans le temps.
* Plus rarement, des troubles du langage ou de la vision élaborée (lecture, repérage des objets…) peuvent s'observer au début de la maladie.
L’extension de la maladie se traduit par des troubles progressifs du langage oral (aphasie) et écrit (dysorthographie), du mouvement (apraxie), du comportement et de l’humeur (anxiété, dépression irritabilité) et du sommeil (insomnie).
Il faut cependant souligner que cette progression n’est ni unique, ni forcément catastrophique : tous les patients ne présentent pas le même tableau clinique, ne vivent pas la même évolution, ni ne souffrent du même handicap. On peut bien souvent longtemps continuer à avoir une vie sociale, intellectuelle et affective avec la maladie d’Alzheimer...
Trous de mémoire : consultez !
Tout un chacun a parfois des trous de mémoire. Toutefois, lorsque des oublis inhabituels préoccupent une personne (ou son entourage) et la gênent dans sa vie quotidienne au point de ressentir le besoin d’en parler à un médecin (généraliste, neurologue, gériatre ou psychiatre), la plainte doit être prise très au sérieux et faire l’objet d’une évaluation précise. La France a créé un réseau de "centres mémoire" hautement spécialisés dans le diagnostic de ces affections, comptant plus de 400 sites de consultation répartis sur le territoire.
Un mécanisme identifié, mais…
Examiné après leur décès, le cerveau des patients atteints de maladie d’Alzheimer porte deux types de lésions : les dépôts amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires. Chacune de ces lésions est associée à une protéine : le peptide ß-amyloïde pour les dépôts amyloïdes, et la protéine tau phosphorylée pour les dégénérescences neurofibrillaires.
La protéine ß-amyloïde, naturellement présente dans le cerveau, s’accumule au cours des années sous l’influence de différents facteurs génétiques et environnementaux. Elle finit par former des dépôts amyloïdes, aussi appelées "plaques séniles". Selon l’hypothèse de la "cascade amyloïde", l’accumulation de ce peptide
peptide
Enchaînement d’acides aminés. L’assemblage de plusieurs peptides forme une protéine.
amyloïde induit une toxicité pour les cellules nerveuses, se traduisant par l’augmentation de la phosphorylation d’une protéine de structure des neurones, la protéine tau. La phosphorylation
phosphorylation
Composé d’une tête hydrophile et de deux queues hydrophobes, c’est un constituant essentiel des membranes cellulaires.
de la protéine tau entraîne à son tour une désorganisation de la structure des neurones et une dégénérescence dite "neurofibrillaire". A terme, cette dernière mène à la mort des cellules nerveuses. Très lent, ce processus prend plusieurs dizaines d’années à s’établir avant que des symptômes de la maladie n’apparaissent.
Formulée au début des années 1990, l’hypothèse de la cascade amyloïde reste valide mais elle s'est peu à peu étoffée et complexifiée avec les résultats de la recherche. Par exemple, on considère aujourd’hui qu’une fois enclenchée, la dégénérescence neurofibrillaire (ou "maladie tau") se propage à l’ensemble du cerveau indépendamment du peptide amyloïde. De même, on sait maintenant qu'il existe aussi dans le cerveau une réaction inflammatoire, semblant intervenir assez tôt dans le processus.
Plongez au cœur d'Alzheimer en BD !
Pour en savoir plus sur les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans le développement de la maladie d'Alzheimer, découvrez notre bande dessinée Plongée au cœur d'Alzheimer
Âge, génétique et environnement, le cocktail des facteurs de risque
Le principal facteur de risque de maladie d’Alzheimer est l’âge : l’incidence de la maladie augmente après 65 ans et explose après 80 ans.
L’environnement joue également un rôle important. Des facteurs de risque cardiovasculaires (diabète, hypertension, hyperlipidémie) non pris en charge à l’âge moyen de la vie sont par exemple associés à une survenue plus fréquente de la maladie, sans que l’on sache encore par quels mécanismes. La sédentarité est un autre facteur de risque, ainsi que les microtraumatismes crâniens constatés chez certains sportifs (comme les joueurs de de rugby ou les boxeurs) ou encore des anesthésies répétées.
À l’inverse, le fait d’avoir fait des études et d’avoir eu une activité professionnelle stimulante ainsi qu’une vie sociale active, semble retarder l’apparition des premiers symptômes et leur sévérité. Dans ces conditions, le cerveau bénéficierait d’une "réserve cognitive" qui permet de compenser, au moins pour un temps, la fonction des neurones perdus. Cet effet serait lié à la plasticité cérébrale, un phénomène qui traduit l’adaptabilité permanente de notre cerveau.
La susceptibilité individuelle à la maladie possède aussi une composante génétique, puisque le risque de développer la maladie est en moyenne multiplié par 1,5 si un parent du premier degré est touché, et par 2 si au moins deux le sont. Des études examinant l’ensemble du génome (dites "pangénomiques") ont mis en évidence certains gènes associés à un risque de survenue de la maladie. C’est notamment le cas du gène de l’apolipoprotéine E (APOE). Etre porteur d’une forme particulière de ce gène, l'allèle "epsilon 2", va réduire le risque de plus de la moitié. En revanche, la présence d’un allèle "epsilon 4" le multiplie par 3 ou 4, et les porteurs de deux copies de cet allèle (porteurs homozygotes) voient leur risque multiplié par 15. De nombreux allèles d’autres gènes modulent également le risque de développer la maladie et une combinaison d’allèles défavorables peut majorer le risque de développer la maladie.
Le cas particulier des formes héréditaires
Les formes héréditaires de la maladie d’Alzheimer représentent 1,5% à 2% des cas. Elles se déclarent presque toujours avant 65 ans, souvent autour de 45 ans. Dans la moitié de ces cas, des mutations rares à l’origine de la maladie ont pu être identifiées. Elles sont retrouvées au niveau de trois gènes : l’un code pour une protéine précurseur du peptide amyloïde (APP pour Amyloid Protein Precursor) et les deux autres pour les protéines préséniline 1 et préséniline 2, qui interviennent dans le métabolisme de l’APP. Hériter de mutations affectant un de ces gènes entraîne systématiquement l’apparition de la maladie (transmission autosomique dominante).
Prendre en charge, à temps
La maladie d’Alzheimer ne se guérit pas, mais une prise en charge adaptée peut ralentir sa progression et améliorer la vie du patient et de son entourage. Encore faut-il agir à temps…
D’abord détecter !
Une plainte sur des oublis répétés interférant avec la vie quotidienne doit alerter et être formalisée auprès d’un médecin : il est en effet essentiel de réaliser un diagnostic le plus tôt possible. Celui-ci repose tout d’abord sur l’histoire des troubles, puis sur des tests des fonctions cognitives. Ils permettent d’évaluer la nature et la sévérité des atteintes (perte de mémoire, orientation spatio-temporelle, fonctions d’exécution…) et la recherche de troubles du comportement et de l’humeur.
L’imagerie cérébrale contribue également au diagnostic, y compris à un stade précoce. L’IRM permet exclure d’autres causes et peut révéler des anomalies cérébrales associées à la maladie : une réduction du volume du cerveau, notamment des régions postérieures, et une atrophie de l’hippocampe constituent des arguments en faveur du diagnostic de maladie d'Alzheimer. L'utilisation de la TEP
TEP
Méthode d’imagerie médicale qui permet de mesurer en 3 dimensions l’activité métabolique d’un organe.
donne accès à d'autres régions cérébrales comme le carrefour temporo-pariéto-occipital et le précunéus.
Afin de renforcer le diagnostic, des marqueurs biologiques peuvent aider à confirmer l’origine des symptômes. Il est aujourd’hui possible de mesurer trois marqueurs de la maladie dans le liquide cérébrospinal (LCS), accessible grâce à une ponction lombaire : la protéine bêta amyloïde, la protéine tau et la protéine tau phosphorylée.
Ces examens permettre parfois d'évoquer le diagnostic d’autres pathologies dégénératives (dégénérescences frontotemporales, maladies à corps de Lewy …) ou vasculaires pouvant mimer la maladie d’Alzheimer.
Une signature pour Alzheimer
La prise en charge
Multidimensionnelle, la prise en charge de la maladie d’Alzheimer combine hygiène de vie, activités, traitement médicamenteux et dispositions médico-sociales, de l’accueil ponctuel de jour à l’hébergement permanent en institution. Pour les patients, mais aussi pour aider et soulager les aidants… Dans tous les cas, le mot clé de la prise en charge est "personnalisation" : au-delà du fait que chaque patient est unique par nature, tous ne présentent pas tous les mêmes symptômes, ni la même évolution de leur maladie.
Il est essentiel que le patient continue ses activités habituelles - cognitives et/ou physiques - et maintienne autant que possible une vie sociale. L’équilibre de l’alimentation est tout aussi important. Certains centres prônent une démarche plus active consistant à "stimuler" le patient en lui proposant des activités. Toutefois, lui proposer, voire lui imposer une activité qui ne l’a jamais intéressé avant sa maladie, ou qui le met en échec, ne peut qu’augmenter son stress. L’attention à la personnalité et au vécu du malade est donc essentielle.
Côté médicaments, quatre spécialités sont couramment prescrites. Trois d’entre elles - le donépézil (Aricept), la rivastigmine (Exelon) et la galantamine (Reminyl) - visent à augmenter la disponibilité cérébrale d’acétylcholine, un neurotransmetteur
neurotransmetteur
Petite molécule qui assure la transmission des messages d'un neurone à l'autre, au niveau des synapses.
qui facilite la communication entre les neurones, laquelle est amoindrie par la maladie. Ces médicaments bloquent l’action de l’acétylcholine estérase, l’enzyme qui dégrade le neurotransmetteur. La mémantine (Ebixa), pour sa part, va bloquer un récepteur au glutamate
glutamate
Neurotransmetteur excitateur le plus répandu dans le système nerveux central.
, une molécule qui endommage les neurones. Ce dernier traitement agit plutôt sur la composante "tau" de la maladie.
Ces médicaments souffrent d’un handicap à l’origine de leur récent déremboursement (lequel fait encore débat) : leur bénéfice n’est pas flagrant pour le patient et son entourage. En effet, ils n’améliorent pas l’état du malade : en général, ils ralentissent sa dégradation ou, au mieux, ils le stabilisent. Face à cela, certains effets secondaires désagréables, et le simple fait de prescrire une pilule supplémentaire à des personnes âgées souvent déjà sous traitement pour d’autres pathologies, peuvent faire reculer les proches et certains soignants. Des études à grande échelle prouvent pourtant sans conteste que l’arrêt de ces traitements diminue la durée de vie autonome des patients : se dégradant plus vite, ils entrent plus tôt en institution. Autrement dit, ces médicaments apportent un bénéfice social et individuel bien réel même si difficile à percevoir immédiatement pour l’entourage du malade. Même s'ils ne sont plus remboursés, ces médicaments restent abordables.
En revanche, il convient d’éviter les préparations pseudo-pharmaceutiques "purifiées" (caféine, curcuma ou autres extraits de plantes miracle), qui comportent un réel risque de contamination par des allergènes. Une alimentation équilibrée suffit à apporter à l’organisme du patient tous les micronutriments et antioxydants
antioxydants
Molécule qui capte les radicaux libres, des composés toxiques issus de la « respiration » des cellules.
dont il a besoin.
Les enjeux de la recherche
Comprendre les mécanismes
Les études génétiques révèlent sans cesse de nouveaux allèles, facteurs de risque de la maladie. Mais leurs effets individuels restent faible. Toutefois, en permettant de combiner "virtuellement" les effets de ces différents allèles, la bioinformatique devrait dans un futur proche aider à identifier les grandes voies biologiques impliquées dans la maladie d'Alzheimer. De telles approches font déjà apparaître le rôle de mécanismes insoupçonnés jusqu'ici, comme l’inflammation ou l’immunité.
De multiples hypothèses surgissent quant à l’origine de la maladie (traumatismes, rôle du sommeil, propagation de type prion...). Mais aucune piste n’a fourni d’indice mesurable pour l’instant, signe qu’il existe peut-être plusieurs causes aux troubles que l’on regroupe sous le terme de maladie d’Alzheimer…
Détecter
De nouveaux examens d’imagerie cérébrale ont récemment émergé. Utilisant la tomographie par émission de positons (TEP), ils permettent de "voir" les plaques amyloïdes
plaques amyloïdes
Agrégation extracellulaire pathologique de peptides ß-amyloïdes.
et les dégénérescences neurofibrillaires dans le cerveau d’une personne vivante (et non après sa mort par examen anatomopathologique). Pour cela, il a fallu développer des radiotraceurs injectables se liant spécifiquement au peptide bêta amyloïde puis, plus récemment, à la protéine tau. Ils rendent d’indéniables services en recherche, par exemple pour tester l’effet de candidats médicaments. Mais en l’absence de traitement validé, leur utilisation clinique ne présente pour l'instant que peu d’intérêt.
Développer un traitement
La piste la plus explorée actuellement pour développer un traitement contre la maladie d'Alzheimer est l’immunothérapie
immunothérapie
Traitement qui consiste à administrer des substances qui vont stimuler les défenses immunitaires de l’organisme, ou qui utilise des protéines produites par les cellules du système immunitaire (comme les immunoglobulines).
. Elle a d'abord était développée pour éliminer le peptide bêta amyloïde. Cette stratégie consiste à injecter des anticorps dirigés contre le peptide (immunothérapie passive) ou à vacciner le patient contre le peptide bêta amyloïde (immunothérapie active). Les résultats des premiers essais cliniques se sont révélés décevants : la plaque amyloïde régresse, certes, mais parfois au prix d’effets secondaires importants. De plus, les symptômes cliniques demeurent, et la dégénérescence neurofibrillaire continue sa progression. Cependant, d’autres anticorps
anticorps
Protéine du système immunitaire, capable de reconnaître une autre molécule afin de faciliter son élimination.
anti-amyloïde plus performants sont actuellement en cours de test. En outre, puisque la suppression des plaques amyloïdes ne suffit pas à elle seule à stopper la progression de la maladie, de très nombreux essais d'immunothérapie ciblent aujourd’hui la protéine tau.
D'autres approches sont également développée, comme l’utilisation de plusieurs petites molécules thérapeutiques plus classiques, tels des dérivés du bleu de méthylène (qui désagrègent les filaments de tau) ou les inhibiteurs de secrétases (qui empêchent la formation du peptide bêta amyloïde).
En résumé : une multitude d’essais cliniques, peu de résultats nets aujourd'hui. Il reste néanmoins essentiel que des patients continuent à participer à ces études, ce qui n’interrompt pas leur traitement habituel.
La recherche s’oriente est vers un traitement très précoce, avant les symptômes de la maladie pour éviter qu’elle ne se déclare, les lésions précédant de plusieurs années les symptômes.
Le Plan maladies neurodégénératives (2014-2019)
Le quatrième plan national dédié à Alzheimer et aux maladies apparentées, mais aussi aux autres pathologies dégénératives notamment motrices, comporte 4 axes stratégiques :
* soigner et accompagner sur l’ensemble du territoire
* favoriser l’adaptation de la société aux enjeux des MND
* développer et coordonner la recherche
* rendre effective la démocratie sanitaire
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
De nouveaux antibiotiques mis au point par un laboratoire de lâInserm et lâUniversité de Rennes 1 |
|
|
| |
|
| |
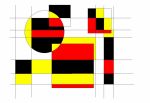
De nouveaux antibiotiques mis au point par un laboratoire de l’Inserm et l’Université de Rennes 1
COMMUNIQUÉ | 09 JUIL. 2019 - 20H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION, INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE
Culture de bactéries dans une boite de Pétri© Inserm/Latron, Patrice
Non seulement ils sont efficaces contre les bactéries multi-résistantes à Gram positif et négatif mais, de surcroît, ils ne semblent pas déclencher de résistances lors de leur utilisation pour traiter des souris infectées: voici la double promesse de deux nouveaux antibiotiques créés par le Pr Brice Felden et son équipe du laboratoire Inserm-Université de Rennes 1 U1230 ‘ARN régulateurs bactériens et médecine’, avec une équipe de l’Institut des sciences chimiques de Rennes (ISCR). Cette avancée française pourrait apporter un nouveau souffle ainsi que de nouvelles possibilités pour lutter contre l’antibiorésistance mondiale. Le détail de ces travaux est publié le 9 juillet dans la revue scientifique Plos Biology.
Les antibiotiques ont sauvé tant de vies depuis un siècle d’utilisation chez l’humain qu’ils sont considérés comme une avancée majeure en médecine contemporaine. Malheureusement, une augmentation croissante des résistances aux traitements les rend progressivement inefficaces. Si cette tendance se généralisait, les conséquences pour la santé publique seraient catastrophiques. Les nouveaux antibiotiques mis sur le marché sont peu nombreux et se résument à des dérivés de classes existantes, les ‘me-too drugs’.
Des chercheurs de l’Inserm et de l’université de Rennes 1 ont récemment identifié une nouvelle toxine bactérienne et l’ont transformée en antibiotiques puissants et actifs contre différentes bactéries responsables d’infections humaines, tant à Gram positif que négatif.
« Tout est parti d’une découverte fondamentale en 2011 », explique Brice Felden, directeur du laboratoire ‘ARN régulateurs bactériens et médecine’ de Rennes. « Nous nous sommes rendu compte qu’une toxine fabriquée par les staphylocoques dorés dont le rôle était de faciliter l’infection était également capable de tuer d’autres bactéries présentes dans notre organisme. Nous avions ainsi identifié une molécule qui possédait une double activité toxique et antibiotique. Nous nous sommes dit que si nous arrivions à dissocier ces 2 activités, nous serions capables de créer un nouvel antibiotique dépourvu de toxicité sur notre organisme. Restait à relever ce challenge ».
En collaboration avec l’équipe de Michèle Baudy Floc’h, chimiste au sein de l’ISCR, une nouvelle famille de « peptidomimétiques » a été synthétisée. Comme leur nom l’indique, ces peptides sont inspirés du peptide bactérien naturel initial mais ont été raccourcis et modifiés. Sur la vingtaine de molécules créées, deux se sont avérées efficaces contre le Staphylocoque doré et les Pseudomonas aeruginosa résistants sur des modèles murins atteints de sepsis sévères ou d’infections cutanées. De plus, aucune toxicité sur les autres cellules et organes, que ce soit chez l’animal ou sur des cellules humaines n’a été observée. Ces nouveaux composés sont bien tolérés à leurs doses actives et même au-delà, et sont dépourvus de toxicité rénale, problèmes souvent rencontrés avec ce type de composés. « Nous les avons testés à des doses 10 à 50 fois supérieures à la dose efficace sans observer de toxicité » précise Brice Felden qui raconte par ailleurs « qu’il a fallu la contribution et l’imagination de l’équipe et de nos collaborateurs chimistes pour concevoir les molécules les plus actives possibles».
Peu d’antibio-résistance identifiée en conditions expérimentales
Fait important, les bactéries que les chercheurs ont laissées en contact pendant plusieurs jours chez l’animal avec ces antibiotiques n’ont pas montré de signes de résistances. Afin d’aller plus loin, les chercheurs ont créé des conditions favorables au développement de résistances in vitro et in vivo. Et rien ne s’est déclaré. La prudence reste encore de mise sur ce point car l’expérience a été réalisée sur des temps cours,j’usquà 15 jours.
L’activité antibactérienne de ces peptidomimétiques est, en partie, due à la capacité de ses acides aminés non naturels à renforcer l’association de ces composés avec les membranes des bactéries infectieuses. Cette forte liaison induit une perméabilité de la membrane et entraîne la mort des bactéries. « Nous pensons que ces nouvelles molécules représentent des candidats prometteurs au développement de nouveaux antibiotiques, pouvant apporter des traitements alternatifs à la résistance aux antimicrobiens ».
La prochaine étape consiste à démarrer les essais cliniques de phase I chez l’humain. Le brevet vient d’être licencié et une start-up vient d’être créée.
Pour voir ces explications en vidéo : http://bit.ly/video-antibio
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
