|
| |
|
|
 |
|
Croissance et troubles de la croissance |
|
|
| |
|
| |

Croissance et troubles de la croissance
Sous titre
Grandir, une histoire d’hormones mais pas seulement
La croissance est un phénomène éminemment complexe, influencé à la fois par la génétique, l’environnement et les interactions entre ces deux facteurs. Les mécanismes n’en sont pas tous connus, mais les chercheurs espèrent en savoir davantage dans les années qui viennent, grâce à l’apport de la génétique, de l’épigénétique et des -omiques
-omiques
Ce suffixe correspond aux technologies qui permettent d’étudier un grand nombre de données, tel que le séquençage du génome à grande échelle ('génomique').
Dossier réalisé en collaboration avec Yves Le Bouc et Irène Netchine, médecins, praticiens hospitaliers en explorations fonctionnelles endocriniennes pédiatriques (Hôpital Trousseau, Paris), directeurs de l’équipe Système IGF et croissance foetale et post-natale au Centre de recherche Saint-Antoine (unité 938 Inserm/UPMC), Paris
Comprendre la croissance et ses troubles
Une taille adulte est considérée comme "normale" lorsqu'elle correspond à celle atteinte par 95 % de la population, c'est-à-dire entre 162 cm et 190 cm pour un homme (176 cm en moyenne) et entre 152 cm et 177 cm pour une femme (164 cm en moyenne).
Des courbes de croissance, une pour les filles et une autre pour les garçons, permettent de vérifier qu’un enfant grandit normalement et atteint cette taille cible. Elles ont été mises à jour en 2018, grâce au recueil et à l'analyse d'environ 5 000 000 de mesures de poids, de taille ou de périmètres crâniens, provenant de 261 000 enfants âgés de 0 à 18 ans. Ces courbes sont en réalité des "couloirs", délimités par des lignes qui représentent les tailles extrêmes, observées chez 2,5 % des enfants qui se situent au-dessus de la ligne supérieure et 2,5 % des enfants au-dessous de la ligne inférieure.
On considère qu'un enfant présente un trouble de la croissance lorsque sa taille est inférieure à la limite basse de la courbe de référence. Néanmoins, celui-ci peut être ponctuel : un suivi très régulier permet de voir si un rattrapage s’effectue dans les mois qui suivent. Par exemple, 90 % des enfants qui naissent avec un retard de croissance intra-utérin rattrapent la taille normale des enfants de leur âge au bout d’un ou deux ans. La courbe de croissance permet aussi de mettre en évidence certains troubles de la croissance qui se manifestent plus tardivement par un ralentissement, puis une stagnation de la croissance.
Le suivi idéal consiste à mesurer (et peser) son enfant tous les 3 mois jusqu'à 1 an, puis tous les 6 mois jusqu'à 4 ans, puis chaque année afin de vérifier que sa taille s’inscrit bien dans le "couloir" de la courbe de référence et qu’elle suit une progression régulière.
La taille définitive, une affaire partiellement génétique
Le patrimoine génétique d’une personne a une influence sur sa taille définitive. Les scandinaves sont par exemple en moyenne plus grands que les méditerranéens. Cette différence se maintient chez les personnes atteintes d’une même maladie affectant la croissance. Néanmoins de très nombreux facteurs interfèrent avec l’effet des gènes : l’environnement, la santé globale de l'enfant, le moment de la puberté et l’alimentation peuvent contrebalancer les effets de la génétique.
Une croissance par "à coups"
La croissance post-natale est très rapide. La taille des enfants passe en moyenne de 50 cm à la naissance à 75 cm au bout de la première année, puis elle atteint généralement 100 cm à l'âge de quatre ans. Ce rythme décélère ensuite, avec un gain de taille d’environ 5 à 6 cm par an jusqu'à la puberté. Jusqu'à ce moment-là, garçons et filles grandissent de la même façon. L’écart se creuse après.
Chez les filles, un pic de croissance survient au début de la puberté, en moyenne à l’âge de 10-11 ans. Ce pic dure jusqu'aux premières règles, moment où la croissance ralentit puis s’arrête, en général vers l’âge de 14-16 ans.
Chez les garçons, les premiers signes de la puberté et le pic de croissance qui l’accompagne sont un peu plus tardifs, survenant en moyenne vers 12 ans. Ce pic de croissance se maintient jusqu'à la fin de la puberté. Plus tardive, la croissance des garçons est plus ample et s’arrête en général vers 16-17 ans.
En cas de puberté précoce, les enfants grandissent plus tôt et paraissent donc grands pour leur âge chronologique. Mais leur croissance s’interrompt plus précocement, avec un risque de petite taille définitive.
Le squelette grandit et mûrit
Pendant toutes ces années, le squelette s'allonge grâce à la multiplication des ostéoblastes
ostéoblastes
Cellule permettant la formation de l’os.
(cellules générant de l’os) et se modifie également en profondeur. On parle de croissance et de maturation du squelette.
Chez le jeune enfant, la partie des os longs (fémur, radius…) constituée de cartilage de croissance va croître en longueur, puis se calcifier et se souder pour devenir de l’os adulte. Ainsi, une simple radio du poignet permet à un spécialiste de la croissance d'observer le niveau de maturation de l'os et d'estimer (en dehors de toutes pathologies) l'âge de l'enfant avec une marge l'erreur de 3 à 6 mois. Certains enfants présentent une maturation osseuse trop rapide, qui entraîne en général une diminution de leur taille finale.
Os et Croissance - POM Bio à croquer
Os et Croissance – Interview – 4 min 23 – Film extrait de la collection POM Bio à croquer (2013)
La croissance, valse d’hormones
De nombreuses hormones interviennent dans la croissance. La première porte bien son nom puisqu'il s’agit de l’hormone de croissance (GH). Elle est sécrétée au niveau de l’hypophyse (une glande située à la base du cerveau) essentiellement pendant le sommeil, sous l’influence de deux autres hormones, le GHRH activateur (Growth hormone releasing hormone) et la somatostatine inhibitrice. Une troisième hormone stimule la sécrétion de GH : la ghreline, produite au niveau de l’estomac. L'hormone de croissance agit surtout indirectement sur les cartilages. Elle est transportée jusqu'aux cellules du foie où elle vient se fixer sur des récepteurs spécifiques. Cela provoque la synthèse et la libération du facteur IGF-1 (Insulin-Growth Factor 1) capable (entre autres) de stimuler la maturation et la croissance de l’os.
Les hormones sexuelles (testostérone, œstrogènes) agissent en synergie avec l'hormone de croissance au moment de la puberté. Elles augmentent la production de GH et donc celle d'IGF1. Elles déclenchent ainsi le pic de croissance et accroissent la vitesse de maturation des cartilages de croissance, puis leur ossification. C’est pourquoi, en cas de puberté précoce, la soudure prématurée des cartilages de croissance entraîne un risque de petite taille définitive .
Les hormones thyroïdiennes (produites par la thyroïde, glande située au niveau du cou) jouent également un rôle important dans la croissance. Leur absence entraîne en effet des troubles importants : retard statural sévère, déficit intellectuel… Le dépistage néonatal systématique de l'hypothyroïdie congénitale est aujourd'hui pratiqué. Il permet la mise en œuvre très précoce d’un traitement qui permet lui-même le développement normal des enfants souffrant d’un tel déficit hormonal.
D'autres hormones encore influencent la croissance, comme l'insuline ou la leptine. Mais, pour cette dernière, les mécanismes d’action sous-jacents ne sont pas clairement identifiés.
Le métabolisme phosphocalcique (taux de calcium et phosphate dans l’organisme), et donc les hormones qui le régulent (Vitamine D, parathormone), jouent eux aussi un rôle dans la croissance puisqu'ils sont indispensables à une bonne physiologie osseuse.
Les troubles de la croissance : des origines multiples
Maladies génétiques, hormonales, osseuse, cardiaques, pulmonaires, digestives, rénales mais également dénutrition : les origines des troubles de la croissance sont variées et chacune contribue à un pourcentage infime des problèmes de croissance observés dans la population générale. Plusieurs maladies, listées ci-dessous, ont un impact majeur en l’absence de traitement. Mais la plupart des retards de croissance restent aujourd'hui inexpliqués.
* Les maladies digestives peuvent retarder la croissance en créant des problèmes nutritionnels. C’est par exemple le cas de la maladie cœliaque, caractérisée par une intolérance au gluten, qui provoque des lésions intestinales et des problèmes de malabsorption. Elle est en général détectée chez les nourrissons, mais peut être diagnostiquée plus tardivement. Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), maladies de Crohn et rectocolites hémorragiques, ont également une répercussion sur la croissance lorsqu'elles surviennent au cours de l’enfance.
* Les cardiopathies peuvent retentir sur la croissance. Néanmoins les progrès de la chirurgie du cœur améliorent le pronostic global des enfants et contribuent à restaurer la qualité de leur croissance.
* Les maladies rénales chroniques entraînent souvent un retard de croissance important. Mais là encore, une prise en charge précoce et l’administration de l'hormone de croissance permettent aux enfants de grandir davantage.
* Les maladies métaboliques, inflammatoires, infectieuses, hématologiques et les cancers de l’enfant peuvent également être à l’origine de troubles de la croissance. Des infections ORL à répétition peuvent par exemple avoir un impact. En outre, certains médicaments utilisés dans le traitement de ces affections (comme les corticoïdes) peuvent entraîner à eux seuls des troubles de la croissance.
* Les maladies osseuses. Il existe des dizaines de maladies qui entraînent des anomalies de la structure de l’os et/ou du cartilage et perturbent le bon déroulement de la croissance. L’achondroplasie est la plus connue. Elle se manifeste dès la naissance par un nanisme à membres courts. Un autre exemple est celui de la pycnodysostose, maladie extrêmement rare qui confère petite taille et fragilité osseuse. Enfin, la mutation du gène SHOX (ou l’absence de celui-ci) altère le développement du squelette et la croissance. Il s'agit d'une indication reconnue pour le traitement par hormone de croissance.
* Le retard de croissance intra-utérin (RCIU), ou petite taille pour l’âge gestationnel (SGA), se caractérise par une taille et/ou un poids inférieurs aux normes pour le terme de la grossesse. La plupart des enfants concernés "rattrapent" naturellement ce retard de croissance dans les deux premières années de leur vie. Environ 10 % d’entre eux auront une taille inférieure au tracé bas de la courbe de croissance s’ils ne sont pas traités. Les enfants nés avec un RCIU associé à une maladie syndromique, telle que le syndrome de Silver Russell (anomalie épigénétique de la région 11p15.5-IGF2), restent généralement petits, sans croissance de rattrapage.
* Les anomalies chromosomiques entraînent des maladies rares mais complexes, parfois associées à des troubles de la croissance. Le syndrome de Turner (absence ou anomalie d’un chromosome X) entraîne un retard de croissance important, avec une taille cible d’environ 140 cm en l’absence de traitement par hormone de croissance. Si ce dernier est instauré tôt, la patiente peut espérer gagner 5 à 10 cm de plus en moyenne. Le syndrome de Prader-Willi (altération partielle du chromosome 15 dans une région soumise à empreinte parentaleempreinte parentaleNous possédons chacun de nos gènes en deux copies, l’une transmise par notre mère, l’autre par notre père. Mais pour une poignée d’entre eux, une seule des copies est utilisée : l’autre copie a été éteinte dans le spermatozoïde du père ou dans l’ovule de la mère. Cette mémoire parentale épigénétique est transmise à la descendance au moment de la fécondation et elle est maintenue tout au long de la vie.
) entraîne une obésité morbide et, entre autres, des problèmes de croissance. Le traitement par hormone de croissance est indiqué chez ces patients, représentant un intérêt non seulement pour leur croissance, mais aussi pour leur poids et leur tonus musculaire. La trisomie 21 génère également un problème de croissance.
* Les maladies hormonales. Un déficit en hormone de croissance hypophysaire (Growth Hormone Deficiency ou GHD), parfois associé à d’autres déficits hormonaux, est relativement facile à diagnostiquer. Il représente l’indication idéale pour un traitement substitutif par hormone de croissance. Un déficit congénital en hormone thyroïdienne entraîne lui aussi un retard de croissance important : cette situation a pratiquement disparu en France grâce au dépistage néonatal et la prise en charge précoce qui en découle. Cependant, le dépistage néonatal tel qu’il est réalisé en France ne permet pas de diagnostiquer les hypothyroïdies d’origine hypophysaire ou hypothalamique. Enfin, en cas d’hypothyroïdie acquise après la naissance, le traitement par la thyroxine permet aux enfants de rattraper leur retard de croissance.
* Les anomalies de la puberté. Un retard pubertaire entraîne un retard de croissance qui peut être rattrapé. A l’inverse, les pubertés précoces qui donnent une croissance d’abord "faussement" satisfaisante mais qui s’arrête précocement, entraînent un risque de petite taille à l’âge adulte.
* La dénutrition. Un apport suffisant en calories et en protéines (acides aminés essentiels) est primordial pour une croissance normale. En outre, certains nutrimentsnutrimentsSubstance alimentaire qui n’a pas besoin de subir de transformations digestives pour être assimilée par l’organisme.
sont absolument indispensables à la croissance. C’est par exemple le cas du calcium et de la vitamine D, garant d’un bon métabolisme osseux. En cas de dénutrition, on observe une baisse des récepteurs de l’hormone de croissance au niveau du foie et une baisse de production d’IGF-1 qui ne peut plus stimuler correctement la multiplication des cellules du cartilage, leur croissance et leur calcification. La maturation du cartilage de croissance ne peut être restaurée par l’injection d’hormone de croissance : seule une renutrition permet de rétablir une croissance correcte.
Obésité et croissance, des liens ambigus
L’obésité induit une croissance plus précoce chez les enfants, probablement via la surproduction d’insuline. De fait, les enfants obèses sont souvent plus grands que leurs camarades jusqu’à l’adolescence. L’obésité est néanmoins souvent associée à une puberté plus précoce que la moyenne. La croissance s’interrompt donc plus tôt. Au final, la courbe de croissance est donc avancée pendant l'enfance, mais la taille définitive des enfants obèses est en moyenne équivalente à celle de la population générale.
La croissance expliquée aux enfants
Croissance – film d’animation pédagogique – 4 min 46 – Film extrait de la collection Recherche à suivre, une série de clips des années 90
L’hormone de croissance, sous certaines conditions
Le fait de traiter l’origine d’une maladie rénale, cardiaque ou pulmonaire qui a un retentissement sur la croissance peut rétablir une évolution normale.
Pour traiter les problèmes hormonaux, plusieurs hormones synthétiques sont disponibles, comme :
* l’hormone de croissance GH pour les patients déficitaires, ou ceux nés avec un retard de croissance intra-utérin et qui n'ont pas normalisé leur croissance à 4 ans
* la thyroxine pour traiter les déficits en hormone thyroïdienne,
* un analogue de la GnRH pour retarder une puberté trop précoce (avant l’âge de 8 ans pour une fille et de 10 ans pour un garçon)
* des hormones sexuelles en cas de retard pubertaire
Le choix du traitement approprié est réalisé en fonction de nombreux critères, par des spécialistes expérimentés (endocrinologues pédiatres). Le traitement de référence reste l’administration d’hormone de croissance. Depuis 1985, il existe une hormone de synthèse qui ne présente plus les risques de contamination associés à l’hormone humaine utilisée dans les années 80. Son usage est réservé à cinq indications précises, en plus du déficit en hormone de croissance (GHD) :
* petite taille pour l’âge gestationnel n’ayant pas rattrapé son retard à l’âge de 4 ans,
* syndrome de Turner
* syndrome de Prader-Willi
* insuffisance rénale chronique
* déficit du gène Shox
Selon la Haute Autorité de Santé, en France, environ 6 000 enfants bénéficient de ce traitement dans le cadre de l’une de ces indications.
Le traitement par hormone de croissance est souvent commencé à l’âge de 5 ou 6 ans. Il est maintenu jusqu’à la diminution de la vitesse de croissance après le pic de croissance pubertaire. Il n’a plus d’intérêt une fois que la maturation du squelette est achevée. Dans certains cas particuliers, il peut néanmoins être poursuivi à faible dose pour son bénéfice sur le métabolisme lipidique et glucidique, afin de prévenir d’éventuelles complications cardiovasculaires chez les adultes gardant un déficit profond en hormone de croissance.
Il s’agit d’un traitement contraignant et coûteux, nécessitant des injections quotidiennes parfois difficiles à faire accepter aux enfants.
Les enjeux de la recherche
Des biomarqueurs de croissance au conseil génétique
Les progrès effectués en génétique ont permis d’identifier un certain nombre de mutations associées aux troubles de la croissance. D'autres restent à découvrir. Ces avancées permettent de mieux comprendre les mécanismes de la croissance, hormonal, osseux… et d’améliorer le conseil génétique aux parents dont un enfant est atteint d’un trouble de la croissance.
Un travail important porte également sur l’étude des interactions entre l’environnement et le génome, à l’origine de modifications épigénétiques. Ces interactions modifient l’expression de certains gènes et donc la quantité de certaines protéines impliquées dans la croissance. Ainsi, pour tenter de comprendre l’origine des retards de croissance intra-utérins et leur impact (notamment cardio-métabolique) à l’âge adulte, les chercheurs étudient l’effet des événements affectant la vie fœtale sur l’enfant à naître : dénutrition, troubles de la vascularisation placentaire (via les effets du tabac, de la génétique…), stress, exposition aux corticoïdes, aux perturbateurs endocriniens, à des toxiques divers, ainsi que les anomalies de régions du génome soumises à l'empreinte parentale et importantes pour la régulation de la croissance fœtale et postnatale...
Les chercheurs tentent aussi de découvrir des biomarqueurs
biomarqueurs
Paramètre physiologique ou biologique mesurable, qui permet par exemple de diagnostiquer ou de suivre l’évolution d’une maladie.
prédictifs de l’évolution de la croissance et de l’efficacité des hormones de croissance synthétiques. Cela permettrait de mieux cibler les enfants à traiter et d’affiner les modalités de traitement (dose, durée…). Pour cela, ils étudient le génome, mais également l’expression des gènes (transcriptomique
transcriptomique
Étude des ARN produits lors de l’étape de transcription du génome, permettant de quantifier l’expression des gènes.
) et le protéome (ensemble des protéines) de cohortes d’enfants présentant des troubles de la croissance. Ils espèrent ainsi mettre en évidence des gènes et des molécules associés à une bonne ou à une mauvaise réponse thérapeutique. Des résultats sont en cours de validation mais il faudra probablement attendre la découverte d’une association de plusieurs marqueurs significatifs avant d’être en mesure de prédire le succès d’un traitement ou la taille finale d’un enfant.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Un nouveau gène impliqué dans lâhypertension artérielle |
|
|
| |
|
| |

Un nouveau gène impliqué dans l’hypertension artérielle
COMMUNIQUÉ | 19 FÉVR. 2018 - 10H12 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE ET BIO-INFORMATIQUE
Une équipe de chercheurs dirigée par Maria-Christina Zennaro, directrice de recherche Inserm au sein du Paris Centre de Recherche Cardiovasculaire (Inserm/ Université Paris-Descartes), en collaboration avec des collègues allemands[1], a identifié un nouveau gène impliqué dans l’hypertension artérielle. Cette étude a été publiée dans Nature Genetics.
Ces nouveaux résultats soulignent l’importance du terrain génétique dans la survenue des maladies communes et confortent l’intérêt du déploiement du Plan France Médecine Génomique 2025. L’un de ses objectifs consiste effectivement à permettre l’accès au dépistage génétique, même pour des pathologies communes, pour proposer une médecine individualisée.
L’hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire majeur, qui touche jusqu’à 25% de la population. Dans environ 10% des cas, elle est due au dysfonctionnement de la glande surrénale qui produit en excès l’aldostérone, une hormone qui régule la pression artérielle. On parle alors d’hyperaldostéronisme primaire. Les patients touchés par cette maladie ont une hypertension souvent grave et résistante aux traitements habituels. Ces patients ont aussi plus de risques de développer des accidents cardiovasculaires, notamment des infarctus du myocarde et des AVC.
Afin de mieux comprendre les causes de cette maladie, Maria-Christina Zennaro et Fabio Fernandes-Rosa, chercheurs Inserm à Paris, ont analysé les exomes (la part du génome codant pour les protéines) de patients atteints d’hyperaldostéronisme primaire avant l’âge de 25 ans. Cette approche a permis d’identifier une mutation dans un gène jusqu’à alors inconnu, CLCN2. Ce gène code pour un canal chlorure, dont la présence et les effets dans la glande surrénale étaient alors inconnus.
Une production autonome d’aldostérone
Grâce à leur partenariat avec une équipe allemande dirigée par Thomas Jentsch à Berlin, les chercheurs ont étudié les mécanismes par lesquels cette mutation pouvait induire une production autonome d’aldostérone et déclencher une hypertension artérielle. Ils ont découvert que la mutation entrainait une ouverture permanente du canal chlorure.
Dans un modèle animal, les chercheurs ont montré que ce canal est justement exprimé dans la zone des surrénales produisant l’aldostérone. Par des expériences d’électrophysiologie et de biologie cellulaire, ils ont montré que l’influx de chlorure à travers le canal muté aboutissait à une augmentation des flux de chlorure et une dépolarisation de la membrane cellulaire. Les cellules de cortex surrénalien produisent alors plus d’aldostérone en présence du canal muté et expriment d’avantage les enzymes impliqués dans sa biosynthèse.
Cette découverte révèle un rôle jusqu’alors inconnu d’un canal chlorure dans la production d’aldostérone. Elle ouvre des perspectives tout à fait nouvelles dans la pathogenèse et la prise en charge de l’hypertension artérielle.
[1] Du Leibniz Institute for Molecular Pharmacology (FMP) et Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC) à Berlin.
POUR CITER CET ARTICLE :
COMMUNIQUÉ – SALLE DE PRESSE INSERM
Un nouveau gène impliqué dans l’hypertension artérielle
LIEN :
https://presse.inserm.fr/un-nouveau-gene-implique-dans-lhypertension-arterielle/30662/
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Lâindividualité des souris est influencée par leur entourage |
|
|
| |
|
| |

L’individualité des souris est influencée par leur entourage
COMMUNIQUÉ | 06 AOÛT 2018 - 11H45 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
L’individualité existe chez tous les animaux, et plusieurs facteurs la façonnent au cours du temps. C’est le cas de l’environnement social pour les souris comme viennent de le montrer des chercheurs du CNRS, de l’Inserm et de Sorbonne Université. Chez cette espèce, certains traits de caractère stables peuvent s’inscrire dans l’activité même des neurones d’un individu et se voir modifiés lorsque change la composition de son groupe. Ces résultats sont publiés dans Nature Communications.
L’individualité n’est pas le propre de l’Homme. Si l’idée a pu rebuter les biologistes au départ, il est aujourd’hui admis qu’elle se rencontre chez toutes les espèces animales. On la définit comme l’ensemble des différences de comportement relativement stables dans le temps entre individus d’une même espèce. Si le processus dit d’individuation est sous-tendu par des composantes génétiques et développementales, des chercheurs viennent de démontrer chez la souris que l’environnement social et l’activité de certains neurones ont aussi un rôle déterminant dans l’émergence d’individus distincts.
Pour arriver à cette conclusion, les équipes des laboratoires Neuroscience Paris-Seine (CNRS/Inserm/Sorbonne Université), Adaptation biologique et vieillissement (CNRS/Sorbonne Université)1 et de l’Institut de la longévité de Sorbonne Université situé à l’Hôpital Charles Foix (AP-HP) ont étudié la vie des habitants de « Souris City », un dispositif expérimental novateur offrant deux lieux de vie en commun aux animaux, et la possibilité de leur faire passer un test un par un, sans intervention humaine. C’est grâce à ce test que les chercheurs ont identifié différentes « personnalités » parmi les souris. Celui-ci était un labyrinthe en T où elles devaient choisir entre deux bras menant, à de l’eau normale pour l’un ou à de l’eau sucrée pour l’autre. Ces deux positions étant alternées régulièrement. Face à ce problème, deux stratégies radicalement différentes ont émergé : certaines souris variaient très souvent leur choix, d’autres presque jamais.
La première chose que les auteurs ont observée est que le type de comportement adopté par chaque individu était corrélé au fonctionnement des neurones producteurs de dopamine, impliqués notamment dans la prise de décision. Les souris qui alternaient le plus par exemple, présentaient une activité dopaminergique plus faible. On peut donc dire qu’il y a une inscription biologique de l’individualité des souris.
Pour comprendre le rôle de l’environnement social des souris sur le développement de ces différentes individualités, les chercheurs ont poursuivi leurs expériences en modifiant la composition des groupes de Souris City. Ils ont regroupé les individus qui adoptaient la même stratégie au test, ceux qui alternaient peu d’un côté, et ceux qui alternaient beaucoup d’un autre. Surprise : après quelques semaines, les rôles étaient redistribués au sein de chaque groupe ! Certaines souris variant peu leur choix étaient devenues les plus exploratrices de leur nouveau groupe, et vice versa.
Plus étonnant encore, ce changement de comportement est corrélé à une modification de l’activité du système dopaminergique des souris.
Ces résultats suggèrent que, loin d’être figés, les mécanismes de prise de décision, les registres comportementaux, mais aussi le niveau d’activité des structures nerveuses de chaque individu s’adaptent en fonction de la structure sociale dans laquelle ils évoluent.
Le fait que l’environnement social contribue aux différences entre les individus a des implications en sociologie, en psychologie, en biologie mais aussi en médecine. Les facteurs sociaux ont aussi un rôle dans le développement de pathologies psychiatriques telles que l’addiction. Un domaine auquel les chercheurs vont s’intéresser en étudiant l’influence de l’environnement social sur la vulnérabilité aux drogues.
[1]Ces laboratoires sont membres de l’Institut de biologie Paris-Seine
POUR CITER CET ARTICLE :
COMMUNIQUÉ – SALLE DE PRESSE INSERM
L’individualité des souris est influencée par leur entourage
LIEN :
https://presse.inserm.fr/lindividualite-des-souris-est-influencee-par-leur-entourage/32138/
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Autisme |
|
|
| |
|
| |
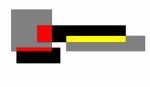
Autisme
Sous titre
Un trouble du neurodéveloppement affectant les relations interpersonnelles
Les troubles du spectre de l'autisme (TSA) résultent d'anomalies du neurodéveloppement. Ils apparaissent précocement au cours de la petite enfance et persistent à l’âge adulte. Ils se manifestent par des altérations dans la capacité à établir des interactions sociales et à communiquer, ainsi que par des anomalies comportementales, en particulier une réticence au changement et une tendance à la répétition de comportements ou de discours. Les personnes concernées semblent souvent isolées dans leur monde intérieur et présentent des réactions sensorielles (auditives, visuelles, cutanées...) particulières. Malgré la diversité des troubles et les capacités d'insertion sociale très variables de ces personnes, l'autisme est reconnu comme un handicap en France depuis 1996. Il nécessite une recherche pluridisciplinaire pour comprendre ses mécanismes et améliorer sa prise en charge.
Dossier réalisé en collaboration avec Catherine Barthélémy, Prix d'honneur Inserm 2016, professeure émérite (Faculté de médecine et université de Tours), membre de l'Académie nationale de médecine.
Comprendre l’autisme
L'autisme "typique", décrit par le pédopsychiatre Leo Kanner en 1943, est aujourd'hui intégré dans un ensemble plus vaste, celui des troubles du spectre de l'autisme (TSA), qui rendent mieux compte de la diversité des situations.
Ces troubles rassemblent un ensemble de conditions caractérisées par :
* des altérations des interactions sociales
* des problèmes de communication (langage et communication non verbale)
* des troubles du comportement correspondant à un répertoire d’intérêts et d’activités restreint, stéréotypé et répétitif
* des réactions sensorielles inhabituelles
Autant de particularités souvent à l'origine de difficultés d’apprentissage et d'insertion sociale.
L’autisme (et les TSA en général) se manifeste le plus souvent durant la petite enfance, avant l’âge de trois ans, puis persiste tout au long de la vie. Au total, les TSA concernent environ 700 000 personnes en France, qui vivent toutes un handicap social. En revanche, contrairement à une idée répandue, l'autisme n'est pas systématiquement associé à un retard intellectuel. Le syndrome d'Asperger, par exemple, est un TSA associé à un très bon développement intellectuel. Cependant, un tiers des personnes concernées par un TSA présente une déficience intellectuelle, de gravité très variable. Le syndrome autistique peut être observé dans des pathologies génétiques avec handicap intellectuel sévère, comme les retards mentaux liés à l'X, le syndrome de l'X fragile ou, de manière souvent transitoire, le syndrome de Rett. Chez un patient atteint de TSA avec déficience intellectuelle, les examens médicaux recherchent donc systématiquement ces pathologies.
Des troubles affectant les relations interpersonnelles, la communication et le comportement
Les personnes atteintes d’autisme semblent peu accessibles aux autres. Elles établissent difficilement les contacts nécessaires à la construction d’une relation interpersonnelle, en particulier les contacts visuels. Le plus souvent, elles ne répondent pas lorsqu’on les appelle. Elles sourient très rarement et semblent ne pas comprendre les sentiments et les émotions des autres.
Les troubles de la communication associés à l’autisme touchent à la fois le langage et la communication non verbale. Une importante proportion – mais pas une majorité – des personnes atteintes de TSA présente des troubles du langage : répétition incessante des mêmes phrases, modulation et formulations inhabituelles, non utilisation de termes abstraits, etc. Une partie d'entre eux ne parle pas du tout. Au total, beaucoup d'autistes peinent à entrer dans un dialogue. Par ailleurs, ils ne comprennent et n’utilisent pas les éléments de communication non verbale tels que les gestes, les expressions du visage, le regard ou le ton de la voix.
Les personnes atteintes d’autisme ont souvent des comportements répétitifs (balancements du corps, battements des mains, tournoiements …), auto-agressifs (se mordre les mains, se cogner la tête…) ou inappropriés (pleurer ou rire sans raison apparente…). Elles s’attachent souvent à des objets qu’elles utilisent de manière détournée, par exemple en les alignant ou en les faisant tourner inlassablement. En général, elles tolèrent mal le changement (de lieux, d’emplois du temps, de vêtements, d'alimentation …). Une situation imprévisible peut provoquer une réaction d’angoisse ou de panique, de colère ou d’agressivité. Ces personnes qui semblent souvent indifférentes aux monde extérieur peuvent donc, de manière paradoxale, y être extrêmement sensibles: la lumière, le contact physique ou certaines odeurs peuvent déclencher des réactions de rejet très fortes.
L’autisme et les autres TSA s’accompagnent souvent de troubles du sommeil, de problèmes psychiatriques (dépression, anxiété), de troubles du développement (trouble de l'apprentissage ou de l’attention/hyperactivité). Près d'un autiste sur cinq souffre également d’épilepsie.
Les premiers signes, avant 3 ans
Les premiers signes évocateurs de l’autisme se manifestent le plus souvent entre 18 et 36 mois.
L’enfant est trop calme ou au contraire trop excité. Il semble indifférent au monde sonore et aux personnes qui l’entourent. Il ne répond pas à son prénom et ne réagit pas (ou peu) aux séparations et aux retrouvailles. Il ne sourit pas (ou rarement) et reste silencieux. Il ne regarde pas dans les yeux, ne joue pas à faire "coucou", ne pointe pas du doigt et ne cherche pas à imiter les adultes.
Une origine multifactorielle, largement génétique
L'autisme et les autres TSA sont liés à des anomalies très précoces – d'origine anténatale – du neurodéveloppement.
L'imagerie médicale, entre autres techniques, a mis en évidence chez ces personnes des défauts de mise en place et d'organisation de certains réseaux cérébraux spécialisés, dédiés à la communication sociale et à la modulation du comportement en fonction de l'environnement et de ses changements. La biologie moléculaire a pour sa part identifié plusieurs centaines de gènes dont l’altération semble conduire à une plus grande susceptibilité à l’autisme. Ces gènes sont impliqués dans des processus biologiques divers, mais nombre d’entre eux participent précisément à la formation du système nerveux et des connexions synaptiques, ainsi qu'à la synthèse de substances chimiques indispensables au bon fonctionnement du cerveau.
Il est désormais bien établi qu'il s'agit de maladies d'origine multifactorielle, avec cependant une forte composante génétique. Etre un garçon et présenter des antécédents familiaux sont d'ailleurs deux facteurs de risque reconnus. Cela n'exclut pas l'intervention de facteurs environnementaux – neuroinflammation, virus, toxiques ... – durant la grossesse, mais leur nature exacte n'est pas connue actuellement. La naissance prématurée constitue un autre facteur de risque reconnu et important. Par ailleurs, certains médicaments antiépileptiques administrés à la mère durant la grossesse, comme la Depakine, sont actuellement sur la sellette.
Quatre garçons pour une fille?
Si les garçons sont plus souvent atteints d’autisme que les filles, ce chiffre très souvent cité doit être relativisé. En effet les outils de détection et d'évaluation de ce trouble ont été essentiellement validés sur des populations de garçons, avec le risque d'occultation de signes propres aux filles. Une méta-analyse récente évoque plutôt un rapport de trois garçons pour une fille, rapport qui pourrait encore évoluer avec les progrès de la détection.
Faux coupables
Les données actuellement disponibles montrent que, contrairement à des croyances tenaces, ni les maladies cœliaques secondaires à une intolérance au gluten, ni la vaccination combinée contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), ni les caractéristiques psychologiques des parents (en particulier les prétendues "mères réfrigérateurs") ne sont des facteurs de risque de TSA.
Une prise en charge globale
L’autisme ne se soigne pas mais une prise en charge adaptée à l’enfant améliore ses capacités fonctionnelles à interagir avec le monde qui l’entoure et à s’y adapter. Cette prise en charge, pluridisciplinaire et individualisée, est un parcours de soin qui évolue avec l'enfant, puis l'adolescent et l'adulte. L'autisme persistant toute la vie, sa prise en charge doit "suivre" le patient.
Des troubles à dépister au plus tôt
Pour prendre en charge les autistes, encore faut-il les reconnaître comme tels. A cet égard, un dépistage précoce – autant que possible dès 18 mois – est essentiel : plus tôt est démarrée la prise en charge et meilleurs en seront les résultats. Une prise en charge précoce permet en effet des progrès supérieurs et évite l'apparition de sur-handicaps. Dans ce domaine, entre autres, la France doit rattraper un retard certain. La nouvelle stratégie nationale pour l'autisme le prend en compte (voir plus loin).
Catherine Barthélémy, Prix d'honneur Inserm 2016, professeure émérite de la faculté de médecine de Tours, et ancienne directrice de l’équipe Autisme de l’unité de recherche Inserm 930 "Imagerie et Cerveau" à Tours.
Fondée sur une approche comportementale et développementale, la prise en charge comprend des dimensions sanitaires, médico-sociales et sociales. Le développement de l’enfant est régulièrement évalué (au moins une fois par an), de manière à pouvoir ajuster sa prise en charge. L’enfant reçoit des soins psycho-éducatifs, basés sur le jeu, qui l’aident à développer son langage, ses compétences cognitives, sensorielles et motrices, à adapter son comportement, à gérer ses émotions… Cela se fait à la maison – dans le lieu habituel de vie – et avec la famille. L’objectif est de lui donner (ainsi qu'à son entourage) les outils pour interagir avec les autres et à acquérir de l’autonomie.
Dans toute la mesure du possible, la prise en charge est conçue et réalisée avec la personne concernée et non pour elle. Un des enjeux actuels est de scolariser les autistes et de les aider à s'insérer dans la société plutôt que les cantonner dans des institutions. Pour une minorité de personnes ne pouvant pas s'insérer socialement, des centres d'accueil spécialisés sont apparus en France en 1996 mais ils restent peu nombreux. Beaucoup trop d'adultes autistes sont actuellement placés dans des lieux inadéquats (hôpital psychiatrique, institution pour personnes mentalement déficientes) ou laissés à la charge de parents vieillissants.
Des médicaments ?
A ce jour, aucun traitement médicamenteux ne guérit l’autisme. Toutefois, certains médicaments sont utilisés pour traiter les pathologies souvent associées aux TSA, comme l’épilepsie.
Les enjeux de la recherche
La recherche française sur l’autisme et les autres TSA se structure désormais autour de l'Institut thématique multi-organismes Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie, qui regroupe des équipes de l’Inserm, de CNRS, des Universités, des CHRU, de l’Institut Pasteur, de l’Inra, du CEA, etc. Des chercheurs et des praticiens de différentes disciplines – imagerie, biologie moléculaire, génétique, recherche clinique, psychologie, sciences cognitives, sciences sociales, etc. – collaborent pour tenter de comprendre les mécanismes de l'autisme, les relier à la clinique, esquisser de meilleures méthodes de détection et de prise en charge et comprendre comment la société pourrait mieux inclure ces personnes.
Comprendre
Pour mieux comprendre le développement très précoce des circuits cérébraux et leur lien avec le tableau clinique, la recherche s'articule autour de quatre axes:
* la période pré et périnatale, où il s'agit d'étudier les interaction gènes-environnement au cours de la mise en place des réseaux cérébraux
* l'enfance, avec sa trajectoire de développement et ses éventuelles régressions : il faut identifier les réseaux neuronaux concernés et faire le lien avec les manifestations cliniques. Cela suppose l'identification de nouveaux marqueurs et le développement d'outils diagnostiques.
* l'adolescence : le devenir des troubles du développement durant cette période charnière de la maturation cérébrale est peu exploré. Or ils peuvent évoluer très favorablement... ou s'aggraver, allant parfois jusqu'à une transition vers la schizophrénie. A l'inverse, durant cette période, des troubles psychiques ou cognitifs préexistants peuvent "réveiller" un autisme passé inaperçu jusque-là.
* les adultes sont les "grands oubliés" de la recherche. La biologie et les manifestations cliniques de l'autisme ne sont pas forcément les mêmes que chez les enfants. Il s'agit donc d'explorer tous les aspects de l'autisme adulte: tableau clinique, troubles associés, mécanismes de compensation, biologie, aspect sociologiques ...
Détecter et prendre en charge
Etude de suivi du regard "eye tracking". Etude sur l'autisme au service Explorations fonctionnelles et neurophysiologie en pédopsychiatrie, équipe Autisme, unité Inserm 930 Imagerie et cerveau, Centre hospitalier universitaire Bretonneau, Tours. © Inserm/Patrice Latron
De nouveaux outils (analyse automatique de films, suivi du regard...) sont à l'étude pour détecter l'autisme à la maison, dans le cadre habituel de vie du bébé et non dans un environnement étranger (cabinet, hôpital). La linguistique est aussi mise à contribution pour mieux analyser les particularités formelles du langage dans les TSA.
Un champ de recherche nouveau s'ouvre également pour développer un corpus de connaissances sur l'éducation de ces enfants : comment les aider à acquérir des connaissances, à devenir réellement des apprentis à l'école. Il fait appel aussi bien à la psychologie du développement et de l'apprentissage qu'aux neurosciences cognitives, voire à l'imagerie cérébrale fonctionnelle.
Les sciences humaines et sociales (sociologie, économie, psychologie) sont aussi mises à contribution pour comprendre comment la société accueille – ou pas – ces personnes.
Traiter ?
Quelques molécules, en particulier des diurétiques, ont donné des résultats intéressants, mais très préliminaires, sur certains traits comportementaux. Il reste à mieux mesurer leur effet et à visualiser et comprendre les mécanismes de restauration du fonctionnement des circuits cérébraux. La voie menant à d'éventuelles aides médicamenteuses à la prise en charge (si elles existent un jour) reste très longue.
La stratégie nationale pour l'autisme (2018 -2022)
Présentée au public le 6 avril 2018, la stratégie nationale pour l'autisme prend la suite de trois plans nationaux successifs.
Dotée d'environ 350 millions d'euros, elle s'articule autour de quatre grandes ambitions:
* inclure les personnes autistes dans la société
* intervenir de manière adaptée et respectueuse de leurs choix et de ceux de leur famille
* donner aux professionnels les moyens d'agir
* placer la science au cœur de la politique publique en créant un réseau de recherche d'excellence et en assurant la diffusion des connaissances. Il s'agit également de favoriser les méthodes de prise en charge réellement évaluées.
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
