|
| |
|
|
 |
|
ORIGINES ET POSITION DE L'HOMME DANS L'ÃVOLUTION : LA CONNEXION CHROMOSOMIQUE |
|
|
| |
|
| |
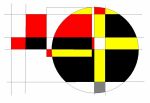
ORIGINES ET POSITION DE L'HOMME DANS L'ÉVOLUTION : LA CONNEXION CHROMOSOMIQUE
Il est possible de montrer que l'homme partage ses chromosomes, support de l'hérédité, avec l'ensemble des mammifères, et d'utiliser les différences, d'espèce à espèce, pour reconstruire leur phylogénie, c'est-à-dire leurs positions respectives dans l'arbre de l'évolution. L'étude qui sera basée sur des approches de cytogénétique classique et moléculaire, utilisant des sondes spécifiques de chromosomes humains, appliquées à une centaine de primates et une centaine de mammifères appartenant à d'autres ordres comme les carnivores, les rongeurs, les artiodactyles etc. Aujourd'hui, il n'est pas exagéré de dire que l'on connaît, de notre grand ancêtre mammalien, beaucoup mieux les chromosomes que la morphologie. Cette reconstitution d'une centaine de millions d'années d'évolution des chromosomes amène à poser des questions sur les mécanismes de la spéciation, l'origine des ordres de mammifères et celle de l'homme, l'origine de certaines pathologies, séquelles de notre propre évolution et à proposer des règles montrant que l'évolution n'est pas aléatoire.
Transcription de la 5ème conférence de l'Université de tous les savoirs réalisée le 5 janvier 2000 par Bernard Dutrillaux
Origines et position de l'Homme dans l'évolution: la connexion chromosomique
Un même caryotype, c'est-à-dire un même lot de chromosomes, est partagé par 99 % de la population humaine. Les variations, qui touchent donc 1 % de la population peuvent être considérées comme des modifications récentes et sans avenir, puisque liées à des pathologies ou des difficultés de procréation. Des conclusions semblables s'appliquent à un grand nombre d'espèces, et en particulier aux gorilles et aux chimpanzés, qui nous sont proches. Ainsi chaque espèce, ou presque, possède un caryotype qui lui est propre, mais cela ne signifie pas que tous les chromosomes diffèrent d'une espèce à l'autre. Ainsi l'homme partage 12 chromosomes avec le chimpanzé, 10 avec le gorille, 12 avec l'orang-outang, 5 avec le macaque, 2 avec le singe capucin et plus aucun avec les lémurs et les mammifères non primates. Pourtant, lorsqu'on analyse les structures chromosomiques, avec les moyens les plus fins possibles, il est possible de montrer que la quasi-totalité du matériel chromosomique est conservé entre l'homme, le lapin, l'écureuil, le bœuf, le chat etc. Seule varie l'organisation de ces structures. Cela démontre que nous avons tous des ancêtres communs, qui ne sont pas si éloignés de nous à l'échelle de l'évolution. Comparant les structures chromosomiques, soit par des méthodes faisant apparaître des bandes, soit par études de réplication de l'ADN, il est aujourd'hui possible de reconstituer, assez exactement le caryotype de l'ancêtre de tous les mammifères placentaires, dits euthériens. Ainsi, les chromosomes de cet animal, qui a vécu il y a quelques 100 millions d'années sont beaucoup mieux connus que tout autre de ses caractères. Une reconstitution des événements chromosomiques peut être réalisée, permettant l'établissement d'un arbre évolutif. Cette phylogénie chromosomique, progressivement établie à partir des années 70, n'a jamais été démentie, et a souvent permis de réajuster certaines interprétations. Quelles sont donc les informations que l'on peut y puiser ?
Dans un premier temps nous verrons comment les progrès techniques en cytogenétique, l'étude des chromosomes, ont permis à partir d'une information, qui il y a quelques années encore était relativement modeste, d'arriver à obtenir finalement beaucoup de données non pas sur les gènes mais sur leur support.
Après avoir exposé comment on peut observer les structures chromosomiques, nous les utiliserons progressivement pour comparer nos chromosomes à ceux de beaucoup d'autres espèces. Le caryotype représente l'ensemble des chromosomes d'une espèce. Nous reconstituerons les caryotypes ancestraux d'espèces qui nous ont précédé voici - 5 à 10 millions, - 30 millions, - 50 millions d'années et environ - 100 millions d'années d'évolution. Une fois reconstitué ce qu'étaient les chromosomes de nos lointains ancêtres, nous ferons le chemin inverse pour comprendre comment les chromosomes se sont différenciés, et comment situer notre propre espèce parmi les primates. Enfin nous aborderons les conséquences de cette évolution en terme de pathologie.
Commençons par un rappel sur l'ordre des primates. Les primates comprennent les singes, les humains et les pré-singes ou prosimiens. Les prosimiens sont représentés par les lémuriens de Madagascar, plus de 30 espèces, et d'autres prosimiens qui vivent en Afrique et en Asie, soit au total, environ 60 espèces.
Les simiens ou singes proprement dit plus les humains, comprennent deux infra ordres : les singes du nouveau monde ou plathyrrhiniens, environ 60 espèces, et les catharrhiniens, environ 70 espèces. L'ensemble des primates comprend donc près de 200 espèces.
Le travail qui a été réalisé sur les chromosomes a consisté à comparer les caryotypes, donc les chromosomes, d'une centaine de ces espèces de primates, soit près de la moitié des espèces vivantes. Certains groupes ayant les mêmes chromosomes, ils n'ont pas été étudiés systématiquement. Cette étude sur les chromosomes et l'évolution des primates est aujourd'hui encore la plus détaillée qui ait été développée sur la phylogénie de l'Homme et de toutes les espèces qui lui sont plus ou moins proches.
Le génome humain, l'ensemble de nos caractères héréditaires, est porté par l'ADN qui comprend un milliard de nucléotides ou unités du code génétique. Le nombre de nos gènes serait d'environ 100 000. Il y a 46 chromosomes chez l'Homme soit 23 paires. Chaque individu reçoit un chromosome pour chaque paire de son père et de sa mère. Chaque chromosome est constitué d'une seule molécule d'ADN. Un chromosome moyen par conséquent va contenir
3 000 à 4 000 gènes. Les structures qu'on peut faire apparaître sur les chromosomes, les bandes, comprennent en moyenne une centaine de gènes. C'est donc l'évolution du support matériel des gènes et non des gènes eux-mêmes que l'on va suivre.
Commençons par des aspects techniques. Les 100 000 gènes humains sont contenus dans le noyau de chaque cellule. Lorsque les cellules se divisent on voit apparaître des chromosomes au niveau du noyau. Il a fallu attendre jusqu'en 1956 pour parvenir à compter les 46 chromosomes qu'il y a chez l'Homme.
Pour cela il a fallu faire de la culture de cellules. À la fin des années 50, a été mis au point l'étalement sur lame de verre de tous les chromosomes permettant de les analyser, après avoir fait gonfler les cellules par un choc hypotonique.
Les techniques utilisées autour des années 60 consistaient à prendre des photos dont on découpait les chromosomes pour les reclasser grossièrement en fonction de la taille. L'étape d'après a consisté à faire apparaître des bandes sur les chromosomes. Ces bandes permettent d'appairer les chromosomes, car elles sont identiques sur les deux chromosomes de la même paire.
Le perfectionnement de ces méthodes a permis d'observer un ensemble de 1000 structures chromosomiques, très conservées durant l'évolution des mammifères. Nous allons suivre les modifications de position de ces structures soit d'un chromosome à l'autre, soit à l'intérieur d'un même chromosome.
D'autres techniques permettent de mettre en évidence par fluorescence, un gène donné sur un chromosome. Dans ce cas, un petit fragment d'ADN est utilisé comme sonde moléculaire et est hybridé sur le chromosome. Ainsi, lors de la comparaison des chromosomes d'une espèce à l'autre, il sera possible de rechercher si les gènes se trouvent là où on les attend par rapport à la structure chromosomique.
Il est également possible d'utiliser non plus le gène comme sonde moléculaire mais un chromosome. Suite à une hybridation in situ, tout le chromosome sera fluorescent.
Il y a une telle conservation du matériel génétique au cours de l'évolution qu'il est possible d'utiliser la sonde d'un chromosome humain donné et de l'hybrider sur une cellule d'un individu d'une autre espèce et ainsi savoir d'emblée que ce chromosome correspond au chromosome humain testé. Par exemple, le chromosome 3 humain a été utilisé comme sonde pour l'hybrider sur une cellule de macaque. Un seul chromosome est colorié, donc tous les composants du
chromosome 3 humain se trouvent sur un seul chromosome chez le macaque et tous les composants de ce chromosome étaient présents chez nos ancêtres communs avec le macaque il y a 30 millions d'années.
Une autre amélioration permet à la fois d'observer les bandes et de réaliser l'hybridation in situ.
Revenons au marquage en bandes chromosomiques. La comparaison d'un demi caryotype d'Homme et d'un demi caryotype de chimpanzé permet d'observer que des chromosomes sont tout à fait semblables et d'autres sont un peu différents. Ces différences sont dues à des cassures-fusions ou remaniements de chromosomes. Ainsi, une inversion correspond à la cassure d'un chromosome en deux points et à une rotation de l'ensemble qui sera rabouté. Une inversion péricentrique a lieu autour du centromère, qui est un peu comme le moteur du chromosome. Une inversion est dite paracentrique lorsque les cassures sont du même côté du centromère. Une translocation correspond à l'accrochage d'un fragment de chromosome sur un chromosome d'une autre paire. Ces types de remaniements se retrouvent au cour de l'évolution. Le matériel reste globalement présent mais les structures chromosomiques vont s'échanger, ou se remanier à l'intérieur d'un même chromosome.
Il existe ainsi une douzaine de remaniements qui vont séparer les chromosomes de l'Homme et du Chimpanzé. Des résultats équivalents sont obtenus lors de la comparaison du caryotype de l'orang-outan avec celui du chimpanzé, du gorille ou de l'homme. Ainsi en terme de remaniements des chromosomes, nous sommes à peu près équidistants du gorille, du chimpanzé et de l'orang-outan, de même que ces animaux sont à peu près équidistants entre eux.
Ces comparaisons nous amènent à reconstituer un caryotype ancestral selon le principe dit de parcimonie. Si 2, 3 ou 4 espèces ont exactement le même chromosome, on considère que leur ancêtre commun avait le même chromosome. C'est l'hypothèse la plus simple. Par exemple le chromosome 6 est partagé entre l'orang-outan, le gorille, le chimpanzé et l'Homme. Donc, l'ancêtre commun à ces animaux et à nous-même avait déjà ce chromosome. Le dernier ancêtre commun au chimpanzé, au gorille et à l'Homme a vécu il y a - 5 à 10 millions d'années. L'orang-outan s'est séparé avant. Nous pouvons reconstituer, par les bandes et les sondes chromosomiques, le caryotype de l'ancêtre commun au macaque et à l'Homme. Ceci nous ouvre le possibilité de comparer toute la branche des cercopithèques environ 60 espèces africaines et asiatiques, ce que nous avons fait.
Nous avons aussi étudié une trentaine d'espèces de singes du nouveau monde (platyrrhiniens) et reconstitué des points communs pour dresser leur caryotype ancestral commun. Il s'agit du caryotype d'un animal qui a vécu il y a une cinquantaine de millions d'années.
Pour savoir si ces reconstitutions sont exactes, il est très intéressant de comparer le caryotype reconstitué pour un groupe à celui d'un autre groupe. S'il y a des erreurs, les caryotypes doivent être très différents. À l'inverse, si les reconstitutions sont correctes, les caryotypes ancestraux devraient se ressembler. Les chromosomes du demi caryotype hypothétique de l'ancêtre commun aux plathyrrhiniens et du microcebus murinus, un prosimien, se ressemblent, d'où l'idée que des chromosomes identiques étaient présents chez l'ancêtre des simiens et des prosimiens.
Le même type de travail a été fait chez les carnivores et a conduit à un caryotype ancestral commun. La comparaison avec celui des platyrrhiniens a mis en évidence des similitudes et des différences s'expliquant par des inversions et des translocations.
La comparaison des chromosomes d'édentés, de l'ancêtre des carnivores, de l'ancêtre des plathyrrhiniens, de l'ancêtre des prosimiens, et de rongeurs a montré qu'il y a beaucoup de segments chromosomiques communs, mais aussi des différences. Ceci a permis de reconstituer le caryotype d'un ancêtre commun aux mammifères placentaires qui vivait il y a une centaine de millions d'années.
Ces comparaisons de caryotypes et ces caryotypes ancestraux permettent de reconstituer la phylogénie des espèces. La reconstitution de cette évolution chromosomique est basée sur la modification de la position des structures chromosomiques ou bandes. Chaque chromosome est une sorte de chapelet qui a évolué un peu pour son propre compte. En comparant l'évolution de chacun, il s'agit de trouver un schéma unique dans l'évolution.
Le principe peut être expliqué à partir d'un exemple où 5 modifications chromosomiques différencieraient le caryotype de 2 espèces de celui de leur ancêtre commun [figure 1].
Le premier chromosome est le même chez l'espèce A et l'espèce B mais est différent de celui du chromosome de l'ancêtre, qui est supposé connu.
Le chromosome 2 est modifié chez l'espèce A mais pas chez l'espèce B.
Le chromosome 3 est modifié chez l'espèce B mais pas chez l'espèce A.
Le chromosome 4 est modifié mais différemment à la fois chez l'espèce A et chez l'espèce B. Enfin, le chromosome 5 est modifié mais différemment à la fois chez l'espèce A et chez l'espèce B et la modification de B est intermédiaire entre l'ancêtre est celle de A.
Reporté sur un même schéma, nous constatons, que la modification du chromosome 1 est nécessairement sur un tronc commun avec celle du 5a. Celle du 2 est sur la branche de A et celle du 3 est sur celle de B, etc. Ainsi pourra-t-on reconstituer un schéma unique d'évolution.
Les caryotypes des primates comprennent 20 à 72 chromosomes et il y a plusieurs dizaines d'espèces. L'une des difficultés qui est apparue est que l'évolution ne fonctionne pas selon un schéma dichotomique. La dichotomie, la division simple, est une vision de l'esprit. En réalité, ça ne se passe pas comme ça. Une espèce ne naît pas d'un seul coup à partir d'une autre. Le plus souvent un remaniement va être partagé par deux espèces proches mais un autre sera partagé par l'une des deux et une troisième. L'embranchement n'est pas simple et il faut imaginer un tout autre système qui est une évolution en réseau. Qu'en est il lorsqu'on considère l'homme, le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan ?
La comparaison des remaniements chromosomiques entre l'homme, le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan conduit à un schéma par chromosome qui est pratiquement toujours différent de celui du chromosome précédent. Chaque chromosome a évolué pour son propre compte, comme les gènes [figure 2]. Il s'agit d'intégrer tous ces schémas dans un seul [figure 3].
La puissance de la cytogénétique réside dans le fait qu'elle considère l'ensemble du génome, l'ensemble des chromosomes, et qu'elle doit fournir des schémas cohérents avec toutes les observations. C'est une difficulté dans l'analyse mais un très gros avantage pour la qualité du résultat final. Il n'empêche que cette évolution n'est pas aussi simple qu'on l'aurait aimé. La comparaison de l'Homme, des deux espèces de chimpanzé, du gorille et de l'orang-outan, montre que trois remaniements sont communs au chimpanzé et à l'homme et qu'ainsi le chimpanzé est l'espèce la plus proche de l'homme. Néanmoins, trois autres remaniements sont partagés par le gorille et le chimpanzé. Pour conserver l'idée d'une évolution dichotomique, il faudrait imaginer qu'il y a eu convergence et que par hasard, dans cette partie de l'arbre de l'évolution, trois mêmes remaniements sont survenus dans deux branches différetes [figure
3.a]. Il est certain que cette interprétation n'est pas satisfaisante. L'autre interprétation [figure 3.b] est exactement la réciproque et elle n'est pas non plus très satisfaisante.
Ce qui est effectivement satisfaisant c'est d'arriver à un schéma où chaque remaniement n'est survenu qu'une fois [figure 3.c] avec des branches propres à chaque espèce. L'évolution a lieu dans une population, et ce n'est que progressivement à l'intérieur de cette population que sont localisées telles et telles anomalies chromosomiques. Une mutation apparaît dans une population et elle va se répandre comme l'onde d'une goutte qui tombe dans l'eau. Une autre mutation apparaît ailleurs dans la population et se répand de la même façon. Dans la population vont se créer des sortes d'hybrides avec deux mutations ou deux remaniements. Ainsi l'évolution ne marche pas d'un seul coup. Il n'y a rien de merveilleux qui permette qu'une espèce se forme à partir d'une autre en une génération.
Dans le schéma général [figure4], les cercopithèques représentent un exemple d'évolution en réseau. Pour qu'un phénomène de spéciation de ce type puisse se produire, il doit y avoir des hybrides, puisque des formes chromosomiques sont distribuées dans différentes branches de l'évolution. Cette théorie se vérifie sur le terrain puisque certains cercopithèques arboricoles vivent en groupes plurispécifiques. Dans la journée, des observateurs ont décrit des groupes formés de trois espèces différentes. La morphologie du mâle dominant était celle d'un hybride. Ces espèces se nourrissent en groupe et vivent ensemble toute la journée, mais le soir les animaux de chaque espèce vont dans un seul même arbre. Chaque matin le mâle dominant rameute tout le monde.
Notre ancêtre euthérien possédait environ 60 chromosomes, l'approximation portant sur quelques micro-chromosomes dont l'identification reste incertaine. Ces chromosomes ont été transmis tels quels aux ordres naissants de mammifères. De la sorte, il est impossible de proposer une filiation entre les ordres, aucune modification commune à deux ou plusieurs ordres n'étant repérée pour l'instant. Ces constatations mènent aux conclusions suivantes :
(1) à l'origine se trouvait une population de mammifères aux multiples potentialités évolutives, un peu comme la cellule à l'origine d'un individu est totipotente et susceptible de donner une descendance de plus en plus spécialisée pour former les tissus et organes qui le constituent ;
(2) à partir de cette population s'est créé un buissonnement, chaque tronc naissant étant rattaché à la base ;
(3) chaque émergence, à l'origine des futurs ordres de mammifères, s'est faite sans grand bouleversement des chromosomes. Cette dernière conclusion n'étaye pas certaines hypothèses imaginant une origine cataclysmique des mammifères soumis à des conditions extrêmes de climat et de radioactivité.
A ce stade, nous sommes donc à plus ou moins 100 millions d'années de l'hominisation, et le tronc évolutif qui nous rattache à nos racines paraît aussi banal que ceux rattachant les autres ordres de mammifères. Ce tronc est commun à tous les primates, et peu de modifications chromosomiques surviendront avant un premier clivage d'où naîtront deux groupes :
(1) les prosimiens [à droite sur la figure 4], surtout représentés par les lémurs de Madagascar et d'autres taxons africains et malaisiens. Ceux-ci se séparent de nous définitivement ;
(2) les simiens [à gauche sur la figure 4], ou singes proprement dits.
A nouveau, un tronc commun se forme pour tous les simiens. Peu de remaniements chromosomiques y surviennent, avant une seconde bifurcation majeure, séparant les futurs singes de l'ancien monde ou catarhiniens (CAT), auxquels nous sommes rattachés de ceux qui deviendront les singes du nouveau monde au platyrrhiniens (PLA). A nouveau, ces derniers se séparent irrémédiablement de nous. Prend alors naissance, vers -50 millions d'années un tronc commun à tous les catarhiniens, dans lequel s'accumulent de nombreuses modifications chromosomiques. Ceci suggère qu'une longue période s'est écoulée, durant laquelle beaucoup d'espèces se seraient formées et n'auraient donné comme descendance à long terme que nos propres lointains ancêtres. On s'attendrait à ce que de nombreux fossiles jalonnent cette longue période, mais ce n'est pas le cas. Une autre interprétation est donc possible, comme la survenue d'une période de forte instabilité, durant laquelle de multiples modifications chromosomiques se seraient produites sans association directe avec un phénomène de spéciation. Survient enfin un fait notable, vers -30 millions d'années : la séparation entre les ancêtres des cercopithécoïdes et des hominoïdes, mais à nouveau, il faudra que plusieurs remaniements chromosomiques s'installent pour parvenir à l'étape des derniers ancêtres des uns et des autres. Plus de soixante espèces se formeront chez les cercopithécoïdes, une dizaine chez les hominoïdes. Chez ces derniers, les gibbons se sépareront d'abord, puis l'orang-outang. Un dernier tronc commun mènera aux ancêtres que nous partageons avec les chimpanzés (il en existe 2 espèces) et le gorille. Ainsi, nous sommes, au plan évolutif, beaucoup plus proches des chimpanzés et du gorille que ces derniers ne sont proches de l'orang-outang. Nos ancêtres étaient donc des Pongidae, et ont subi les mêmes contraintes que ceux des grands singes actuels, du moins jusqu'à une date très récente. Pourtant, l'homme prolifère tandis que les grands singes disparaissent. Certes, l'homme a une responsabilité dans cette disparition, et c'est très regrettable, mais cette disparition ne peut lui être totalement imputée. Les aires de distribution de ces animaux ont toujours été limitées, et leur densité probablement toujours faible.
Ces animaux ont une faible capacité de reproduction. La raison en est leur grande taille, associée à leur longue période d'immaturité. Comme nous, un Pongidae n'est pubère que vers l'âge de 13 ans et n'a qu'un petit à la fois. Les femelles allaitent pendant 3 ans, ce qui entraîne une stérilité, de sorte que l'espace entre deux grossesses est de cinq ans en moyenne. Dans la nature, l'espérance de vie n'étant guère plus que 25 ans, cela ne laisse le temps que pour trois grossesses par femelle. Nos ancêtres Pongidae ont donc probablement vécu en populations réduites, ce qui expliquerait la difficulté de trouver des fossiles jalonnant l'histoire de nos lointains ancêtres. L'explosion démographique humaine, très récente à l'échelle de l'évolution, s'explique par notre organisation sociale, mais nous payons encore quelques tribus à notre évolution chromosomique. Le plus sérieux est la trisomie 21, ou mongolisme, mais pas comme cela a été avancé naguère, parce qu'elle marque un retour vers l'état simien. Cette affection est due à la mauvaise transmission du 21, qui est le plus petit de nos chromosomes. Il s'est formé voici 30 à 50 millions d'années, et s'est réassocié à d'autres chromosomes chez tous les Cercopithecoïdes et tous les gibbons sauf un, mais ni chez les Pongidae ni chez l'homme. Cette réassociation, ou translocation, formant un grand chromosome dont la trisomie est incompatible avec la vie, a débarrassé ceux qui la portent de la trisomie 21 [figure 5].
Cette translocation, avant qu'elle ne passe en 2 copies (état homozygote), comme pour tous les chromosomes, doit nécessairement exister en une seule copie (état hétérozygote). Ceci entraîne une période à haut risque d'aberrations chromosomiques [figure 6], comme on l'observe aujourd'hui, chez les femmes porteuses d'une telle translocation. Cet état hétérozygote, qui réduit considérablement la descendance, est éliminé et ne permet pas le passage à l'état homozygote si la fertilité est réduite. Ainsi, l'accroissement de taille, associé à une puberté tardive et à l'espacement des grossesses, est responsable d'une fertilité réduite et probablement du maintien du chromosome 21, et de sa trisomie. Celle-ci, qui ne touche qu'un descendant sur
700, ne constitue pas un facteur sélectif à l'échelle de l'évolution. Par contre, elle constitue une affection redoutée, que notre société n'a pas encore appris à gérer. La trisomie 21 n'est qu'un exemple parmi d'autres affections dont les racines se trouvent dans l'origine de nos chromosomes.
VIDEO CANAL U LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
L'ADN : DÃCHIFFRER POUR MIEUX COMPRENDRE LE VIVANT |
|
|
| |
|
| |

L'ADN : DÉCHIFFRER POUR MIEUX COMPRENDRE LE VIVANT
La cellule, le patrimoine génétique
La brique élémentaire de tous les êtres vivants est la cellule. Elle renferme en son sein une molécule qui porte son patrimoine génétique.
Publié le 25 janvier 2018
Les êtres vivants ont pu s’adapter à tous les milieux et coloniser l’ensemble des écosystèmes marins et terrestres ! Que ce soit une bactérie, un homme, un lichen ou une sauterelle, tous les organismes ont quelque chose en commun : la cellule. Autonome, elle vit, se reproduit et meurt.
AU CŒUR DE LA CELLULE
Les cellules sont les plus petites unités du vivant. Pour les voir, il suffit d’un microscope car une cellule animale mesure en moyenne 20 micromètres. Elles se classent en deux types : les procaryotes et les eucaryotes. Les premières, de simples poches de liquide contenant des biomolécules, délimitées par une membrane et ne comportant pas de noyau, sont dites “ primitives ”. Les bactéries sont les principaux représentants de cette confrérie. Les cellules eucaryotes sont plus organisées, avec différents compartiments ayant chacun un rôle à jouer, comme le noyau.
1 - Le noyau : centre de contrôle de la cellule. Il contient le matériel génétique sur lequel est inscrit le mode d'emploi de tout organisme. Chaque cellule utilise le génome d'une façon différente. Elle a son propre mode d'emploi.
* 2 - Les lysosomes : centres de recyclage. Ce sont de petits sacs qui concentrent les substances à détruire et les enzymes nécessaires à cette destruction.
* 3 - Les ribosomes : usines de production des protéines. Ils synthétisent des protéines à partir des instructions données par le noyau.
* 4 - L'appareil de Golgi : centre de tri. Dans ces sacs empilés les uns sur les autres s'achève la préparation de protéines synthétisées dans la cellule en vue de leur exportation.
* 5 - Le cytoplasme : agora de la cellule. Délimité par la membrane plasmique, le cytoplasme est constitué d'eau et de biomolécules et contient les divers organites cellulaires (noyau, mitochondries…).
* 6 - Les mitochondries : centrales énergétiques. Elles sont le siège de la respiration cellulaire et de la production d'énergie.
L’Homme est composé de 5 000 à 30 000 milliards de cellules.
* Au sein d’un organisme, les cellules peuvent avoir des formes et des fonctions différentes mais elles contiennent toutes, dans leur noyau, les mêmes informations génétiques, le même patrimoine. Chez les eucaryotes pluricellulaires, les cellules sont réunies en tissus. Un tissu est composé de plusieurs types de cellules avec des fonctions bien distinctes, mais il y a souvent un type cellulaire prédominant remplissant la même fonction, comme les hépatocytes dans le foie.
*
* Différents tissus peuvent s’associer pour former un organe et plusieurs organes peuvent contribuer à une même grande fonction physiologique. Les cellules germinales sont fabriquées par l’appareil reproducteur. De l’union du patrimoine génétique d’un spermatozoïde et de celui d’un ovule naîtra un nouvel individu. Les cellules de l’œuf se multiplieront et se différencieront pour produire les centaines de lignées de cellules spécialisées, dites somatiques, qui constitueront la peau, le cerveau, le tube digestif… de ce nouvel individu.
*
* D’après la découverte de fossiles de stromatolithes1 dans les lagunes australiennes, la vie aurait commencé sur Terre il y a 3,5 milliards d’années. De la bactérie unicellulaire à l’Homme, composé de pas moins de 30 000 milliards de cellules, le Vivant n’a cessé d’innover !
*
1 : Stromatolithes : constructions fossiles, formées en général par des cyanobactéries (algues bleues), qui existent encore à l'heure actuelle.
Les différents types de cellules
Les différents types de cellules. © Victoria Denys/CEA
Les deux types de division
Les deux types de division. © Victoria Denys/CEA
La mitose, une division cellulaire
Nb : ce contenu existe également en version interactive à cette adresse (requiert flash).
Votre navigateur ne permet pas de lire des vidéos.
télécharger : version vidéo | version flash interactive VOIR DANS LA MÉDIATHÈQUE
Chez l'Homme, les cellules souches (indifférenciées) et les cellules somatiques (différenciées et spécialisées) se multiplient par mitose pour donner deux cellules identiques, dites diploïdes, contenant 23 paires de chromosomes. Les cellules germinales (cellules sexuelles ou gamètes), quant à elles, doivent subir deux divisions successives (méiose) pour donner des cellules, dites haploïdes, avec un seul exemplaire de chacun des 23 chromosomes. Lors de la fécondation, les deux gamètes fusionnent pour générer un œuf diploïde. Le mélange de 50 % du patrimoine de la mère avec 50 % du patrimoine du père est appelé brassage génétique. La reproduction sexuée augmente la biodiversité et par conséquent le potentiel adaptatif de l'espèce.
LE CYCLE CELLULAIRE
En 24 heures, depuis sa naissance jusqu’à sa division ou sa mort, une cellule suit un cycle de 4 phases.
* La première, notée G1, correspond à sa croissance. Pendant ce temps, plus ou moins long, la cellule exerce ses fonctions ordinaires sans produire de nouvel ADN.
* La seconde étape, S, est celle de la synthèse de l’ADN et de la réplication chromosomique.
* Lors de la phase G2, la cellule s’assure que la réplication s’est bien passée.
* Puis elle déclenche la dernière phase, celle de la division cellulaire.
L'ADN
Histoire de lu vivant et de l'ADN
L’enquête a commencé au siècle des Lumières par des observations macroscopiques sur la biodiversité. Les explorateurs rapportent de nouvelles espèces que Carl Von Linné, Georges Cuvier et Georges Buffon nomment et classent selon les caractères propres à chacune (nombre de membres, bipédie,
poils, plumes…). Puis Jean-Baptiste de Lamarck invente la biologie ; il est le premier à comprendre que les espèces évoluent. Au XIXe siècle, Charles Darwin émet l’idée qu’un caractère possède une certaine variabilité au sein d’une
population et que la sélection naturelle conserve les variations les plus favorables, dans un contexte donné ou un environnement spécifique.
En 1866, dans le potager de son abbaye, le moine Gregor Mendel découvre que certains caractères sont héréditaires : c’est la naissance de la génétique.
En 1952, la scientifique Rosalind Franklin parvient à “ photographier ” une molécule d’ADN et émet l’hypothèse de sa structure en double hélice. La reprise de ces travaux par Francis Crick et James Watson ouvre la voie à la biologie moléculaire.
L'ADN, vecteur de l'hérédité
Le noyau, de forme sphérique, est l'organite le plus volumineux de la cellule. Ses 5 micromètres de diamètre permettent de l’observer en microscopie optique. Une goutte de vert de méthyl suffit à révéler son principal constituant, l’Acide DésoxyriboNucléique (ADN). C'est la molécule support du patrimoine génétique de tout être vivant. La longue chaîne d’ADN est composée d'une succession de nucléotides (contenant des bases) accrochés les uns aux autres par des liaisons phosphodiester. Les 4 bases qui composent l’alphabet du programme génétique sont A, T, G et C.
La molécule d’ADN en version 3D est un assemblage de deux chaînes hélicoïdales (ou brins) s’enroulant autour d’un axe. Cette double hélice est maintenue grâce aux liaisons hydrogène entre les bases qui se font face. Ces bases, dites complémentaires (A s’apparie avec T et C avec G) forment comme les barreaux d’une échelle. Les deux brins d’un ADN donnent donc la même information, comme une photo et son négatif.
Dans les gènes, une suite de trois lettres forme un mot, ou codon. Les mots forment des phrases ou des instructions qui sont à l’origine des caractères héréditaires. La plupart du génome reste non lisible.
Deux êtres humains qui n'ont aucun lien de famille ont 99,9 % d'ADN en commun.
LES CHROMOSOMES, SUPPORTS MATÉRIELS DES GÈNES
Caryotype d'une cellule humaine, par hybridation en fluorescence. © Steven M.Carr
Au moment de la division cellulaire, l’ADN se compacte autour de protéines et s’organise en bâtonnets visibles, les chromosomes. Chaque espèce possède un nombre constant et spécifique de chromosomes : 46 pour l’Homme, 24 pour le riz, 8 pour la mouche… Chez la bactérie, il n’y en a qu’un et il est circulaire ! Si la cellule est stoppée pendant sa division, il est possible de réaliser un caryotype, sorte d’instantané de ses chromosomes. Ceux-ci sont découpés puis classés selon une numérotation internationale. Par exemple, un caryotype sert à identifier le sexe d’un individu (chromosome 23 XX - femelle ou XY - mâle) ou à détecter certaines anomalies, comme la trisomie 21 (3 copies du chromosome 21).
Un chromosome humain débobiné mesure un mètre d’ADN ! Sur ce mètre étalon, certaines fractions sont des instructions qui commandent la synthèse de protéines ; ce sont les gènes. Unités de base de l’hérédité, ils déterminent ce que nous sommes et comment nous fonctionnons (couleur des yeux, groupe sanguin…).
LE COMPLEXE DU GÉNOME
Organisme Nombre de chromosomes Taille du génome en millions de bases Nombre de gènes
Homme 46 3300 21000
Riz 24 430 37000
Mouche 8 165 13000
Un organisme complexe, comme l'Homme, a-t-il un plus gros génome et plus de gènes qu'un organisme " moins évolué " ?
C'est globalement vrai quand on compare les procaryotes (bactéries) aux eucaryotes (plantes, animaux…). Cependant, chez les eucaryotes, le paradoxe existe. L'Homme a à peine deux fois plus de gènes que la mouche et moins qu'un grain de riz ! Il n'existe pas de relation entre la complexité d'un organisme et le nombre de gènes ou la taille de son génome.
LES GÈNES
Il existe environ 21 000 gènes chez l'Homme. La plupart des gènes codent pour des protéines qui jouent un rôle particulier dans notre organisme. Certaines participent au transport, à la signalisation cellulaire… D'autres, comme les enzymes, réalisent des réactions chimiques. Deux étapes sont nécessaires à leur fabrication : la transcription et la traduction.
1 - La transcription
Pour fabriquer une protéine, le gène va transmettre son mode d'emploi du noyau au cytoplasme grâce à une molécule navette, l'ARN messager (ARNm). Pour cela le gène est transcrit en un ARNm qui est sa copie exacte ; à un détail près : la base T est remplacée par une base spéciale, la base uracile (U). Les ARNm sont transformés pour enlever des parties non-codantes.
2- La traduction
Une fois dans le cytoplasme, l'ARNm va rejoindre les usines à protéines, les ribosomes. Dans celles-ci seront assemblés les constituants de base d'une protéine, les acides aminés selon la séquence donnée par l'ARNm. Mais comment passer d'un alphabet de 4 lettres (A, U, C, G) à une protéine ? Chaque acide aminé correspond à un ou plusieurs codons. Un troisième acteur, l'ARN de transfert (ARNt), reconnaît spécifiquement le codon de l'ARNm qui correspond à l'acide aminé qu'il porte. Ainsi, le ribosome glisse le long de la séquence de l'ARNm, et assemble les acides aminés apportés au fur et à mesure par les ARNt. Le ruban protéique se replie au cours de sa synthèse pour prendre in fine une conformation tridimensionnelle qui lui confère ses propriétés et sa fonction.
LES ALLÈLES
Chez l’Homme, les chromosomes vont par paire ! Pour chaque paire, ils sont identiques, portent les mêmes gènes. Cependant, il peut y avoir plusieurs versions, ou allèles, d’un même gène. Les combinaisons de deux allèles identiques ou différents donnent le génotype de l’individu. Par exemple, pour déterminer le groupe sanguin, il existe 3 versions du gène : l’allèle A, B et O ; ce qui donne AA, AB, AO, BB, BO ou OO. A et B sont dominants sur O ; A et B sont co-dominants et O est récessif. Le génotype AA donnera le phénotype [A]
Le génotype AB donnera le phénotype [AB]
Le génotype AO donnera le phénotype [A]
Le génotype BO donnera le phénotype [B]
Le génotype OO donnera le phénotype [O]
Le génotype BB donnera le phénotype [B]
Les phénotypes sont le résultat de l’expression des génotypes.
Chez les procaryotes, dont les cellules sont dépourvues de noyau, plus de 90 % du génome codent pour une protéine. Chez les eucaryotes, ce sont seulement 2 %. Les 98 % restants ont été longtemps appelés à tort “ ADN poubelle ” ; leur rôle n’est pas encore complètement élucidé, mais une partie servirait à réguler les gènes.
La déclinaison d'un gène ou comment conjuguer les allèles
Quand vous verrez un chat à 3 couleurs, pariez avec vos amis que c’est une femelle ! Vous gagnerez à tous les coups.
Explications : Les gènes sont à l’origine des caractères héréditaires comme la couleur du pelage des chats. Il existe plusieurs versions d’un gène que l’on appelle allèles.
Dans notre exemple, l’allèle redo confère la couleur orange et red° la couleur noire. Chaque gène, porté par les deux chromosomes d’une même paire, existe donc en deux exemplaires, une combinaison de 2 allèles qui détermine le génotype. Chez les chats, le gène de la couleur du poil est porté par le chromosome sexuel “ X ”. Un mâle (XY) ne possède qu’un seul chromosome X. Il ne peut donc exprimer qu'un seul a
llèle ; il est redo (orange) ou red° (noir). Une femelle (XX), quant à elle, présente une des 3 combinaisons d’allèles ou génotypes possibles : redo/redo, redo/red° ou red°/red° ; le phénotype couleur du pelage [noir et orange] n’apparaît donc que chez la femelle.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
HOMMES ET HOMINIDÃS |
|
|
| |
|
| |

HOMMES ET HOMINIDÉS
Il s'agit d'explorer la dichotomie entre les grands singes et l'Homme et comment comprendre cette divergence aujourd'hui. En consultant les médias, on voit souvent évoquer le fait que l'Homme partage 99% de son matériel génétique avec le chimpanzé. Les Hommes et les chimpanzés, mais aussi les gorilles, sont extrêmement similaires. Les travaux en biologie moléculaire nous permettent de dire qu'il y a environ 7 millions d'années, à la fin du miocène, les ancêtres des humains, des chimpanzés et des gorilles actuels sont partis sur leurs propres chemins évolutifs et leurs propres régions géographique.
Quelles sont les certitudes, les interrogations concernant cette évolution ? Il est impossible de vraiment trancher pour savoir qui du chimpanzé ou du gorille et plus proche de l'Homme. Il s'agirait plutôt d'une trichotomie au sein d'une même population. Le problème peut être abordé sous plusieurs aspects : anatomique, géographique et climatique, environnemental qui façonnent les êtres fossiles et qui ont fait ce que nous sommes avec nos variabilités physiques et culturelles.
Texte de la 439e conférence de l'Université de tous les savoirs donnée le 18 juillet 2002
Grands singes - Hommes : histoire d'une divergence
Par Brigitte Senut,
La divergence entre les grands singes et l'homme est un des sujets les plus discutés de la paléontologie humaine, probablement car il touche directement à nos origines. Les données permettant d'appréhender cette séparation sont fournies par toute une série de disciplines allant de la paléontologie, la géologie, la sédimentologie à la biologie moléculaire. Car il faut, en effet, resituer cette question évolutive dans un cadre bio-éco-géographique plus vaste, plutôt que de se limiter à un cadre anatomique. Les résultats des différents domaines ne concordent pas toujours, c'est ainsi souvent le cas de la biologie moléculaire et de la paléontologie, car les données néontologiques ne prennent pas la dimension essentielle de l'évolution, la quatrième dimension : le temps. L'étude des grands singes et des hommes actuels nous permet de clarifier les relations de parenté, mais le tempo de leur histoire ne nous est fourni que par la paléontologie. Les données de terrain très fructueuses ces dix dernières années nous obligent à remonter au-delà de 6-7 millions d'années, pour comprendre la manière dont la lignée des grands singes s'est isolée de celle de l'homme. Quelles sont ces nouvelles découvertes? Quels sont les nouveaux enjeux? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre dans la suite de cet exposé.
L'apport de la biologie moléculaire
La phylogénie en question
Les molécularistes et les paléontologues s'accordent aujourd'hui sur le fait que les grands singes asiatiques sont des parents relativement éloignés de nous, alors que leurs cousins africains semblent nous être plus proches ; mais au sein de ces derniers, peut-on isoler un genre une espèce plus privilégiée? En d'autres termes, le chimpanzé est-il notre plus proche cousin ? Est-ce le bonobo (ou chimpanzé nain) ? Ou bien l'ensemble gorille-chimpanzé ? Ou bien les chimpanzés, les gorilles et les hommes sont-ils aussi éloignés les uns des autres ? Selon les méthodes d'analyses, il apparaît que tous ces schémas sont possibles. Toutefois, certains auteurs ont largement médiatisé un rapprochement exclusif chimpanzés-hommes. Ceci serait conforté par les études sur l'ADN et l'ADN mitochondrial, alors que d'autres travaux révèlent des branchements différents. Ce qui reste sûr aujourd'hui est que les plus proches parents de l'homme sont africains et que leur ancêtre est, lui aussi, plus vraisemblablement africain.
L'horloge moléculaire
Le concept d'horloge moléculaire est basé sur la constatation que la mesure des divergences des séquences d'acides aminés est corrélée au temps. Les changements sont censés s'opérer à des rythmes constants à partir d'une date de divergence paléontologique donnée (soit celle des ruminants, soit celle des cercopithèques, etc.) ; ce n'est donc pas une méthode indépendante. Or, selon les auteurs, ou selon les groupes utilisés pour calibrer, les résultats sont très différents et on a obtenu des dates variant de 2 millions d'années à plus de 15 millions d'années pour la dichotomie hommes/grands singes. Toutefois, il a été démontré que l'horloge moléculaire ne marche pas, en fait, à vitesse constante. Le taux auquel les changements sont incorporés dans les populations varient en fonction des temps de génération, l'isolation génétique etc. C'est pourquoi, l'horloge est différente entre les éléphants et les souris, il est évident que la souris se reproduisant plus vite, le renouvellement génétique est plus rapide. Par ailleurs, il y a une variation au sein d'une même espèce. La même chose est vraie au sein des primates si on compare des lémuriens ou des chimpanzés. Enfin, il apparaît que sur de longues périodes, l'horloge devient imprécise. L'horloge moléculaire ne marche pas donc pas à la même vitesse dans tous les groupes de mammifères et pour dater les divergences, il convient donc d'utiliser les données temporelles fournies par les fossiles.
Les grands singes et leurs caractères de vie.
Dimorphisme sexuel
Les grands singes de grande taille se caractérisent généralement par de forts dimorphismes de taille et de morphologie liés au sexe. Un des caractères les plus utilisés chez les primates est la canine. Chez les mâles, la racine est massive et a pratiquement la même taille que la base de la couronne. Chez les femelles, la racine plus petite est rétrécie à la base de la couronne. Ce caractère s'observe chez les grands singes actuels et fossiles. Par ailleurs, chez les mâles, les racines étant beaucoup plus grandes, le museau est gonflé et aussi plus projeté vers l'avant, ce qu'on appelle le prognathisme. Quelquefois, cette projection est si importante que la morphologie faciale des mâles et des femelles est aussi très différente. C'est ce qui rend souvent l'interprétation des fossiles isolés difficile. C'est le cas notamment du fameux Kenyapithèque du Kenya considéré longtemps comme un hominidé ancien car sa canine était petite et sa face peu projetée. Or, la une nouvelle études de ces matériels a montré que les spécimens incriminés appartenaient en fait à des individus femelles et Kenyapithecus était une forme éteinte de grand singe, pas placée en position particulière dans notre arbre phylogénétique. La même chose est arrivée avec les Ramapithèques asiatiques. Mais il est intéressant de constater que de nombreux spécimens sensés être nos ancêtres étaient en fait des femelles de grands singes et que les ancêtres de grands singes étaient de mâles... ! C'est le cas typique du groupe des Sivapithèques et Ramapithèques: les premiers ont été considérés comme des ancêtres des orangs-outans et les Ramapithèques, ancêtres de l'homme. Toutefois, lorsque les études sur le dimorphisme sexuel ont été développées au début des années 1980, on s'est rendu compte que les ramapithèques étaient les femelles des sivapithèques, ancêtres des grands singes de Bornéo et Sumatra. Cela allait même plus loin, car le genre Sivapithecus ayant été créé bien avant que celui de Ramapithecus, ce dernier nom devait être abandonné. Les ramapithèques qui avaient eu leur heure de gloire dans les années 1960 à 1980, disparaissaient du paysage paléontologique par le coup du dimorphisme sexuel.
Alimentation
Les primates actuels sont parmi les mammifères les plus diversifiés dans leur alimentation. Ayant accès à toutes les strates des canopées, comme au milieu terrestre, ils se nourrissent de feuilles, et/ou de fruits, et/ou de viande. Il n'est pas rare que les chimpanzés mangent des petites antilopes ou des petits cercopithèques. La morphologie dentaire observée reflète le mode d'alimentation le plus fréquent, mais un animal peut de temps à autres adapter son régime à ce que lui offre son environnement. Les gorilles sont inféodés à des milieux forestiers et se nourrissent de végétaux variés, herbacées et fruits. Le régime alimentaire peut être déduit non seulement des dents, mais aussi des os maxillaire et mandibulaire et de leurs insertions musculaires. Sur l'anatomie des dents, la morphologie des cuspides est assez typée chez les chimpanzés avec des tubercules placés à la périphérie de la couronne et montrant un grand bassin central ; et chez les gorilles avec des tubercules placés à la périphérie mais plus acérés et un bassin central moins élargi. Chez l'homme, qui est un hominoïde à part entière, les tubercules sont globuleux, assez bas et plus centraux. Un autre aspect de la morphologie dentaire concerne l'émail : la variation de son épaisseur reflète également la qualité de ce que l'animal ingère ; ainsi si l'animal consomme plus fréquemment des fruits, l'émail est plus fin et s'il consomme des aliments plus coriaces, l'épaisseur de l'émail est plus épais. En gros, cela semble vrai, mais il faut aussi prendre en compte la surface triturante de la dent, sa croissance et donc sa taille. Les replis de l'émail plus prononcé chez les chimpanzés nous apportent aussi des informations sur le style de nourriture qu'ingurgitent les grands singes. On voit tout l'intérêt de bien comprendre les morphologies actuelles pour déduire des interprétations sur les fossiles.
Locomotion
Les modes de locomotion sont aussi très diversifiés chez les grands singes puisqu'ils varient de la suspension, au grimper vertical, marche sur les branches sur les quatre pattes arrière ou sur les deux pattes arrière. Mais les grands singes pratiquent aussi une marche particulière appelée le knuckle-walking, littéralement la marche sur l'articulation des phalanges antérieures repliées.
C'est le mode classique de déplacement des chimpanzés, qui est un peu modifié chez les gorilles, beaucoup plus lourds. Le mode de déplacement est lié en grande part à la taille de l'animal : ainsi, un gorille mâle de plus de 200 kgs peut difficilement se suspendre aux branches d'arbres, alors que le petit beaucoup plus léger en sera capable. Mais aucun de ces grands singes n'est assez léger pour pratiquer le déplacement acrobatique adopté par les gibbons d'Asie du Sud-Est. Un mode de déplacement utilisé par tous les grands singes plus ou moins fréquemment ou plus ou moins occasionnellement est la marche bipède. Aujourd'hui, le seul hominoïde capable de se déplacer pour la plus grande partie de son temps sur ses deux pattes arrière est l'homme. L'adaptation à la bipédie permanente est un des caractères qui est généralement utilisé pour définir le genre Homo. Chez les fossiles, on observe des bipédies différentes de celles de l'homme actuel, celle des Oréopithèques de Toscane étant probablement la plus éloignée de la nôtre, celle des Australopithèques en étant la plus proche. Les paléontologues n'ont pas à leur disposition tous les ligaments, muscles, etc... , mais l'os enregistre le mouvement le plus fréquemment réalisé ; et par comparaison avec les animaux actuels on peut reconstituer des types de mouvements, puis des associations de mouvements qui débouchent sur des scénarios locomoteurs. Pendant près d'un siècle, les anthropologues ont focalisé leurs travaux sur les restes crâniens et dentaires, parties nobles du squelette pour reconstituer les scénarios de nos origines, mais depuis la fin des années 1970, on s'aperçoit que les modes de locomotion apporte eux aussi des informations à cette quête, et ils sont aujourd'hui considérés comme des éléments à part entière. En fait, la reconstitution des modes locomoteurs passés est essentielle.
Les grands singes fossiles
Les grands singes fossiles sont connus dès l'Oligocène supérieur en Afrique orientale et sont représentés par quelques pièces dentaires attribuées à Kamoyapithecus. Mais c'est au Miocène inférieur que les grands singes vont s'épanouir en Afrique. Si pendant longtemps, on les a cru confinés à l'Afrique orientale, on les a retrouvés au début des années 90 en Egypte, puis en Afrique du Sud en 1996. Les restes extérieurs à l'Afrique orientale sont très peu nombreux : un humérus en Egypte au Wadi el Moghara et une demi-dent supérieure dans la mine de diamants de Ryskop en Afrique du Sud. En raison de leur faible nombre, ils n'ont pas pu être nommés formellement.
En Afrique orientale, par contre, on connaît de très nombreux grands singes de grande taille (dont certains équivalents à un gorille) et de petite taille (proche de celle des gibbons). Nous nous focaliserons sur ceux de grande taille parmi lesquels nous recherchons nos ancêtres.
Les plus connus des grands singes de la période de 22 à 17 Millions d'années environ sont les Proconsul. Très bien représentés au Kenya et en Ouganda par plusieurs formes qui ont la taille des chimpanzés et colobes actuels. Ce sont des grands singes généralisés par leur dentition et leur locomotion. Probablement adaptés à un régime plutôt frugivore, ils habitaient dans des environnements de forêt sèche où ils se déplaçaient à quatre pattes sur les branches, ou au sol. Ces reconstitutions sont basées sur les restes de plantes, de grands mammifères, de micromammifères et ceux d'escargots fossiles, notamment des très riches gisements de l'île de Rusinga au Kenya.
A la même époque les Ugandapithecus, de la taille du gorille, vivaient sur les pentes des volcans de Napak en Ouganda et à Songhor au Kenya. Assez lourds, ils vivaient probablement en partie au sol, mais ils pratiquaient également un grimper vertical. Leurs canines présentent un caractère tout particulier : le sommet de la dent est en forme de lame plutôt que conique. Leurs dents assez massives suggèrent qu'ils se nourrissaient de nourritures assez coriaces. Les Ugandapithèques sont connus jusqu'à la base du Miocène moyen (16-17 Millions d'années) en Afrique orientale, et spécialement sur le gisement de Moroto en Ouganda où ils côtoient les Afropithèques, de taille plus modeste, découverts également sur la rive occidentale du Lac Turkana au Kenya. Entre 17 et 12 millions d'années les grands singes connaissent un second buissonnement avec les Turkanapithèques du Lac Turkana, les Nacholapithèques des Collines Samburu. Dans les gisements de l'île de Maboko on trouve les Kenyapithèques, dont l'espèce présente à Fort Ternan ( Kenyapithecus wickeri) sera considérée, dès sa découverte, comme un hominidé ancien. Cependant, les caractères utilisés à l'époque (petite canine, face plate, émail épais) se sont avérés, pour les premiers, des caractères de dimorphisme sexuel et, pour le dernier, un caractère classique des grands singes du Miocène moyen dont les l'alimentation est basée sur des végétaux plutôt durs. Le Kenyapithèque de Fort Ternan avait aussi été considéré comme un hominidé sur la base de présence de galets utilisés trouvés avec les fossiles. Toutefois, ces cailloux « utilisés » se sont avérés être des pierres de lave brisés naturellement. Par ailleurs, on sait aujourd'hui que d'autres primates utilisent des outils ou manipulent et cela ne leur donne pas automatiquement le statut d'hominidé.
Après avoir longtemps été considérés comme des animaux typiquement est-africains, les grands singes voyaient leur aire de répartition considérablement augmentée par la découverte d' Otavipithecus namibiensis au nord-est de la Namibie. Ils avaient toutefois été signalés en 1975 en Arabie saoudite qui, à l'époque où ils vivaient, était rattachée à l'Afrique orientale. L'Otavipithèque ne ressemble à aucun des grands singes classiques est-africains de l'époque, par sa mâchoire étroite, ses dents aux cuspides gonflées, mais cela n'est pas surprenant car il vivait dans une région très excentrée, par rapport à celle où vivaient les autres grands singes de la même époque.
C'est probablement vers ce moment-là que les grands singes vont émigrer vers l'Eurasie; ainsi, on les retrouve en France, en Espagne, en Hongrie, en Grèce, en Inde, au Pakistan, en Turquie, en Chine... où ils prennent les noms de Dryopithèques, Ankarapithèques, Sivapithèques, Ouranopithèques, Lufengpithèques, etc... Certains d'entre eux, bien que considérés par plusieurs auteurs comme des ancêtres potentiels des Hominidés, semblent plus probablement se rapprocher des grands singes asiatiques modernes. Les caractères utilisés pour en faire des Hominidés se sont avérés être souvent des caractères hérités des grands singes africains antérieurs et non pas dérivés d'Hominidés, et dans certains cas dérivés d'Orangs-outans ou même encore liés au dimorphisme sexuel observé classiquement chez les grands singes actuels et fossiles.
Le trou noir- la divergence
Le trou noir correspond à cette période pendant laquelle nous ne connaissions pratiquement rien au début des années 1990 entre les grands singes du Miocène et les premiers Hominidés avérés, les Australopithèques, c'est à dire environ entre 10-12 millions d'années et 4,2 millions d'années. A l'époque, les quelques pièces fossiles, toutes kenyennes, pouvaient se compter sur les doigts des deux mains: un fragment de maxillaire trouvé au début des années 80 dans les Samburu Hills et vieux de 9,5 millions d'années, une dent isolée dans la Formation de Lukeino datée de 6 millions d'années, un fragment d'humérus vieux de 5,1 millions d'années, un fragment de mandibule à Tabarin vieille de 4,5 millions d'années, un fragment de mandibule à Lothagam (aujourd'hui redatée à 4,2 millions d'années environ). Les nombreuses expéditions menées en Afrique depuis la dernière décennie ont pratiquement triplé le matériel connu au début des années 1990; il n'est donc pas surprenant que les scénarios de nos origines soient largement discutés. A part le maxillaire des Samburu, tous ces fossiles étaient rapportés aux Hominidés. Dans tous les scénarios évolutifs ces restes ont été considérés comme appartenant obligatoirement à des ancêtres des Australopithèque et donc des Hominidés. En fait, les chercheurs dans leur grande majorité ont focalisé leurs travaux sur les Australopithèques et toute pièce hominidée trouvée dans des niveaux plus anciens était systématiquement considérée comme un ancêtre de ceux-ci et donc des hommes. L'évolution était linéaire, ce qui malheureusement ne semble pas très biologique. En effet, jusqu'à 12 millions d'années environ, les grands singes sont largement représentés en Afrique; il faudrait donc admettre que ces derniers disparaissent pour laisser la place à une seule lignée et que celle-ci soit obligatoirement ancestrale à l'homme. Cette interprétation nie le phénomène de radiation chez les grand singes et les hominidés anciens. Vers 6 millions d'années environ, on sait que les grands groupes de mammifères sont très diversifiés et il est probable que les primates (grands singes et hommes inclus) n'ont pas échappé à la règle.
Samburupithecus
Le premier acteur dans ce trou noir est Samburupithecus; découvert au début des années 1980 dans les Samburu Hills au Kenya (mais publié seulement en 1994), il est connu exclusivement par un fragment de maxillaire portant les 2 prémolaires et les 3 molaires. Par certains aspects, il rappelle les gorilles, notamment pas la morphologie de son museau, la position de l'arcade zygomatique relativement basse et antérieure sur la mâchoire. Les tubercules de ses dents sont, en revanche, gonflés; il s'agit sans doute d'une femelle comme le suggère l'alvéole préservée de la canine qui indique que la racine de cette dernière était petite. Par ses caractères, cette pièce pourrait être considérée comme un ancêtre des grands singes et de l'homme, ou un ancêtre de gorilles, mais il faut plus de matériel pour conclure.
Ardipithecus ramidus
En 1994/1995, Ardipithecus ramidus, vieux de 4,4 millions d'années venait combler une lacune dans l'histoire de la dichotomie des grands singes et de l'homme. Découverts en Ethiopie dans la Vallée moyenne de l'Aouache, les restes attribués à cette espèce se composent de dents isolées, de quelques os postcrâniens fragmentaires un petit fragment crânien et un squelette partiel qui n'est toujours pas publié. Ces éléments furent rapportés à un hominidé, mais si certains caractères de ses canines l'en rapprochent effectivement, toute une suite d'autres l'en isolent comme l'épaisseur de l'émail dentaire ou la taille de la canine par rapport aux dents jugales. Le squelette indiquerait une adaptation à la bipédie, mais les restes publiés à ce jour ne permettent pas cette affirmation. Ardipithecus ramidus est-il un hominidé ou un grand singe? Il est bien difficile de conclure à la lueur des éléments disponibles.
Orrorin tugenensis
A l'automne 2000, une douzaine de restes dentaires, mandibulaires et postcrâniens d'un hominidé étaient trouvés dans la Formation de Lukeino au Kenya qui avait déjà livré une dent isolée en 1974. Les gisements qui ont livré les fossiles s'échelonnent dans le temps entre 6,0 et 5,7 millions d'années; le gisement le plus riche étant celui de Kapsomin situé à la base de la formation. Les dents en général sont petites, proches en taille de celles de chimpanzés et des hommes actuels, mais leur forme plus carrée les rapproche des seconds. La morphologie de la canine supérieure portant une gouttière verticale ou la première prémolaire inférieure avec ses racines décalées rappelle la morphologie observée chez les grands singes actuels et fossiles. Toutefois, les tubercules dentaires ne présentent pas les ridulations d'émail classique chez les grands singes, la morphologie de la canine inférieure est intermédiaire entre celle des grands singes et celle de l'homme, l'émail est épais, la face interne des molaires est verticale. La partie antérieure de la mandibule est droite et on n'observe aucun espace (diastème) entre la canine et la première prémolaire inférieures. L'ensemble des caractères dentaires rapprochent Orrorin des hominidés.
La découverte d'Orrorin était importante également par le fait que des restes postcrâniens étaient signalés, dont des fémurs relativement bien conservés. C'est l'étude du fémur qui a montré que Orrorin était bipède. Ceci s'exprime par un col fémoral allongé et aplati antéro-postérieurement, la position de la tête fémorale, la position des insertions musculaires, la distribution de l'os cortical (épaissi à la partie inférieure et plus mince à la partie supérieure) sur la coupe du col fémoral, et la présence en vue postérieure d'une gouttière pour le muscle obturator externus. La plupart de ces caractères sont présents chez les Australopithèques et l'homme et sont classiquement associés à la bipédie. Cependant, certaines différences d'avec les Australopithèques (en particulier, orientation de la tête fémorale, position du petit trochanter) et une meilleure ressemblance avec les hommes indiquent que cette bipédie est plus humaine que celles de Australopithèques. Cet hominidé pratiquait donc probablement habituellement la bipédie; toutefois, il n'est pas encore affranchi du milieu arboré, comme le montrent son humérus et ses phalanges de main.
Orrorin n'est pas un être petit puisque les mesures de son humérus et de son fémur indiquent qu'il était une fois et demie plus grand que Lucy, la célèbre Australopithèque de l'Afar. Cette dernière est de taille modeste, mais possède des dents assez grosses (mégadonte); en revanche, chez Orrorin, l'inverse est vrai, le corps est plus grand mais les dents plus petites (microdonte). Si Orrorin devait être un ancêtre des Australopithèques, eux-mêmes ancêtres de l'homme, il faudrait admettre que des êtres microdontes auraient donné naissance à des mégadontes, qui eux-mêmes auraient donné naissance à des microdontes. Ces aller-retours anatomiques qui touchent à la fois le système masticateur et le système locomoteur semblent douteux et c'est pour cela que nous considérons les Australopithèques comme une branche à part de notre famille. Lors de sa découverte en 2000, Orrorin était le premier Hominidé connu antérieur à 5 millions d'années et sa présence si ancienne remettait en cause les données moléculaires en suggérant une dichotomie entre les grands singes et l'homme très ancienne (bien antérieure à 6 millions d'années).
Ardipithecus ramidus kadabba
Le débat sur nos origines était relancé en juillet 2001 avec la publication d'une sous-espèce d'Ardipithèque, Ardipithecus ramidus kadabba, découverte en Ethiopie dans des niveaux vieux de 5,7 à 5,2 millions d'années. Elle est représentée par des dents et os isolés (notamment fragment d'humérus et phalanges du pied et de la main). Elle se différencie des grands singes actuels par la tendance des canines à être incisiformes et la morphologie générale de ces dernières; mais, elle s'isole également d' Ardipithecus ramidus ramidus par la morphologie des P3 et M3 supérieures et de la canine inférieure. Les caractères des éléments post-crâniens rappellent ceux des grands singes et de certains spécimens de Hadar et suggéreraient des adaptations à la vie arboricole. Même si selon les auteurs, on peut considérer cette sous-espèce d'Hominoïde comme un Hominidé, il n'en reste pas moins qu'un certains nombre de caractères rappellent les grands singes et que les différences d'avec l'autre sous-espèce méritent clarification.
Sahelanthropus tchadensis
Puis, un an après la découverte éthiopienne étaient publiés les restes d'un hominoïde vieux de 6 à 7 millions d'années, trouvés au Tchad, très loin à l'Ouest de la fameuse faille est-africaine. La pièce la plus médiatique est un crâne légèrement écrasé rapporté par ses inventeurs à un Hominidé sur la base en particulier de la petite taille de la canine, le mode d'usure de cette dernière, l'aplatissement de la face, la position dite « plus antérieure » du foramen magnum. Selon les auteurs, le bourrelet sus-orbitaire très massif indiquerait que le crâne appartenait à un individu mâle. Les autres caractères incluent entre autres: des dents jugale (molaires et prémolaires basses), l'émail intermédiaire en épaisseur entre celui des chimpanzés et des Ardipithèques, une morphologie supra-orbitaire robuste (probablement mâle selon les auteurs), un plancher nuchal plat et des insertions musculaires puissantes dans la région nuchale.
La petite canine n'est pas un caractère d'Hominidé sensu stricto comme signalé plus haut; en effet, chez les grands singes miocènes et modernes, la taille de la canine est le plus souvent l'expression du dimorphisme sexuel. La canine du mâle étant beaucoup plus développée, il s'ensuit un gonflement de la région faciale qui reçoit la racine de la dent, alors que chez la femelle, le gonflement est réduit en liaison avec une racine de taille plus modeste; d'où l'aspect plus plat de la face.
La taille du bourrelet sus-orbitaire n'est pas classiquement utilisé pour sexer des crânes isolés. Chez les chimpanzés ou les gorilles actuels, le bourrelet sus-orbitaire apparaît fort chez les mâles, comme chez les femelles au sein d'une même population; il est en général un peu plus fort chez les mâles. Sur un crâne isolé, il est très difficile de déterminer le sexe de l'individu à partir de ce seul caractères. En dehors du fait que la position antérieure du foramen magnum n'est pas confirmée, il faut être prudent car celle-ci n'est pas liée exclusivement à la bipédie, elle aurait, pour certains, un lien avec le développement cérébral Parmi les caractères décrits, certains semblent rapprocher plus volontiers la pièce des grands singes : aplatissement du plancher nuchal, systèmes des crêtes postérieures et le spécimen, probablement femelle n'apparaît pas très différent de celui des grands singes actuels, en particulier des gorilles. Si cette hypothèse s'avérait confirmée, cela rendrait la découverte tchadienne encore plus intéressante scientifiquement, car elle commencerait à combler l'immense lacune de l'histoire des grands singes africains entre 12 millions d'années et aujourd'hui.
L'origine de l'homme : une histoire de climat ?
Si on veut comprendre l'histoire de nos origines, on ne peut pas se limiter à l'étude des modifications anatomiques de nos ancêtres potentiels. Ces derniers ont vécu dans un environnement qui s'est transformé au cours des temps géologiques en liaison avec les modifications climatiques, géographiques, tectoniques et autres. Un vieux mythe qui encombre encore certains de nos ouvrages est la naissance de l'homme et de sa bipédie dans un milieu ouvert de savane. Or, les dernières données suggèrent que le milieu dans lequel vivait Orrorin ou ses parents Ardipithecus était plutôt humide. En particulier, dans l'environnement d' Orrorin, les colobes et les impalas dominaient la faune; ces espèces ne vivent pas en milieu ouvert : les colobes sont des animaux très arboricoles et les impalas vivent plutôt dans des fourrés. D'où probablement les adaptations à la vie arboricole encore bien marqués chez eux comme chez les premiers australopithèques.
Une hypothèse séduisante a été proposée par Coppens au début des années 1980 : la fameuse « East Side Story ». Dans cette hypothèse éco-climatico-géographique, le rift jouait un rôle majeur: des grands singes auraient été largement distribués en Afrique au Miocène, puis vers 8 millions d'années, une réactivation de la faille aurait engendré la coupure en deux de cette population ancestrale, l'une à l'Ouest aurait donné les grand singes actuels africains restés inféodés au milieu forestier et l'autre aurait évolué vers l'homme dans un milieu plus sec (mais pas forcément de savane sèche, ni de désert). Toutefois, vers 8 millions d'années, il y a une modification du climat à l'échelle du monde. L'établissement de la calotte polaire arctique a entraîné le mouvement vers le Sud des ceintures climatiques mondiales, affectant ainsi la température de l'eau de océans, la répartition des faunes et leur composition. Les grands singes faisant partie de cette faune n'ont probablement pas échappé à ce grand remaniement. L'événement a été ressenti à l'échelle du globe de l'Amérique à l'Europe en passant par l'Afrique. C'est à cette époque que se met en place le Sahara. Le changement faunique a aussi coïncidé avec l'effondrement du rift et des changements à l'échelle locale ont pu avoir lieu. Si l'hypothèse de l'East Side Story a souvent été caricaturée, elle n'en demeure pas moins valide dans l'état actuel de nos connaissances d'un point de vue chronologique et climatique.
Quel(s) ancêtre(s)
Selon certains auteurs, les hominidés antérieurs à 3,5 millions d'années sont les ancêtres des Australopithèques, eux-mêmes ancêtres des hommes. Les découvertes réalisées récemment dans le Miocène supérieur et le Pliocène suggèrent que la diversité des formes a été plus importante et en fait, il semble bien qu'il y ait eu une lignée mégadonte Australopithèque qui s'est éteinte vers 1,4 Millions d'années avec peut-être certains ardipithèques à sa base et une lignée plus microdonte avec Orrorin, Praeanthropus et les Homo anciens. L'origine de ces lignées est à rechercher au-delà de 6 millions d'années et peut-être jusqu'à 12-13 Millions d'années. Qui sont les ancêtres des grands singes africains modernes ? Des fossiles découverts récemment au Kenya suggèrent que des formes proches des chimpanzés auraient pu être présents dès 12,5 millions d'années dans la Formation de Ngorora, Certains Ardipithèques en seraient-ils les descendants? Une dent fragmentaire de 6 millions d'années trouvée au Kenya semble proche des gorilles et à la même époque ces derniers auraient pu être au Tchad. Quoiqu'il en soit, il apparaît que la dichotomie entre les grands singes africains et l'homme est plus ancienne que ne le suggèrent les données moléculaires et que la découverte de tout jalon sur la lignée des premiers sera un apport essentiel à la compréhension des autres. Mais où se situe l'origine des hominidés ? est-elle donc à l'Est ? ou ailleurs ? Si on en croit l'Abbé Breuil, le berceau est à roulettes. Si on s'en tient aux données actuelles, l'Afrique orientale semble renfermer les plus anciennes traces d'hominidés. Si le matériel tchadien était confirmé dans son statut d'hominidé, l'Afrique centrale tiendrait peut-être le flambeau. Mais finalement, cela n'a pas grande importance lorsqu'on réalise que 3% peut-être du continent africain sont aujourd'hui prospectés. Nos scénarios sont forcément voués à changer. En revanche, on peut affirmer aujourd'hui que des êtres bipèdes très anciens sont connus vers 6 millions d'années en Afrique et qu'ils vivaient dans un milieu plus humide qu'on ne le pense généralement.
Bibliographie
M. Brunet, F. Guy, D. Pilbeam, H. Mackaye, A. Likius, D. Ahounta, A. Beauvilain, C. Blondel, H. Bocherens, J-R. Boisserie, L. De Bonis, Y. Coppens, J. Dejax, C. Denys, P. Duringer, V. Eisenmann, G. Fanone, P. Fronty, D. Geraads, T. Lehmann, F. Lihoreau, A. Louchar, A. Mahamat, G. Merceron, G. Mouchelin, O. Otero, P. Campomanes, M. Ponce De Leon, J-C. Rage, M. Sapanet, M. Schuster, J. Sudre, P. Tassy, X. Valentin, P. Vignaud, L. Viriot, A. Zazzo, C. Zollikofer, « A new hominid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa », Nature, 418, 145-151, 2002
Y. Coppens, « Hominoïdés, Hominidés et Hommes », La Vie des Sciences, Comptes rendus, série générale, 1, 459-486, 1984
Y. Coppens & B. Senut (Eds.), Origine(s) de la bipédie chez les Hominidae, Cahiers de Paléoanthropologie, Paris, CNRS, 1991
H. Ishida, M. Pickford, « A new Late Miocene hominoid from Kenya : Samburupithecus kiptalami gen et sp. nov », C. R Acad. Sci. Paris, IIa , 325, 823-829, 1998
M. Pickford, H. Ishida, « Interpretation of Samburupithecus, an Upper Miocene hominoid from Kenya », C. R Acad. Sci, Paris, IIa 326, 299-306, 1998
M. Pickford, B. Senut, « The geological and faunal context of Late Miocene hominid remains from Lukeino, Kenya », C. R. Acad. Sci, Paris, sér IIa, 332, 145-152, 2001
M. Pickford, B. Senut, D. Gommery, J. Treil, Bipedalism in Orrorin tugenensis revealed by its femora. C. R. Palevol 1, 191-203, 2002
Y. Sawada, T. Miura, M. Pickford, B. Senut, T. Itaya, C. Kashine, M. Hyodo, T. Chujo, H. Fujii, « The age of Orrorin tugenensis, an early hominid from the Tugen Hills, Kenya », C. R. Palevol, 1, 293-303, 2002
B. Senut, « Les grands singes fossiles et l'origine des Hominidés : mythes et réalités », Primatologie, 1, 93-134, 1998
B. Senut, M. Pickford, D. Gommery, P. Mein, K. Cheboi, Y. Coppens, « First hominid from the Miocene (Kukeino Formation, Kenya) », C. R. Acad. Sci, Paris, série IIa, 332, 137-144, 2001
T.D. White, G. Suwa, B. Asfaw, « Australopithecus ramidus, a new species of early hominid from Aramis, Ethiopia », Nature, 371, 306-312, 1994
T.D. White, G. Suwa, B. Asfaw, « Corrigendum - Australopithecus ramidus, a new species of early hominid from Aramis, Ethiopia », Nature, 375, 88, 1995
G. WoldeGabriel, T.D. White, G. Suwa, P. Renne, J. de Heinzelin, W. K. Hart, G. Helken, « Ecological and temporal palcement of early Pliocene hominids at Aramis, Ethiopia », Nature, 371, 330-333, 1994
M. Wolpoff, B. Senut, M. Pickford, J. Hawks, « Sahelanthropus or Sahelpithecus ? », Nature, 419, 581-582.
VIDEO CANAL U LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
LA RESPIRATION |
|
|
| |
|
| |

respiration
(latin respiratio)
Consulter aussi dans le dictionnaire : respiration
Cet article fait partie du dossier consacré à l'air et du dossier consacré à la respiration.
Ensemble des phénomènes permettant l'absorption de l'oxygène et le rejet du gaz carbonique par les êtres vivants.
PHYSIOLOGIE
Cet article aborde la physiologie de la respiration animale et végétale. Pour la physiologie humaine et les troubles respiratoires voir l'article respiration [médecine].
La respiration produit de l’énergie à partir des molécules organiques apportées par l’alimentation. Elle s'effectue dans toutes les cellules, consomme de l’oxygène et rejette du dioxyde de carbone (ou gaz carbonique).
1. ÉCHANGES ET TRANSPORT DES GAZ RESPIRATOIRES
1.1. LES ÉCHANGES RESPIRATOIRES
L’oxygène nécessaire aux cellules est prélevé dans le milieu extérieur, tandis que le dioxyde de carbone (ou gaz carbonique), qui est un déchet de la respiration, y est rejeté. Ce processus constitue les échanges respiratoires.
Chez les mousses et les algues, l’oxygène diffuse à travers l’épiderme et gagne toutes les cellules. Chez les plantes, les échanges respiratoires ont lieu au niveau des feuilles, des racines et/ou de l'écorce ; ils se font, par simple diffusion, par de petits pores appelés stomates (sur les feuilles) et lenticelles (sur l’écorce et les racines).
Chez les protozoaires (unicellulaires à affinités animales), de structure très simple (spongiaires, cnidaires) ou de très petite taille (certains vers), les gaz diffusent directement entre le milieu et chaque cellule de l’animal. Chez les autres animaux, les échanges d'oxygène et de gaz carbonique se font au niveau d'organes spécialisés dans la respiration. Ces organes respiratoires sont, en milieu aquatique, des branchies qui permettent de respirer l’oxygène dissous dans l’eau (chez les poissons, les mollusques aquatiques, les crustacés, les larves d’amphibiens) et, en milieu terrestre, des trachées (chez les insectes, les myriapodes et certains arachnides), des phyllotrachées (la majorité des arachnides) ou des poumons (chez les mollusques gastéropodes terrestres, les amphibiens adultes, les reptiles, les oiseaux, les mammifères). Certains poissons d’eau douce africains vivant dans des eaux peu oxygénées ont à la fois des poumons et des branchies. Bien que vivant en milieu aquatique, les mammifères marins n’ont pas de branchies mais bien des poumons, et remontent régulièrement à la surface pour respirer l’oxygène de l’atmosphère grâce à leurs poumons. Chez certains animaux, une partie des échanges gazeux se fait par la peau et les muqueuses. C’est le cas chez les amphibiens adultes et chez le périophtalme, petit poisson des mangroves qui peut passer jusqu’à 2 heures hors de l’eau grâce à la respiration cutanée. , trachées, poumons ou branchies. Chez les amphibiens, une grande partie des échanges a lieu à travers la peau.
Chez l'homme adulte au repos, 250 ml d'oxygène sont consommés chaque minute, et 200 ml de dioxyde de carbone sont produits ; au cours d'un effort, ces valeurs sont multipliées par 10 environ.
1.2. SYSTÈMES DE TRANSPORT
Chez les végétaux, l’oxygène prélevé dans l’atmosphère gagne les cellules grâce à un réseau de lacunes (espaces entre les cellules) ; le dioxyde de carbone rejeté par la respiration au niveau de chaque cellule suit le chemin inverse. Les gaz circulent également de cellule en cellule grâce à des perforations des parois cellulaires.
Chez la plupart des animaux, il existe un système de transport des gaz entre la surface respiratoire qui assure les échanges avec le milieu extérieur, et les cellules de l’organisme – qui en sont parfois très éloignées. Ce transport dans l’organisme est le plus souvent assuré par le sang. Chez les invertébrés qui ne respirent pas avec des trachées, ce rôle est rempli par l’hémolymphe (l’équivalent du sang chez les invertébrés) – chez les invertébrés à trachées (insectes notamment), ce sont les trachées elles-mêmes (ou plutôt les trachéoles) qui apportent l’oxygène aux cellules.
LES PIGMENTS RESPIRATOIRES
Le sang et l’hémolymphe contiennent des pigments spécialisés dans le transport des gaz respiratoires, qui ont une très forte affinité pour l’oxygène. Il en existe de nombreux types, mais tous ont en commun une structure protéique, à laquelle sont associés des ions métalliques (fer, cuivre). Chez les invertébrés, ces pigments sont en solution dans le liquide, tandis que chez les organismes plus complexes, ils sont contenus dans des cellules.
Ainsi l'hémoglobine des vertébrés est—elle incluse dans les globules rouges (hématies) du sang ; c'est d'ailleurs elle qui leur donne leur couleur rouge. C’est une protéine de forme à peu près sphérique, de 5,5 nm de diamètre. Elle est composée de sous-unités protéiques (quatre le plus souvent) qui contiennent chacune un atome de fer. Celui-ci a la propriété de fixer l'oxygène (de l'air ou celui dissous dans l'eau), et de l'abandonner (le relarguer) au voisinage de ces cellules. Chez de nombreux crustacés et mollusques, le pigment respiratoire, dissous dans l'hémolymphe, est l'hémocyanine, qui contient des atomes de cuivre.
LE TRANSPORT DU DIOXYDE DE CARBONE
Le dioxyde de carbone étant très soluble dans l'eau (30 fois plus que l'oxygène), aucun problème réel de transport ne se pose : il diffuse rapidement des tissus qui le rejettent vers l'extérieur (diffusion par le sang, d'où il est entraîné vers les poumons). Au niveau des alvéoles pulmonaires, la concentration de ce gaz dans l'air est relativement faible, et il est donc facilement libéré.
Malgré cela, le dioxyde de carbone n'est pas seulement transporté sous forme dissoute. En effet, il peut se combiner avec l'eau pour former des ions bicarbonate (HCO−3), et cette transformation est accélérée à l'intérieur des hématies par une enzyme, l'anhydrase carbonique. Ces ions représentent en fait la forme la plus abondante du dioxyde de carbone véhiculée par le sang. Enfin, le dioxyde de carbone peut se combiner avec le groupement amine (–NH2) des protéines et, en particulier, avec celui de l'hémoglobine.
Ainsi, auprès des cellules, les hématies se chargent du gaz carbonique produit par ces dernières, qu'elles relarguent ensuite au niveau des surfaces respiratoires.
1.3. LES FACTEURS MODIFIANT LE TRANSPORT D'OXYGÈNE
Certains facteurs modifient et régulent l'association entre le pigment respiratoire et l'oxygène. En effet, il est important que le pigment puisse, ponctuellement, capter des quantités de gaz plus importantes et libérer rapidement les molécules dans les tissus qui en ont besoin. Parmi ces facteurs influençant l'affinité des pigments pour l'oxygène, on trouve le pH, la température et le 2,3-diphosphoglycérate (DPG). Ainsi, une légère diminution du pH (pH plus acide) affaiblit la liaison entre l'oxygène et le pigment respiratoire. Or, l'augmentation de la teneur en CO2 du sang le rend plus acide, ce qui incite les pigments à relarguer leur oxygène.
L'augmentation de la température diminue l'affinité des pigments pour l'oxygène (c'est-à-dire que les pigments relâchent plus facilement l'oxygène qui leur est lié). Au niveau physiologique, ceci est important, car les tissus actifs – comme les muscles lors d'un effort – ont une température plus élevée : cette propriété permet de libérer plus rapidement l'oxygène à leur niveau et donc de mieux répondre à leur demande élevée en oxygène. Le DPG a une action comparable à celle de la température au niveau de l'association oxygène/hémoglobine. Les hématies d'un fœtus ayant une concentration en DPG plus faible que celle des hématies de la mère, l'affinité de l'hémoglobine du fœtus pour l'oxygène est plus importante. Cette propriété explique que l’oxygène puisse circuler sans problème du sang de la mère vers celui du bébé.
1.4. LE PHÉNOMÈNE DE RESPIRATION DANS LES ŒUFS
Aucun mouvement respiratoire ne peut être observé chez un œuf et, pourtant, celui-ci respire. C'est que les échanges gazeux se font à travers les milliers de pores microscopiques de la coquille, selon les règles de la diffusion.
Lorsque la teneur en oxygène de l'œuf est plus basse que celle de l'atmosphère, l'oxygène entre spontanément. De même, lorsque le taux de dioxyde de carbone interne s'élève, celui-ci s'échappe de l'œuf. Collé contre la membrane interne de la coquille, un feuillet richement vascularisé, l'allantochorion (l'équivalent du placenta des mammifères) est le lieu où s'effectuent les échanges gazeux avec la circulation sanguine de l'embryon. Chez l'embryon de poulet, dont l'incubation dure 21 jours, l'allantochorion est déjà constitué le 5e jour. La respiration pulmonaire commence le 19e jour, 2 jours avant l'éclosion. Le jeune perce alors la chambre à air de l'œuf (la petite réserve d’air qui se forme à la base de la coquille), qui est apparue entre-temps, et commence à respirer avec ses poumons.
2. LES RÉACTIONS DE LA RESPIRATION CELLULAIRE
Les réactions biochimiques de la respiration se font à l’intérieur des cellules, dans de petits organites spécialisés, les mitochondries. La totalité des réactions de la chaîne respiratoire et des phosphorylations a lieu dans la membrane interne des mitochondries. Plus l'activité respiratoire des mitochondries est importante, plus cette dernière comporte de crêtes ou de replis membranaires.
Les réactions de la respiration cellulaire se font au niveau d’un ensemble de complexes protéiques (numérotés de I à IV) situés dans la membrane interne de la mitochondrie, et appelé chaîne respiratoire. Elles commencent par des déshydrogénations et se poursuit par des transferts d'électrons vers l'oxygène.
2.1. GLYCOLYSE, CYCLE DE KREBS ET CHAÎNE RESPIRATOIRE
Le « carburant » essentiel des cellules, à partir duquel la respiration produit de l’énergie, est le glucose. Ce n’est toutefois pas directement lui qui pénètre dans les mitochondries : il est d’abord dégradé dans le cytoplasme par les réactions de la glycolyse, pour donner de l’acide pyruvique, ou pyruvate (1 molécule de glucose donne 2 molécules d’acide pyruvique). C’est cet acide pyruvique qui passe dans la matrice de la mitochondrie. Là, il est transformé en acétyl-Coenzyme A, ou acétyl-CoA (avec production de CO2). L’acétyl-CoA est incorporé dans le cycle de Krebs. Celui-ci aboutit, dans la matrice de la mitochondrie, à la formation de transporteurs réduits (NADH) et de protons (H+), avec libération de CO2.
Au niveau de la membrane interne des mitochondries, les transporteurs réduits sont réoxydés. Les électrons cédés sont pris en charge par d’autres transporteurs situés dans cette membrane, les cytochromes. Les réactions qui se produisent le long de cette chaîne de transport d’électrons (la chaîne respiratoire), grâce à l’énergie qu’elles libèrent, entraînent un transport actif de protons de la matrice de la mitochondrie vers l’espace situé entre ses deux membranes (espace intermembranaire). Ceci induit, de part et d’autre de la membrane interne (imperméable aux protons), la création d’un gradient de protons (H+), qui représente une énergie potentielle.
2.2. PRODUCTION D’ÉNERGIE SOUS FORME D’ATP
La membrane interne des mitochondries possède des complexes enzymatiques (ATP synthétases ou ATPases) qui forment chacun un canal à protons. Le flux passif des protons à travers ces canaux fournit l’énergie nécessaire à la phosphorylation d’un composé à deux phosphates, l’ADP (adénosine diphosphate) en composé à trois phosphates, l’ATP (adénosine triphosphate). L’ATP est une molécule très énergétique ; il est la source d’énergie universelle de toutes les réactions de la cellule. Au bout de la chaîne respiratoire, l’oxygène, dans la matrice mitochondriale, constitue l’accepteur final des protons, ce qui aboutit à la formation d’eau (H2O).
La chaîne respiratoire est hautement énergétique : à partir de 1 molécule de glucose, elle produit 34 ATP. La glycolyse en produit 2, et le cycle de Krebs 2 également. En tout, la dégradation d’une molécule de glucose par voie aérobie (en présence d’oxygène) produit dont 38 ATP.
ZOOLOGIE
Quel que soit le groupe zoologique considéré, l'appareil respiratoire assure les échanges d'oxygène et de gaz carbonique entre l'organisme et son milieu, soit directement (trachées des insectes), soit par l’intermédiaire d’un système circulatoire (poumons, branchies). Selon qu’il est aquatique (branchies) ou aérien (poumons, trachées), sa physiologie varie. Certains animaux respirent aussi au travers de leur épithélium cutané.
Il existe ainsi quatre modes de respiration chez les animaux, mettant en jeu des organes et des mécanismes respiratoires différents.
1. LA RESPIRATION PULMONAIRE
Elle se fait par l’intermédiaire de poumons, qui représentent une invagination du milieu extérieur dans l’organisme. C’est le mode de respiration des invertébrés pulmonés (escargots, scorpions, certaines araignées), des amphibiens, des reptiles, des oiseaux et des mammifères (aussi les mammifères aquatiques ne peuvent-ils rester indéfiniment en plongée et doivent-ils remonter régulièrement en surface pour respirer l’oxygène de l’air), ainsi que de quelques espèces de poissons (les dipneustes d'Australie et les protoptères d'Afrique, qui possèdent aussi des branchies).
Mis à part chez les invertébrés pulmonés, chez lesquels le renouvellement de l’air est surtout assuré de manière passive (par diffusion), il existe généralement un système de ventilation.
2. LA RESPIRATION TRACHÉENNE
Système respiratoire des insectes
C’est le mode de respiration des insectes et de certains autres arthropodes, tels les myriapodes (mille-pattes). L'appareil respiratoire consiste en tubes ramifiés appelés trachées (à leur tour ramifiés en tubes plus petites, les trachéoles), qui s’ouvrent à l'extérieur par des pores appelés stigmates et se terminent dans les tissus. L’oxygène, qui pénètre par les stigmates, se rend directement, via le réseau trachéen, aux cellules qui l’utilisent. Le système respiratoire trachéen est indépendant du système circulatoire.
Chez de nombreux arachnides, les trachées peuvent être complétées ou remplacées par des phyllotrachées. Ces petits sacs, qui contiennent des feuillets à travers lesquels s’effectuent les échanges gazeux, sont aussi appelés poumons, mais sur le plan anatomique, ils correspondant à des trachées modifiées.
3. LA RESPIRATION BRANCHIALE
Système respiratoire des poissons
Elle se fait par l’intermédiaire de branchies, qui représentent une expansion de l’animal baignant dans le milieu extérieur (l’eau), et qui captent l’oxygène dissous dans l’eau. La respiration branchiale se rencontre chez de nombreux invertébrés (annélides, mollusques, crustacés, etc.), chez les poissons et chez les larves d’amphibiens.
4. LA RESPIRATION CUTANÉE
Chez les protozoaires, les spongiaires, les cœlentérés, etc., c’est le seul mode de respiration : l'oxygène et le gaz carbonique diffusent directement à travers la membrane cellulaire (protozoaires) ou l'épiderme. Parmi les vertébrés, elle existe chez les amphibiens, chez qui elle joue un rôle capital, qui permet de compléter le faible apport en oxygène assuré par les poumons. Chez les anoures (grenouilles, crapauds), il existe un troisième mode de respiration : la respiration bucco-pharyngée (la muqueuse de la bouche est très vascularisée, assurant une partie des échanges gazeux ; le renouvellement de l’air est assuré par les battements du plancher buccal). Les salamandres sans poumons, qui ne possèdent ni branchies ni poumons, respirent uniquement par la peau, qui doit rester constamment humide.
BOTANIQUE
Les voies métaboliques de la respiration des végétaux sont tout à fait comparables à celles des animaux. Elles ont lieu à l'intérieur des cellules, au niveau des mitochondries. La respiration consiste essentiellement en une oxydation des aliments (glucides surtout, mais aussi lipides et protéines si les glucides viennent à manquer) fragmentés grâce à des enzymes. Elle libère de l'énergie utilisable par la plante et se manifeste, extérieurement, par la pénétration d'oxygène et le rejet de gaz carbonique.
1. DES STOMATES POUR LES ÉCHANGES GAZEUX
Les stomates sont de petits pores situés à la surface des feuilles, qui s'ouvrent ou se ferment selon les besoins. C’est par ces ouvertures que se font les échanges gazeux (ceux de la respiration, mais aussi ceux de la photosynthèse) de la plante avec le milieu extérieur. Toutefois, une partie de l'oxygène peut être captée dans le sol par le système racinaire. Chez les arbres, l’écorce porte également des pores, appelés lenticelles.
2. LE QUOTIENT RESPIRATOIRE
Le quotient respiratoire varie avec la nature des substances qui sont détruites par la respiration ; égal à 1 lorsque les glucides seuls sont oxydés, il peut devenir supérieur (3 pendant la maturation des fruits, 1,57 pendant la formation des graines des plantes oléagineuses), ou au contraire très faible (de 0,4 à 0,5) pendant la germination de ces graines. La combustion respiratoire du glucose a pour formule simplifiée : C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 688 kcal. Mais en raison de l'extrême complexité des réactions intermédiaires (cycle de Krebs, formation d'ATP), le rendement est seulement voisin de 40 %.
3. MODIFICATIONS DE L’ACTIVITÉ RESPIRATOIRE DES VÉGÉTAUX
De nombreux facteurs physiques de l'environnement, parmi lesquels la teneur en oxygène, sont susceptibles de modifier l'activité respiratoire des végétaux. Celle-ci croît notamment de façon régulière en fonction de la teneur en oxygène, et l'on parvient à un palier pour des valeurs proches de celle de l'atmosphère, soit 21 %. Les sols marécageux, sans atmosphère interne, créent des conditions d'asphyxie pour les racines ; mais les plantes disposent, en général, de caractères adaptatifs, comme les racines aériennes, qui permettent d'en limiter les effets néfastes. En agriculture, l'action bénéfique des labours est due pour une bonne part à la meilleure aération des organes souterrains.
Une hausse de la température, du moins jusqu'à 40 ou 50 °C, augmente l'activité respiratoire. Mais c'est là un phénomène qui n'est dû qu'aux effets de la température sur la vitesse à laquelle se produisent les réactions chimiques.
4. RESPIRATION ET PHOTOSYNTHÈSE
La respiration utilise de l’oxygène et rejette du dioxyde de carbone, tandis que la photosynthèse utilise du dioxyde de carbone et rejette de l’oxygène. Si on mesure les échanges gazeux d’une plante, on s’aperçoit que le jour, elle rejette de l’oxygène, tandis que la nuit, elle émet du dioxyde de carbone. Les fonctions respiratoire et chlorophyllienne semblent ainsi être l'inverse l'une de l'autre. En fait, la respiration ne cesse jamais, sous peine d'asphyxie ; elle a lieu en permanence, jour et nuit, comme pour tous les êtres vivants. En revanche, chez la plupart des plantes, la photosynthèse se produit le jour, car elle utilise l’énergie lumineuse du soleil. Son intensité est généralement plus grande que celle de la respiration : elle rejette plus d’oxygène que ce que la respiration en consomme, ce qui fait qu’elle la dissimule lorsque les échanges gazeux à la lumière sont mesurés.
5. LA PHOTORESPIRATION
Il convient de bien séparer la respiration des plantes de leur photorespiration. La photorespiration est un phénomène particulier étroitement associé à la photosynthèse, et qui existe chez toutes les plantes chlorophylliennes. Elle se produit uniquement à la lumière et débute dans les chloroplastes. Elle produit un dégagement de gaz carbonique ; ce dégagement induit une perte de la quantité de dioxyde de carbone assimilé par la photosynthèse, donc diminue le rendement photosynthétique. Ce phénomène a été interprété à une époque comme un gaspillage, mais en fait, il a été montré que la photorespiration génère des produits métaboliques très utiles à la plante, tel un précurseur d’acides aminés.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
